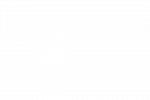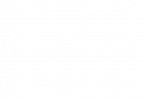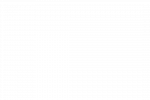José Mourinho n’a plus grand-chose de « special »
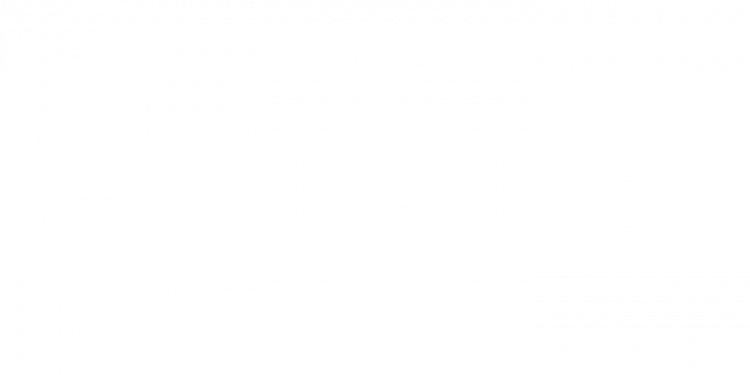
José Mourinho n’a plus grand-chose de « special »
Par Alexandre Pedro
Le Portugais a été débarqué mardi de son poste d’entraîneur de Manchester United. L’autoproclamé « Special One » a fini par user son personnage.
José Mourinho chambre le public de Turin après le match contre la Juventus, le 7 novembre. / Stefano Rellandini / REUTERS
Débarqué de Manchester United, mardi 18 décembre, José Mourinho passera les fêtes dans la peau d’un entraîneur sans emploi. La dure loi du métier. Lui la connaît mieux que personne. Enfant, elle venait plomber l’ambiance dans la maison familiale de Setúbal. Son père Felix, mort en 2017, a entraîné douze clubs au Portugal et a plus souvent que de raison servi de fusible à des présidents versatiles. Le fils a souvent raconté la scène, celle de son père congédié « au téléphone au milieu du déjeuner le jour de Noël ».
Dans ses souvenirs, Mourinho fils avait « neuf ou dix ans ». Quand il marche sur les traces paternelles après une très modeste carrière de joueur, il se jure qu’il ne sera pas de ces entraîneurs qu’on prend et que l’on jette au premier coup de vent. « Partout où il passe, Félix Mourinho est viré sans explication. Trop bon, trop con. José n’oubliera jamais ce principe », écrit Thibaud Leplat dans une passionnante biographie du personnage (Le Cas Mourinho, ed. Hugo Sport, 2013).
Certains tuent le père, José Mourinho, lui, le venge. A ses dirigeants, joueurs, confrères entraîneurs (d’Arsène Wenger à Pep Guardiola en passant par Claudio Ranieri) et même aux journalistes, il impose un rapport de force, marque ses prérogatives. Longtemps, le charme opère. Mourinho est jeune, disruptif avant l’heure par sa personnalité, ses méthodes, propage la périodisation tactique, parle cinq langues, porte beau et gagne, surtout. Il s’autoproclame « Special One » à son arrivée à Chelsea en 2004. L’Angleterre l’adopte tout de suite.
« Un football désastreux »
Aujourd’hui, José Mourinho n’est plus si jeune (55 ans), ni vraiment « special ». Ses sorties sur les arbitres, les adversaires ou même ses joueurs n’amusent plus. Le Portugais cabotine comme un acteur sur le retour. A Manchester United (où il débute à l’été 2016), il a tiré sur les mêmes ficelles, allumé des incendies un peu partout sans jamais parvenir à les éteindre. Le meneur d’hommes a perdu ce qui était sa force : l’amour des joueurs pour sa personne. Dans des vestiaires encore acquis à sa cause, il avait l’habitude de répéter avant les matchs : « Si vous faites ce que je vous dis, on ne peut pas perdre ce match. C’est impossible. »
La promesse ne tient plus. Sortie d’une victoire en Ligue Europa en 2017, son Manchester United a peu gagné, à l’image de ce début de saison en Premier League (6e après 17 journées avec 26 points, soit le total le plus faible pour le club depuis 1990). Il séduit encore moins dans son expression collective.
José Mourinho quitte son domicile à Manchester après l’annonce de son départ, le 18 décembre. / PHIL NOBLE / REUTERS
A défaut de donner dans le football champagne, ses équipes étaient de formidables machines, bien pensées, bien articulées, géniales dans l’art de faire déjouer ou de s’adapter, diront ses derniers zélateurs. Mardi, ils doivent bien se sentir seuls. « On a atteint des sommets dans le désastreux – une égalisation désastreuse, un football désastreux, joué désastreusement par une équipe désastreuse », écrivait Barney Ronay dans The Guardian après la défaite 3-1, dimanche, à Liverpool.
Plutôt que de chercher des solutions, José Mourinho a donné l’impression ces derniers mois de chercher à allumer des contre-feux, de masquer les problèmes en créant de nouveaux conflits comme avec Paul Pogba, souvent relégué sur le banc pour piquer son orgueil ou juste le punir. « Lui, il mérite de jouer plus, vantait-il en février à propos de Scott McTominay, remplaçant éphémère du milieu de terrain français. Il n’a pas de cheveux colorés, pas de grosse voiture ou de grosse montre, pas de tatouages. »
Vestiaire déchiré et malédiction des trois ans
A Manchester, la mutinerie menaçait avant l’annonce de son licenciement. Comme au Real Madrid déjà lors de son passage tumultueux entre 2010 et 2013. Parti en héros de Porto (2002-2004) et de l’Inter Milan (2008-2010), à chaque fois après une victoire en Ligue des champions, le général Mourinho laisse derrière lui un vestiaire déchiré entre ses derniers fidèles et le clan des Espagnols emmenés par Sergio Ramos. Il finit même par s’aliéner son compatriote Cristiano Ronaldo, dont il partage pourtant le même agent, Jorge Mendes.
Au moment de son retour à Chelsea en 2013, il tente bien de tuer le « Special One ». Place au « Happy One ». C’est lui qui le dit. Le bonheur dure une saison, le temps d’un titre de champion d’Angleterre. Avec Mourinho, l’amour ne dure jamais trois ans. A l’automne 2015, Chelsea enchaîne les défaites. Dans une sortie légendaire, il récite son palmarès et y ajoute cette « série de défaites historique » avec les Blues. L’humour pour bouée. « Ce qui est étonnant, c’est que cela m’arrive seulement maintenant, après quinze ans de carrière au plus haut niveau », confie-t-il alors au journal Le Temps, avant d’être débarqué le 17 décembre 2015.
Le « Happy One » est déjà bien loin, le « Special One » aussi. Mourinho a perdu le contrôle de son vestiaire et sa communication quand il accuse ses joueurs à Chelsea de l’avoir « trahi » après une défaite contre Leicester. Avec le temps, il est devenu la première victime de la guerre psychologique qu’il livre à longueur de conférence de presse. A Manchester, le Portugais a réchauffé les mêmes recettes, épuisé ses hommes, les médias et peut-être lui-même avec.
Le charme est bien rompu. L’entraîneur doit se réinventer. Il a du temps et beaucoup d’argent devant lui pour effectuer son propre devoir d’inventaire. Après tout, ses titres, son talent et son charisme méritent mieux que la mauvaise caricature de lui-même qu’il a fini par devenir.