Football : la Premier league, « produit sportif » le plus suivi au monde
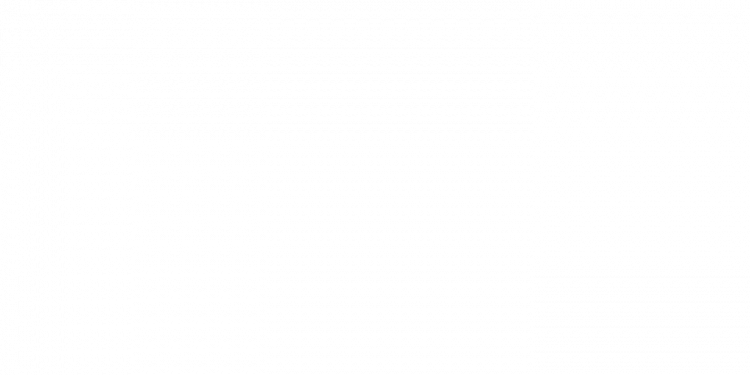
Football : la Premier league, « produit sportif » le plus suivi au monde
Par Rémi Dupré
Pas de trêve hivernale pour le championnat anglais, avec, mercredi, les matchs du « Boxing Day ». Journaliste au « Wall Street Journal », Joshua Robinson revient sur le boom économique et l’attractivité de ce championnat.
Le Mancunien Paul Pogba, le 22 décembre, contre Cardiff City. / Jon Super / AP
Alors que la plupart des footballeurs évoluant en Europe profitent de la trêve hivernale pour recharger leurs batteries, les joueurs du championnat anglais, eux, fouleront les terrains, mercredi 26 décembre, lors du fameux « Boxing Day ».
Coauteur avec son confrère Jonathan Clegg d’un ouvrage fouillé sur le boom économique et l’attractivité de la Premier League (« The Club », Houghton Mifflin Harcourt, sorti aux Etats-Unis et qui paraîtra le 10 janvier 2019 au Royaume-Uni), et correspondant sportif en Europe du Wall Street Journal, Joshua Robinson revient sur la montée en puissance de cette compétition.
Pourquoi la Premier League (PL) est-elle, selon vous, aujourd’hui le « produit sportif le plus suivi » à l’échelle mondiale ?
Il faut se souvenir qu’au début des années 1990, le championnat le plus coté était la Serie A italienne, qui dominait l’Europe. Mais la PL a fait un travail de rattrapage immense grâce au magnat de la télévision Rupert Murdoch et au groupe Sky. Il a tout misé sur sa certitude que les gens s’abonneraient à son service de télévision par satellite pour suivre le foot. Et il a eu raison.
A partir de là, le prix des droits TV a pu augmenter très rapidement (2,3 milliards d’euros par an pour le cycle 2016-2019) et la PL s’est appuyée avant tout sur l’empire Murdoch.
Il y a aussi le génie de Richard Scudamore, patron de la Premier League depuis 1998, qui prend actuellement sa retraite. Pour lui, la PL est avant tout un vendeur de droits TV. Il a su maintenir une compétition permanente entre les diverses chaînes qui cherchaient à retransmettre les matches. Et puis, il a décidé que la PL vendrait directement ses droits à l’étranger. Aujourd’hui, on peut voir la PL dans 185 pays.
Scudamore a aussi courtisé des actionnaires du monde entier, qui sont arrivés les uns après les autres dans ce marché favorable aux grosses fortunes étrangères.
La PL joue par ailleurs sur une sorte d’anglophilie. C’est bien plus facile pour un supporter à Pékin, New York ou Johannesburg de se faire une idée de Liverpool ou d’Arsenal que du Borussia Mönchengladbach.
La valeur cumulée des 20 clubs de PL est estimée à plus de 13 milliards d’euros. Elle a augmenté de 10 000 % en un quart de siècle. Quelles sont les autres causes de ce boom ?
Outre les droits télévisés, le profil des actionnaires de PL a évolué. On passe de “self-made-men” plutôt locaux — chefs d’entreprises, gens qui on fait fortune près de chez eux et qui investissaient dans leurs clubs d’enfance — à des actionnaires internationaux, oligarques russes, cheikhs du Golfe, titans d’Asie ou milliardaires Américains (actionnaires principaux de 25 % des clubs).
Qui sont, à vos yeux, les principaux artisans de l’essor de la PL ?
On peut citer David Dein, ex-vice-président d’Arsenal pendant les années 1980 et 1990. Sans lui et son œil sur le sport à l’américaine — le sport est fait avant tout pour les spectateurs, qu’ils soient dans le stade ou devant la télé — la PL n’existe pas.
Il y a aussi Alex Ferguson (manageur de Manchester United de 1986 à 2013), Arsène Wenger (à Arsenal de 1996 à 2018) et José Mourinho : ce sont vraiment eux qui ont fait progresser le jeu anglais tout en construisant le mythe “Best League in the World.” Ils se sont partagés 16 des 17 premiers titres de l’époque PL.
On peut aussi citer le Russe Roman Abramovitch, premier des propriétaires étrangers (Chelsea) à arriver (en 2003) avec une fortune plus large que les autres. Il a bouleversé le mercato et a rappelé à la PL que les titres pouvaient aussi s’acheter.
Comme Abramovitch avant lui, le Cheikh Mansour d’Abou Dabi a changé le marché anglais avec son arrivée à Manchester City en 2008. Il a non seulement dépensé plus d’un milliard de dollars sur les dix dernières années, mais son staff a su pousser le business du foot à l’extrême.
City a bâti son empire international en fondant ou en devenant actionnaire de clubs aux Etats-Unis, en Australie, en Uruguay, au Japon et en Espagne pour devenir la première multinationale du foot.
Quant au « King » Eric Cantona, le foot anglais n’avait jamais vu quelqu’un comme lui. C’était avant la vague de talents internationaux en PL, comme Thierry Henry ou Gianfranco Zola. Cantona avait un talent incroyable à une époque où les Anglais avaient accès à plus de foot à la télé que jamais.
La manne des droits télévisés garantit-elle un équilibre compétitif en PL ?
Le boom des droits télévisés fait que la PL donne plus d’argent à son 20e et dernier club que la Ligue 1 à son champion. Donc on a déjà le système le plus « riche » du football mondial.
Ce qui crée l’équilibre compétitif est la recette originale de la Premier League, écrite en 1992, la formule dite du “50-25-25.” Elle veut que la moitié de ce que reçoit chaque club soit la même pour tout le monde, que 25 % dépendent du classement, et que 25 % dépendent de combien de fois chaque club passe à la télé.
Ce n’est que depuis deux ou trois ans que les clubs du Big Six (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool) estiment qu’ils méritent une partie plus conséquente.
Dans quelle mesure le sacre de Leicester, en 2015-2016, a-t-il constitué une anomalie au sein d’un championnat dominé par ce Big 6 ?
Après le sacre de Leicester, on a assisté immédiatement au moment “L’Empire contre-attaque”. D’un coup, il y a eu l’arrivée de Guardiola (Manchester City), de Mourinho et de Pogba (Manchester United) pour un prix record (plus de 100 millions d’euros). C’est à ce moment-là aussi que les clubs du Big Six ont commencé à râler à propos de la répartition des paiements des droits internationaux de la PL.
Le Big 6 a tout fait pour qu’un « sacre à la Leicester » ne se reproduise pas. Et on voit les effets : il suffit de regarder le classement de Manchester United (6e). Malgré sa pire saison depuis 20 ans, MU reste juste derrière les autres membres du Big 6.
Aucun club anglais n’a remporté la Ligue des champions depuis Chelsea, en 2012, et la PL ne compte à son actif que quatre victoires dans cette compétition depuis 1992. Comment expliquer ce paradoxe ?
La PL n’a peut-être que quatre titres à son actif, mais elle a bien eu sa période de domination. De 2005 à 2009, il fallait passer par un club anglais pour gagner la compétition : cinq finales de suite avec des clubs anglais, dont la finale de 2008 entre Manchester United et Chelsea (victoire des Red Devils aux tirs au but). L’écart entre la PL et le reste de l’Europe était alors le plus marqué.
L’autre facteur décisif est la « difficulté » et l’intensité du championnat. Il n’y a un Big 6 qu’en PL. Les gros matches entre ces clubs représentent un quart du calendrier. Et la PL, contrairement à la Ligue 1, n’est pas prête à sacrifier une affiche du week-end avant un match de Ligue des champions, pour faciliter la tâche de ses clubs.







