Notre sélection 2018 : les articles qui ont marqué la rédaction du « Monde Afrique »
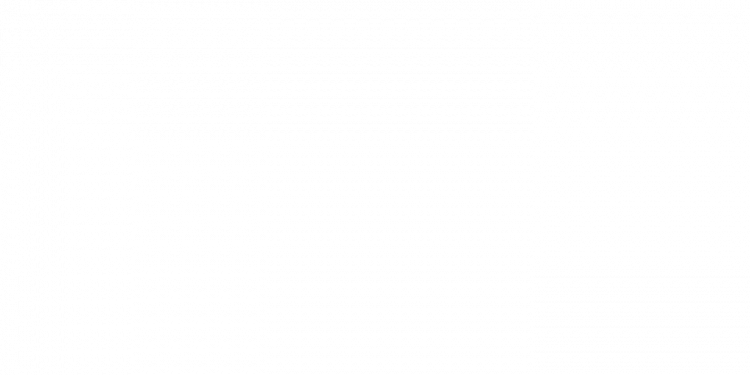
Notre sélection 2018 : les articles qui ont marqué la rédaction du « Monde Afrique »
Parmi les reportages et les rencontres qui ont émaillé l’année, découvrez ceux que leurs auteurs ont particulièrement gardés en mémoire, et pourquoi.
Intéressants à réaliser (et à lire, nous l’espérons !), ils le sont toujours. Des reportages, entretiens, portraits, d’actualité ou au long cours, effectués à Paris ou sur le continent africain. Mais parmi ces articles qui se succèdent, certains ont une résonance particulière parce qu’ils bousculent nos certitudes, qu’ils nous obligent à travailler autrement ou qu’ils nous font rencontrer des personnes bouleversantes. En cette fin d’année, nous avons proposé aux journalistes du Monde Afrique qui le souhaitaient d’en choisir un qui les a particulièrement marqués et d’en raconter les coulisses. L’occasion de relire quelques beaux papiers de 2018, mais aussi de rappeler les questionnements qui ne cessent d’accompagner notre métier.
« Theodor Michael Wonja, dernier survivant noir des camps de travail nazis », par Pierre Lepidi
On n’est plus tout à fait le même après avoir visité un camp de concentration. Parti à Auschwitz avec mes enfants en février, j’ai en tête une question et une promesse dans l’avion du retour. La promesse, c’est d’écrire enfin la vie de mon grand-père maternel, résistant bourguignon, mort dans un camp du nord de l’Allemagne en 1945. L’interrogation qui me taraude, c’est de savoir s’il existe des déportés d’origine africaine encore vivants. Après quelques recherches, je découvre l’existence de Theodor Michael Wonja, un Allemand d’origine camerounaise dont l’autobiographie, Allemand et Noir en plus ! Souvenirs d’un rescapé des camps nazis (Editions Duboiris), est parue en 2016. D’après mon confrère Serge Bilé, auteur de Noirs dans les camps nazis (Editions du Rocher), il serait le dernier.
Par le biais de son éditeur, je contacte M. Wonja qui accepte de me recevoir, mi-avril, dans son pavillon discret de la banlieue de Cologne. J’ai eu l’honneur de passer près de quatre heures en compagnie de cet homme simple et touchant, qui a connu l’horreur des camps de travail nazis après avoir été exhibé dans des zoos humains pendant une partie de son enfance. On ne ressort pas tout à fait le même d’une telle rencontre.
« A Casablanca, les tiraillements d’une famille polygame », par Ghalia Kadiri
Comment décrire une famille invisible ? Un phénomène silencieux, presque insaisissable ? Lorsque l’idée de réaliser une série sur l’amour au Maghreb est lancée, on se dit qu’il faudra raconter ces jeunes couples, d’une génération connectée, qui séduisent et font l’amour différemment, oscillant entre le poids des traditions et la liberté que leur offrent aujourd’hui les réseaux sociaux. Mais on ne peut dépeindre l’amour dans ces pays sans en évoquer l’héritage, et déterrer les tabous qui y sévissent encore.
Au Maroc, la polygamie en fait partie. Si la pratique est de plus en plus rare, elle existe toujours, nichée dans les villages les plus isolés du royaume comme dans la bourgeoisie moderne des grandes villes. C’est justement à Casablanca, la capitale économique du pays, que je décide de raconter une de ces histoires. Dans les beaux quartiers, la rumeur court qu’un mystérieux homme d’affaires vit une idylle avec ses deux épouses. Il refuse de parler. Pour pénétrer l’intimité de ce foyer atypique, j’observe le triangle amoureux de l’extérieur, des jours durant. J’interroge leurs plus proches complices pour parvenir enfin à comprendre comment, en 2018, deux femmes se partagent un homme. Au-delà des apparences, l’idylle n’est que chimère.
« La mémoire blessée de Redeyef, étincelle de la révolution tunisienne », par Frédéric Bobin
Fresque d’Atef Maatallah à Redeyef (Tunisie), en avril 2018. / FRÉDÉRIC BOBIN/LE MONDE
Il faut imaginer une oasis de phosphate cernée de steppe caillouteuse. L’Algérie est toute proche, mystérieuse derrière une ondulation de bosses ocre. Redeyef, c’est l’orée du Sahara, plus au sud, que trahit déjà une lumière tyrannique. Cet horizon de pierres exsude la désolation, l’abandon, et pourtant la révolution tunisienne y a connu ses prodromes. En 2008, trois ans avant le grand ébranlement de 2011, Redeyef s’était dressée contre la malédiction du phosphate et la dictature de Ben Ali. La cité minière a planté les graines d’une épopée qui a fleuri ailleurs et après.
Dix ans plus tard, il fallait y retourner. Comme tant d’autres, j’ai sacrifié au pèlerinage, troublé, décontenancé. Redeyef la pionnière demeure à la traîne, accablée d’amertume. Les dirigeants de la révolte de 2008, tel Adnen Haji, le « Lion des mines », confessent leur désarroi devant tant d’espoirs trahis. Les jeunes filent à Sfax s’embarquer sur des chalutiers vers l’île italienne de Lampedusa. Durant mes entretiens sous les convoyeurs et les passerelles, un homme m’a particulièrement marqué. On s’était retrouvés autour de la table bancale d’un café. Launi a une sacrée gueule. Visage fin encadré d’une barbe foisonnante à la Karl Marx. Il était venu armé d’un manuscrit griffonné de vers. De sa voix douloureusement grave, il avait déclamé cette ode au désir migratoire, scandée sur un rythme de slam : « Ma vie n’a plus de sens/Il faut que je me lance/Je veux tenter ma chance/Que ma torture commence. »
Rencontre avec le romancier sénégalais Cheikh Hamidou Kane, par Coumba Kane
Cheikh Hamidou Kane : « J’ai dû me battre pour accéder à un monde que j’admirais mais qui ne voulait pas de moi »
Depuis son deuxième et dernier roman, Les Gardiens du temple, paru en 1995, Cheikh Hamidou Kane avait disparu de la scène publique et littéraire. Mais l’auteur fait partie du patrimoine littéraire africain. Ce monument bien vivant cultive la discrétion au point que, lorsque l’on tape son nom sur un moteur de recherche, la première occurrence est : « Cheikh Hamidou Kane est-il mort ? » J’ai, comme des générations d’Africains et d’afrodescendants, lu et relu sa première œuvre, L’Aventure ambiguë (1961), roman autobiographique sur l’errance identitaire d’un jeune Sénégalais sous la colonisation. Il me fallait comprendre : pourquoi cet homme – avec lequel, au passage, je ne partage aucun lien de parenté – s’était-il retiré de la vie publique depuis si longtemps ? Et surtout, avait-il trouvé des réponses aux questions existentielles qu’il posait dans ses deux livres ?
Grâce à l’entremise de sa petite-fille, Ndèye Fatou Kane, elle-même écrivaine, j’ai réussi à établir un contact avec lui. Après quelques échanges par mail, il accepta de m’accorder un entretien. J’ai retrouvé Cheikh Hamidou Kane dans sa villa dakaroise. Il venait de fêter ses 90 ans. Lors de cet entretien de près de trois heures, l’écrivain déroula, avec une certaine gaieté, le fil de sa vie. Près d’un siècle d’histoire.
« Les anglophones du Cameroun pris entre les feux de l’armée et des séparatistes », par Cyril Bensimon
Dans les rues désertées de Buéa, la capitale de la région camerounaise du Sud-Ouest, en octobre 2018. / MARCO LONGARI / AFP
Raconter la crise dans les deux régions anglophones du Cameroun, c’est tenir la chronique d’une guerre qui refuse de dire son nom et qui aurait pu être évitée sans trop de difficultés. Lors de mon premier voyage dans cette zone, à Bamenda (Nord-Ouest), en mai 2017, la contestation avait à peine six mois. A la revendication d’une meilleure prise en compte de particularismes linguistique et historique, le pouvoir avait répondu par la répression, emprisonnant les leaders anglophones, coupant l’accès à Internet. Faute de dialogue, les ferments de la lutte armée et d’une radicalisation des esprits étaient alors en train de s’accumuler.
Octobre 2018. Alors que le Cameroun se prépare à réélire une nouvelle fois Paul Biya, le basculement dans la guerre s’est opéré. Aller à Buéa, la capitale de la région du Sud-Ouest, n’est pas difficile. La ville est à une heure de voiture de Douala. Cependant, les autorités camerounaises s’efforcent de décourager les observateurs de s’y rendre au motif que « des bandits et des terroristes pourraient s’en prendre à [eux] ». A la différence de bien des mouvements rebelles, les indépendantistes, éparpillés en petits groupes, ne font rien pour plaider leur cause auprès des médias. Le conflit se joue donc à huis clos, ne laissant filtrer sur les réseaux sociaux qu’un flux d’images d’une grande violence mais dont il est souvent difficile d’assurer la véracité. D’où la nécessité pour les journalistes de s’y rendre.
« Petite fille noire cherche poupée qui lui ressemble… vraiment », par Sandrine Berthaud-Clair
La poupée Neyla de la marque Urbidolls, créée par la Franco-Sénégalaise Rokhaya Diop. / Alvina Diop/Urbidolls
Quand on m’a proposé de travailler sur l’émergence du marché des poupées noires, j’ai tout de suite su que c’était un bon sujet. Pourtant, je ne m’étais jamais demandé si les mamans d’enfants noires ou métisses avaient des difficultés à dégoter un poupon qui ressemble à leur enfant. Parce que je suis blanche, parce que mes enfants sont blancs et parce que, lorsque je cherche dans un magasin des jouets auxquels ils peuvent s’identifier, je n’ai aucun mal à en trouver. Je fais attention aux questions de genre, mais je n’avais jamais réalisé à quel point leur environnement de jeu était aussi peu représentatif de la diversité dans laquelle ils évoluent.
Car la question des poupées noires et métisses ne renvoie pas seulement au choix restreint proposé aux enfants « de couleur ». Interviewer ces nouvelles créatrices, drôles, inventives, décomplexées, permet de comprendre à quel point la problématique du cheveu crépu est centrale chez les fillettes pour construire leur fierté de la beauté noire. A quel point la valorisation de traits africains, des modes et des cultures du continent dont elles portent l’histoire à travers celles, complexes et parfois douloureuses, de leurs familles, était incontournable. Mais j’ai aussi compris à quel point je pouvais apprendre à mes propres enfants le respect au travers des jouets avec lesquels ils peuvent rejouer la diversité qu’ils vivent dans la cour de récréation, dans leur classe.
« Quand les Soudan Célestins Music retrouvent à Paris les saveurs de leur Afrique », par Maryline Baumard
Repas des membres du groupe Soudan Célestins Music au restaurant Le Saint-Jean, dans le 18e arrondissement de Paris. / SANDRA MEHL POUR LE MONDE
Pour le sourire d’Hassan… Ce samedi de septembre restera gravé en moi. J’ai vu un réfugié érythréen que Le Monde suivait depuis huit mois se métamorphoser instantanément, en entrant dans un restaurant africain, et retrouver l’aisance que la vie lui avait volée. De réfugié, il est devenu mon guide. On ne lui expliquait plus la vie, les codes, c’est lui qui avait la main. Il savait tout des plats. Je ne savais rien.
Hassan fait partie du projet « Les nouveaux arrivants ». Il est l’un des membres de Soudan Célestins Music, un groupe créé par des réfugiés africains à Vichy, dont le journal a raconté l’intégration pendant plus d’un an. Il est l’un des plus âgés d’entre eux. Sept années d’errance ; un traitement proche de l’esclavage dans les fermes grecques, pour survivre ; un souvenir des trottoirs parisiens en guise de matelas. Et là, tout à coup, dans ce restaurant érythréen du 18e arrondissement, c’est comme si les morceaux de sa vie brisée s’étaient recollés. Un moment magique de 2018. Une preuve de la très grande résilience des migrants.











