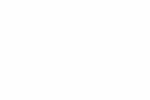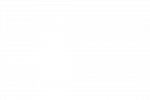Etats-Unis : le blocage sur le « mur » enfonce un peu plus le pays dans l’ornière

Etats-Unis : le blocage sur le « mur » enfonce un peu plus le pays dans l’ornière
Editorial. L’opposition entre Donald Trump et les démocrates illustre l’incapacité des deux camps à discuter sereinement d’immigration depuis des années.
Donald Trump, lors de son allocution télévisée à Washington, le 8 janvier. / Carolyn Kaster / AP
Editorial du « Monde ». « Chacun a droit à ses propres opinions, mais pas à ses propres faits. » La formule de l’ancien sénateur démocrate de New York Daniel Patrick Moynihan n’a cessé de résonner mardi 8 janvier, alors que Donald Trump prenait à témoin son pays à la télévision, campé dans le bureau Ovale. Le président des Etats-Unis avait choisi ce cadre solennel pour plaider une nouvelle fois en faveur du « mur » qu’il veut ériger sur la frontière avec le Mexique.
Cette volonté, à laquelle s’opposent les démocrates, a plongé un quart du gouvernement fédéral dans un shutdown, un blocage dont personne ne voit encore la fin à Washington. Avec un paradoxe saisissant : parmi les premiers concernés figurent ceux qui sont chargés d’assurer la sécurité à cette frontière.
Les arguments du président ont été avancés avec plus de gravité et de sobriété qu’au cours des semaines précédentes, sans pour autant masquer leurs faiblesses. Peut-on parler de « crise » à la frontière, comme il l’a fait, alors que les arrestations de sans-papiers, le meilleur marqueur des passages clandestins, sont parmi les plus faibles de ces vingt dernières années, même si elles sont reparties à la hausse au cours des derniers mois ?
Le vrai, l’incertain et le faux
Pourquoi s’obséder sur cette frontière, alors que la majorité des illégaux entrent aux Etats-Unis grâce à des visas obtenus en bonne et due forme, dont ils ne respectent pas ensuite la date d’expiration ? Pourquoi assurer, comme l’a encore fait le président mardi, qu’un « mur » porterait un coup d’arrêt décisif au trafic de drogue, alors que cette dernière chemine par les points d’accès légaux, noyée dans les flux de marchandises qui transitent vers les Etats-Unis ?
Depuis son élection, Donald Trump est parvenu à brouiller les lignes entre le vrai, l’incertain et le faux. Sa dénonciation récurrente de médias, assimilés en bloc à un « ennemi du peuple », a participé du même calcul, permettant selon lui de s’affranchir des faits au profit de slogans plus conformes à ses vœux, singulièrement sur l’immigration, présentée comme un péril existentiel.
Ce projet, soutenu par quelques médias complaisants, se heurte cependant à une opiniâtre et incommode réalité. En dépit du matraquage présidentiel, une nette majorité d’Américains restent peu convaincus de la nécessité d’un ouvrage d’art qui ne serait certainement pas sans effets, mais dont le rapport entre les avantages et les coûts n’a jamais fait l’objet d’un débat. Parce qu’il reste avant tout une promesse de campagne non tenue, destinée uniquement à satisfaire une clientèle électorale.
La fétichisation de ce « mur » n’épargne pas les démocrates, mais dans le sens opposé. En 2006, Barack Obama, Hillary Clinton et l’actuel chef de la minorité démocrate, Chuck Schumer, avaient voté au Sénat en faveur d’une clôture partielle sur cette même frontière, certes sans commune mesure avec l’ouvrage pharaonique envisagé par Donald Trump. Aujourd’hui, par leur opposition inflexible et la dénonciation d’un projet présenté comme « immoral », ils donnent de la substance à l’argument de Donald Trump selon lequel ils y sont opposés aujourd’hui uniquement parce que lui le défend.
Les Etats-Unis pâtissent depuis des années de leur incapacité à discuter sereinement d’immigration. George W. Bush puis Barack Obama s’y sont essayés, en vain. Mais, loin d’apporter à Washington un talent de négociateur, leur successeur, champion autoproclamé des deals mais prompt à exciter les peurs, ne fait qu’enfoncer plus profondément son pays dans l’ornière.