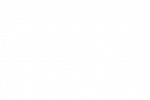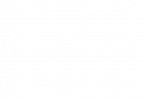Orientation : la voie du cœur ou celle de la raison ?

Orientation : la voie du cœur ou celle de la raison ?
Par Marine Miller
Le temps de l’orientation est un moment crucial dans la vie des familles, entre angoisse du déclassement social et volonté de faire les meilleurs choix. Parents et enfants (se) racontent.
Marion Laurent
Lycéens, étudiants, professeurs, parents, jeunes diplômés... « Le Monde » vous donne rendez-vous en 2019 à Saint-Etienne, Marseille, Nancy, Paris et Nantes pour de nouvelles éditions des événements O21 /S’orienter au 21e siècle. Des conférences et des rencontres inspirantes pour penser son avenir et trouver sa voie. Plus d’informations ici.
« Les voies de garage étaient la hantise de mes parents, se souvient Hélène (le prénom a été modifié). Il leur fallait le bac qui permettrait d’ouvrir toutes les portes : le bac scientifique. J’ai donc décidé que mes notes ne dépasseraient pas 5/20 en mathématiques. Du coup, ils m’ont inscrite en ES. Quand j’ai voulu aller en fac de sociologie, là encore impossible : “Tout le monde va en sociologie, surtout les moins bons”, me disaient-ils. A défaut, je me suis inscrite en géographie. » Cette docteure en géographie raconte comment, tout au long de son parcours scolaire et universitaire, elle a écouté, mais néanmoins contourné la volonté parentale pour arriver à ses fins et devenir enseignante-chercheuse en géographie… socioculturelle.
L’orientation est un moment crucial dans l’histoire des familles. Un moment qui catalyse des craintes irrationnelles : peur de voir son enfant « rater sa vie », qui se conjugue à une peur du déclassement social, dans un contexte économique où le chômage des moins de 25 ans dépasse toujours les 20 %, et où 8,8 % des diplômés de bac +2 et plus sont en recherche d’emploi, selon les chiffres 2017 de l’Insee.
Choisir une orientation est aussi un moment cathartique pour les parents. « Les parents revivent leur propre histoire à travers celle de leur enfant : ce qu’ils auraient eu envie de faire ou la liberté qu’on ne leur a pas donnée, indique Myriam Pinard, psychologue au Centre d’orientation et d’examens psychologiques (Corep) qui accompagne chaque année 2 500 familles. Ils ressentent aussi l’angoisse face au chômage et à un monde du travail plus dur. La problématique de l’orientation, ce n’est pas seulement celle du jeune, c’est celle de toute la famille. »
La peur du « mauvais bac »
Pour les parents qui ont répondu à l’appel à témoignages lancé par Le Monde, difficile d’admettre qu’ils exercent « une pression » sur leur enfant. Néanmoins, la simple « crainte » de passer « le mauvais bac », en particulier le bac L (littéraire), revient sans cesse. « Notre fille aînée a désiré faire un bac L. Nous craignons que cela lui ferme beaucoup de portes pour ses études », s’inquiète ce père de famille de 48 ans originaire de Toulouse. Ou cette mère, dont la fille, très douée en mathématiques et en sciences, décide de faire des études littéraires : « Je n’ai rien compris et j’ai vu tout son avenir s’effondrer. J’ai essayé de la dissuader en lui exposant les belles carrières qui pourraient s’offrir à elle, mais elle est restée campée sur ses positions. »
Quand ce ne sont pas les parents, ce sont les professeurs eux-mêmes qui insistent pour que les très bons élèves en 2de choisissent une filière scientifique. « L’une de mes filles, excellente élève, souhaitait aller en L plutôt qu’en S, expliquant qu’elle ne voulait être ni ingénieure ni médecin. Nous avons été convoqués par sa professeure principale qui, à défaut de la convaincre, l’a suppliée de prendre au moins l’option maths », rapporte Ariane.
« Dans l’esprit des parents, les filières littéraires sont dévalorisées parce qu’elles offrent moins de débouchés dans le supérieur et sur le marché du travail, confirme Sophie de Branche, directrice du Corep et spécialiste de l’orientation. C’est à cela que répond en partie la réforme du lycée, qui fera disparaître en 2021 les filières S, ES et L. » En revanche, ce qui ne changera pas, selon elle, ce sera « l’angoisse » au moment de choisir les enseignements de spécialité qui succéderont aux filières.
Néanmoins, forcer un enfant à s’engager dans une orientation qui lui déplaît est un « mauvais calcul pour les parents », estime Sophie de Branche : « Si vous obligez un enfant à s’orienter dans une filière avec un nombre d’heures élevées dans une discipline qu’il n’aime pas, vous mettez en place une stratégie d’échec. L’enfant peut se dégoûter et échouer. »
Une autre forme de pression consiste à déclarer « vouloir le mieux » pour son enfant tout en lui laissant l’impression de décider par lui-même. Cette jeune diplômée de 25 ans qui travaille dans un cabinet de conseil explique que son père, « grâce à un petit mélange subtil de pression et de soutien, [l]’a aidée à intégrer Sciences Po Paris ». Après quelques stages dans des entreprises du CAC 40 et dans une ambassade, dont elle ressort « blasée » et « désespérée » du monde du travail, elle réfléchit à une réorientation. « Sur l’insistance de mon père, je commence à envisager de faire un master complémentaire en école de commerce », témoigne-t-elle. Admise à l’ESCP, elle sent une « pointe de déception » de la part de son père, médecin, qui la rêvait plutôt entrant à la London School of Economics and Political Science, dans la capitale anglaise, ou, au moins, à HEC, « si vraiment il fallait rester en France ».
Pas de droit à l’erreur
Ainsi, « plus on est issu d’une famille favorisée, plus on aura d’échanges avec son père et sa mère concernant l’orientation », rappelle Agnès van Zanten, sociologue, directrice de recherche au CNRS et enseignante à Sciences Po, qui travaille depuis plusieurs années sur les stratégies d’orientation. « Les parents des familles favorisées tentent toujours d’influer sur les choix de leurs enfants, sauf qu’ils sont plus habiles et qu’ils ont développé des stratégies indirectes pour éviter l’autorité verticale », précise la sociologue. Les familles populaires font, elles, davantage confiance à l’institution et à l’établissement pour orienter leurs enfants.
Dans les situations les plus difficiles, la course à l’excellence peut se transformer en handicap et générer une anxiété contre-productive pour les lycéens. « Depuis petit, on me prédisait un avenir où je serais ingénieur, architecte, médecin ou avocat. Mes parents m’ont conditionné pour que je fasse une filière scientifique pour entrer en Paces [première année commune aux études de santé] où j’ai échoué. Je suis maintenant en première année de droit, en attendant de pouvoir valider des enseignements pour revenir en médecine. Dans le pire des cas, celui où je n’arriverais pas à basculer en médecine, je pourrais toujours continuer des études pour être avocat. Cette pression de fierté et d’honneur me brise », se désole Amine (le prénom a été modifié), 19 ans, étudiant à l’université de Saint-Etienne.
Pour d’autres, l’influence des parents est déterminante dans un parcours prestigieux. « J’étais peu sûre de moi, malgré de bons résultats dans mon lycée de province. J’envisageais de postuler dans une école d’ingénieurs postbac. C’est ma mère qui, avec douceur, me poussait plutôt à faire une classe prépa, où j’ai réussi bien mieux que je ne l’espérais », confie Marion Ghibaudo qui, avec le recul de sa trentaine, estime avoir eu le syndrome « très féminin » de l’autocensure. Admise à Polytechnique, la grande école d’ingénieurs lui ouvre toutes les portes : financement de thèse, réseau, démarrage de carrière dans un grand groupe, etc. « Ce travers de l’autocensure féminine, je l’ai retrouvé chez d’autres jeunes femmes. J’encourage tous les parents à accompagner leurs enfants sans brusquerie », conseille-t-elle.
Les parents ont-ils raison d’être anxieux ? Pour Agnès van Zanten, cela ne fait aucun doute, car en France le modèle est celui du « one shot ». Pas de droit à l’erreur. « Le niveau de sortie des études supérieures conditionne le niveau d’entrée sur le marché du travail. Il vaut mieux avoir un diplômé élevé tout de suite, car les passerelles sont étroites et concernent assez peu de personnes. Il y a toujours peu de mobilité intraprofessionnelle. Ainsi, si on ne commence pas cadre, il est plus difficile de le devenir par la suite », affirme la chercheuse. C’est pour cela que les familles favorisées encouragent davantage leur enfant à valider un niveau d’études – le master – plutôt qu’une discipline.
En chiffres
30 %
C’est le – faible – pourcentage de femmes parmi les diplômés des écoles d’ingénieurs. En France, même si les lycéennes représentent près de la moitié des effectifs des terminales scientifiques, elles ne sont qu’une sur dix à poursuivre leurs études dans ces écoles. Les femmes n’étaient même que 15 % à intégrer la promotion 2016 de Polytechnique. Plutôt renvoyées à des stéréotypes sur le soin aux autres, à la vie familiale et à la santé (elles sont 85 % dans les formations paramédicales et sociales), les étudiantes ont tendance à se brider dans le domaine des sciences dites « dures ». Des préjugés tenaces qui ne se résorbent que très lentement : les effectifs féminins dans les écoles d’ingénieurs sont passés de 22 % à 27 % en l’espace de vingt ans.
20 %
Moins d’un quart des élèves de milieux populaires discutent régulièrement d’orientation sous le toit familial, selon une étude d’Agnès van Zanten, directrice de recherche à l’Observatoire sociologique du changement (CNRS/Sciences Po Paris). Quant aux lycéens issus des catégories socioprofessionnelles privilégiées, ils sont deux tiers à parler fréquemment de leur orientation, mais aussi de leur carrière, avec leur famille. Selon la chercheuse, les lycéens qui reçoivent le moins de conseils à la maison sont aussi, le plus souvent, ceux qui sont les plus mal lotis sur ce point-là à l’école.