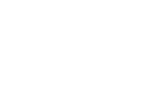En Afrique, le mécénat culturel avance à pas feutrés

En Afrique, le mécénat culturel avance à pas feutrés
Par Roxana Azimi
En l’absence d’incitations financières, les philanthropes africains qui soutiennent l’art sont encore peu nombreux et, souvent, préfèrent rester discrets.
Aux Rencontres africaines de la photographie de Bamako, au Mali, le 2 décembre 2017. / HABIBOU KOUYATE / AFP
Existe-t-il un mécénat culturel à destination de l’Afrique ? Rien d’évident a priori, puisque les grands de la philanthropie ne centrent pas leur générosité sur ce secteur. La fondation du milliardaire nigérian Tony Elumelu a ainsi dépensé 25 millions de dollars (environ 22 millions d’euros) pour soutenir de jeunes entrepreneurs, tandis que le baron minier sud-africain Patrice Motsepe a donné la moitié de sa fortune à une fondation caritative qui porte son nom et finance l’éducation et la création d’emplois, plutôt que la peinture ou la sculpture.
Mais si le club des hyper-riches africains semble laisser l’action artistique aux bons soins de groupes étrangers comme Total ou Orange via leurs fondations, il serait faux de penser que le mécénat culturel privé est inexistant en Afrique. En fait, il serait plutôt silencieux. « Beaucoup font du mécénat sans le savoir, sans contrepartie, et ne jugent pas utile de se mettre en avant », observe l’entrepreneur sénégalais Amadou Diaw, 57 ans, fondateur du Musée de la photographie de Saint-Louis. Leur discrétion s’explique parce qu’« ils ne veulent pas être harcelés », ajoute la Franco-Béninoise Marie-Cécile Zinsou, dont la fondation du même nom, à Cotonou, repose à 70 % sur des dons africains.
Rares avantages
Le mécène africain répugne souvent à communiquer son budget et fait peu de cas des exemptions qu’autorise parfois ce geste. Rares sont en effet ceux qui bénéficient d’avantages fiscaux… du moins lorsque ceux-ci sont prévus. Au Bénin, où la Fondation Zinsou a vu le jour en 2005, aucune loi n’encourage le mécénat. Pas plus qu’à Madagascar, où la Fondation H, créée par Hassanein Hiridjee, soutient les jeunes artistes moyennant un budget de 250 000 euros les deux premières années.
Au Maroc, les sociétés peuvent en théorie déduire les dons de leur résultat fiscal, dans la limite de 0,2 % du chiffre d’affaires. Mais seules les fondations reconnues d’utilité publique bénéficient d’une défiscalisation. Tel n’est pas le cas de la Fondation Alliances, créée en 2009 par le magnat marocain de l’immobilier Mohamed Alami Lazraq. « Mon père voulait rassembler sous le même toit tout ce qu’il faisait, le mécénat culturel comme l’éducatif », explique son fils Othman, 29 ans, à la tête de cette structure qui a notamment apporté sa contribution à la Biennale d’art contemporain de Dakar et aux Rencontres africaines de la photographie de Bamako.
Au Sénégal, Amadou Diaw non plus n’a pas attendu les avancées juridiques pour pratiquer la philanthropie. Avec un groupe d’entrepreneurs locaux, il a monté une association qui, en vingt ans, a apporté près de 10 milliards de francs CFA (plus de 15 millions d’euros) à des actions éducatives. Depuis deux ans, lui-même a réorienté son mécénat vers la culture, en finançant de sa poche la restauration de bâtiments anciens à Saint-Louis.
Redressements fiscaux
Ces généreux donateurs ont beau combler les manques de l’action publique, leur chemin reste pavé de difficultés. A Madagascar, le manque de stabilité politique refroidit les élans. Marie-Cécile Zinsou se souvient pour sa part de l’incrédulité générale qui a accompagné le lancement de sa fondation. « On nous disait qu’on n’aurait pas de visiteurs, que les Africains n’aimaient pas lire, qu’ils n’aimaient pas l’art… Et pourtant, en trois mois, on a eu plus de 10 000 personnes ! », se réjouit-elle, même si ses rapports avec l’Etat béninois restent tendus au point qu’en 2018, la fondation a connu pas moins de cinq redressements fiscaux. « C’est un bras de fer constant. Les attaques politiques rejaillissent sur nous alors qu’on ne fait pas de propagande politicienne. Aujourd’hui, être mécène est un acte de résistance », conclut-elle.
Une résistance dont l’amplitude peut varier d’une année sur l’autre… La richesse des fondations d’entreprise dépend en effet des résultats des sociétés qui les abondent. « Certaines années, on ne peut pas donner, admet Othman Lazraq. Quand il y a eu une crise de l’immobilier, c’était compliqué. » Pas simple, dans ces conditions, d’élaborer des programmes d’investissement et de convaincre d’autres financiers de s’intéresser à la culture.
« L’immense majorité des Sénégalais, même chez les plus aisés, ne voient pas en quoi l’art peut participer à l’économie, déplore Salimata Diop, directrice du Musée de la photographie de Saint-Louis. Je pense néanmoins que nous sommes à l’aube d’une ère nouvelle. La classe aisée et la classe moyenne voient émerger des gens doués en affaires, qui ont construit de grands projets et qui investissent de grandes sommes dans la culture. » Marie-Cécile Zinsou en est elle aussi convaincue : « Depuis trois, quatre ans, la jeune génération qui a 25-30 ans a envie de soutenir la culture, parce qu’elle-même n’a pas été soutenue. Et elle veut s’engager dans du concret, comme le bus que nous avons mis en place pour aller chercher les enfants gratuitement dans les écoles. »
« D’autres suivront »
Collectionneur depuis moins de dix ans, Hassanein Hiridjee, 43 ans, président du conseil d’administration de l’opérateur télécoms Telma, a lui aussi foi dans l’avenir. Après avoir lancé un prix pour les jeunes artistes, il a financé en 2018 l’exposition « Madagascar, Arts de la Grande Ile » au musée du Quai Branly, à Paris. Aujourd’hui, il rêve de jeter les bases d’une école d’art dans son pays. « Pour le moment, seules quelques grandes familles malgaches soutiennent la culture, mais d’autres suivront », veut-il croire. Pour cela, il lui faut l’aide des autorités, afin de mettre en place un plan stratégique sur cinq ou dix ans. De là à penser que le mécénat privé en Afrique ne peut faire l’économie d’une implication des pouvoirs publics, il n’y a pas loin.