Fantômes du Mississippi, sociologie d’une crèche, coptes-catholiques d’Egypte : notre semaine littéraire
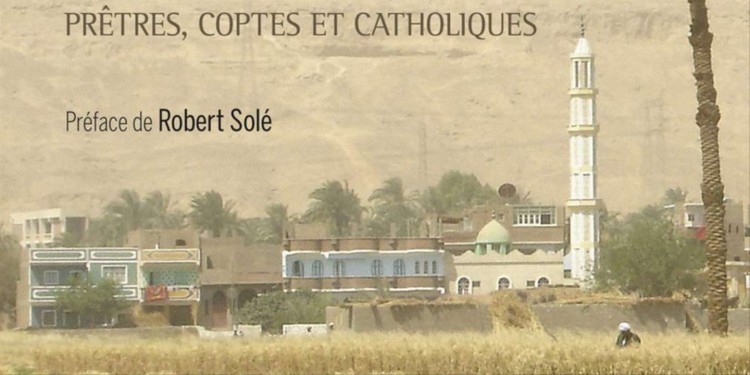
Fantômes du Mississippi, sociologie d’une crèche, coptes-catholiques d’Egypte : notre semaine littéraire
Chaque jeudi, la rédaction du « Monde des livres » vous propose ses coups de cœur de la semaine.
LES CHOIX DE LA MATINALE
Plongez dans un autre monde et une autre époque avec Kiosque de Jean Rouaud qui nous donne à voir son « théâtre de marionnettes », celui qu’il fréquenta sept années durant, à Paris. Partez aussi à la découverte des coptes-catholiques d’Egypte avec l’essai de Catherine Mayeur-Jaouen sur cette minorité et comprenez les crises de l’Egypte actuelle. Enfin, redécouvrez l’enfance et comment la crèche est un lieu d’apprentissage du partage et l’« énergie sociale » qui s’y développe.
ROMAN. « Le Chant des revenants », de Jesmyn Ward
Peut-on échapper aux fantômes du Sud des Etats-Unis et protéger ceux que l’on aime ? Telle est la question que Jesmyn Ward sonde dans Le Chant des revenants, récompensé en 2017 par le National Book Award.
La trame de ce troisième roman de l’écrivaine née en 1977 est, pour l’essentiel, constituée d’un road-trip à travers le Mississippi rapporté par trois voix : celles de Leonie, Jojo et Richie. La première est une jeune mère noire, traumatisée par la mort de son frère et accro à la drogue depuis que son mari blanc, Michael, est en prison ; Jojo, leur fils aîné, est conscient que ses parents s’aiment plus que lui et sa petite soeur Kayla ne les aiment ; enfin, Richie, un jeune garçon mort des années plus tôt, fut codétenu au pénitencier de Parchman avec Papy, le grand-père de Jojo.
Les inégalités, le racisme, les morts brutales de jeunes Noirs, les mères adolescentes, cet héritage que l’auteure qualifiait de « bordel » dans son récit autobiographique, Les Moissons funèbres (Globe, 2016), se retrouvent dans Le Chant des revenants. Sa forme polyphonique permet à Ward d’entremêler le parler populaire et les tons – direct pour Jojo, tourmenté chez Leonie, légendaire chez Richie –, avec des métaphores baroques. Jesmyn Ward tisse les voix comme elle tisse passé et présent, mythe et actualité, dans ce roman magistral dont la mémoire est à la fois la matière et ce qu’elle déclenche en nous. Gladys Marivat
« Le Chant des revenants » (Sing, Unburied, Sing), de Jesmyn Ward, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé, Belfond, 272 p., 21 €.
« Le Chant des revenants » (Sing, Unburied, Sing), de Jesmyn Ward, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé, Belfond, 272 p., 21 €.
ESSAI. « Voyage en Haute-Egypte », de Catherine Mayeur-Jaouen
« On s’attendait à lire une étude savante sur le clergé d’une Eglise minoritaire, et c’est tout un peuple qu’on découvre », écrit Robert Solé en préface de Voyage en Haute-Egypte.
A vrai dire, on a droit aux deux. Dans les chapitres introductifs, Catherine Mayeur-Jaouen offre la synthèse des connaissances sur l’origine et l’évolution des coptes-catholiques d’Egypte, ce qui fait de son livre la seule source accessible en français sur cette histoire. Mais les chapitres suivants, consacrés à la vie dans les paroisses de Haute-Egypte, peuvent se lire à part, si l’on veut sauter tout de suite à la question qui porte l’ensemble : qu’ont à nous apprendre, sur la vie des Egyptiens d’aujourd’hui, les plus invisibles d’entre eux ?
L’une des belles réussites du livre est de démontrer par l’exemple la fécondité de cette approche. La manière dont un pays traite ses minorités, les relations que celles-ci entretiennent entre elles et avec la majorité… : les sujets qui se retrouvent au centre de l’enquête jettent une lumière crue sur les crises de l’Egypte actuelle, entre tensions religieuses et montée de la pauvreté, dont les coptes-catholiques sont, dans les deux cas, des victimes prioritaires. Mais des victimes fort peu consentantes, comme le montre l’auteure, qui témoigne de la vitalité d’une communauté profondément engagée dans la lutte pour la dignité et l’égalité. Laquelle vaut, elle aussi, pour le peuple égyptien tout entier, à l’heure des replis et des horizons bouchés. Florent Georgesco
« Voyage en Haute-Egypte. Prêtres, coptes et catholiques », de Catherine Mayeur-Jaouen, préface de Robert Solé, CNRS Editions, 416 p., 26 €.
« Voyage en Haute-Egypte. Prêtres, coptes et catholiques », de Catherine Mayeur-Jaouen, préface de Robert Solé, CNRS Editions, 416 p., 26 €.
RÉCIT. « Comme à la guerre », de Julien Blanc-Gras
« Sommes-nous en guerre ? », se demande, plus d’une fois, le narrateur de ce livre commencé au lendemain des attentats de janvier 2015 et de la naissance de son fils. « Un truc de vieux », la guerre. Comment expliquer à son garçon que dans la ville où ses parents ont choisi de le faire naître, des « abrutis ont massacré des gens parce qu’ils faisaient des dessins » ?
Julien Blanc-Gras s’essaye à répondre à ces questions avec beaucoup d’autodérision, alternant des chapitres de pure comédie et des passages plus graves, notamment consacrés à ses deux grands-pères qui ont combattu pendant le second conflit mondial. Durant plusieurs pages, il se tait, les laisse raconter, comme s’il n’y avait rien d’autre à faire. Les voix se mêlent : celle du quadragénaire bourlingueur, celle de son fils apprenant à poser ses premiers mots, celles de soldats d’une autre époque.
Toujours sur le fil du cliché (avec lequel il joue malicieusement), Julien Blanc-Gras doit son salut à un art consommé du mot juste, sincère, et à un humour qui ne le quitte jamais tout à fait. Mais le talent de l’écrivain, ici, est de ne pas s’en tenir à son sens (certain) de la formule.
Tout l’enjeu du livre est dans l’oscillation, le flou, les ridules à la surface de l’eau, une fois lâchée une phrase apparemment définitive. La construction procède par échos, par déformations, chassant une idée après l’autre, sautant du coq à l’âne mais sans jamais perdre le fil. Loin d’être pessimiste, Comme à la guerre est au contraire un livre d’une rare sensibilité et d’un rare enthousiasme. Après tout, maintenant que ce fils est né, il va bien falloir lui léguer le monde. Nils C. Ahl
« Comme à la guerre », de Julien Blanc-Gras, Stock, 288 p., 19,50 €.
« Comme à la guerre », de Julien Blanc-Gras, Stock, 288 p., 19,50 €.
ROMAN. « Kiosque », de Jean Rouaud
Le kiosque déborde de journaux. C’est un casse-tête de les ranger pour qu’ils y tiennent tout en restant accessibles aux éventuels clients, et cette surabondance rend difficile, chaque matin, l’ouverture. Autant dire que, dans Kiosque, Jean Rouaud, qui travailla dans celui du 101, rue de Flandre, Paris 19e, entre 1983 et 1990, dépeint un monde disparu. Celui d’une presse encore triomphante, qui attirait toute une petite foule, chaque jour, devant son « théâtre de marionnettes ».
De ces hommes et de ces femmes venus de partout, aux opinions politiques si diverses, l’auteur dresse des portraits superbes, non dénués d’humour, tout en empathie. Des portraits qui racontent cette époque et les soubresauts de la planète – parfois annoncés par ses clients avant d’apparaître dans les journaux – en même temps qu’ils paient leur dette à tous ces personnages (en commençant par son « patron » kiosquier, P.), dont la fréquentation acheva de faire de l’auteur un romancier, en l’obligeant à se confronter au réel.
Tout autant exercice de gratitude, d’humilité, que poursuite d’une constante réflexion sur la littérature, Kiosque vitupère l’idéologie de la « modernité » artistique, mais la nostalgie qui nimbe ce texte a l’élégance de ne jamais virer à la déploration. En racontant comment il est devenu écrivain, ce cinquième tome de La Vie poétique montre aussi, en particulier dans certains passages magnifiques de simplicité, quel formidable écrivain Jean Rouaud est devenu. Raphaëlle Leyris
« Kiosque », de Jean Rouaud, Grasset, 284 p., 19 €.
« Kiosque », de Jean Rouaud, Grasset, 284 p., 19 €.
SOCIOLOGIE. « Prendre », de Wilfried Lignier
Le sociologue Wilfried Lignier a consacré pour ce livre une année de recherches aux crèches dans lesquelles sont accueillis les enfants de 2 ans ou 3 ans. Plus précisément, à un geste particulier que les enfants accomplissent en permanence dans ce type de lieux : celui de prendre (des objets principalement) et par la suite de donner ce que l’on a pris, de le garder ou de l’échanger.
L’auteur excelle à faire sentir « l’énergie sociale » qui émane de la crèche et préexiste aux pratiques des enfants. Cette énergie est le plus souvent canalisée par la crèche elle-même : on y apprend de façon très codifiée qu’il faut partager et comment on doit prendre les choses sans agresser autrui.
Mais il s’y joue également d’autres processus sociaux tout aussi formateurs pour les enfants. La reproduction des inégalités est de ceux-là. Dans la crèche qu’a étudiée le sociologue cohabitent des enfants de milieux sociaux distincts, privilégiés et défavorisés. Leur rapport à la « prise » est profondément différent. Les premiers semblent moins « inquiets » lorsqu’ils se voient privés temporairement d’un objet, alors que les seconds manifestent fréquemment une « impatience distinctive ».
La sociologie a encore beaucoup de chemin à parcourir pour comprendre tout ce qui se joue dans ces premières prises enfantines. Mais en redonnant de la grandeur aux actes quotidiens et banals des plus petits, en montrant comment, dès la prime enfance, « le geste qui nous porte vers les choses est un geste social », Wilfried Lignier accomplit un pas notable dans cette direction. Gilles Bastin
« Prendre. Naissance d’une pratique sociale élémentaire », de Wilfried Lignier, Seuil, « Liber », 328 p., 24 €.











