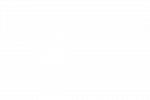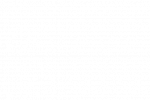Depuis la révolution de 2011, le cinéma tunisien renaît

Depuis la révolution de 2011, le cinéma tunisien renaît
Par Mohamed Haddad (Tunis, correspondance)
Huit ans après la chute du régime de Ben Ali, l’industrie du 7e art tunisien se porte de mieux en mieux et plusieurs films connaissent de francs succès.
Avant-première du film « Dachra » d’Abdelhamid Bouchnak, le 15 janvier 2019, à l’opéra de la Cité de la culture de Tunis. / Shkoon Production
Plus de 100 000 entrées en deux semaines pour Dachra, premier film d’horreur tunisien et premier long-métrage d’Abdelhamid Bouchnak. Un nombre doublé quelques semaines plus tard. Regarde-moi de Nejib Belkadhi, sorti en 2018, a quant à lui dépassé les 125 000 entrées, et plus de 80 000 tickets ont été vendus pour La Belle et la meute de Kaouther Ben Hania, sorti en 2017. Fleur d’Alep de Ridha Béhi, Hedi, un vent de liberté de Mohamed Ben Attia ou Jaida de Selma Baccar, sortis après 2011, ont eux aussi connu de francs succès. Une chose est sûre, les films tunisiens font désormais recette, même s’il est difficile d’avoir des chiffres précis en l’absence de billetterie unique.
Les distinctions ne manquent pas
« Nous sommes en plein tournage des feuilletons de ramadan avec un seul machiniste, alors qu’il nous en faut trois ! » Imed Marzouk, à la tête de la société de production audiovisuelle Propaganda Production, ne s’en désole pas mais s’en réjouit. Et ce n’est pas seulement grâce à l’approche du ramadan, où à la rupture du jeûne les familles tunisiennes se réunissent devant la télévision, qui monopolise les 700 techniciens du secteur. C’est aussi grâce au regain d’intérêt des grosses productions étrangères.
DACHRA دشرة de Abdelhamid Bouchnak | Bande-annonce officielle
Durée : 01:58
« Nous assurons parallèlement le tournage d’un film italien. D’autres producteurs locaux travaillent avec Netflix sur une série historique à 30 millions de dollars [près de 27 millions d’euros], sans oublier que la suite de Mad Max devrait être tournée en Tunisie », précise-t-il. La liste est longue selon Imed Marzouk. Selon lui, la production exécutive, une forme de sous-traitance, représente un réel enjeu pour le cinéma tunisien. C’est une transmission de savoir-faire et un vecteur de dynamisme dans le secteur.
L’industrie du cinéma se porte de mieux en mieux et les distinctions ne manquent pas non plus. Depuis 2011, les films tunisiens sont sélectionnés, nommés et parfois récompensés aux festivals de Cannes, Venise, Berlin ou Ouagadougou. Ainsi, la côte monte et pas uniquement derrière la caméra. Le plein-emploi est plutôt chose rare dans une Tunisie qui a habilement contourné les crises politiques depuis le soulèvement de 2011, mais qui peine à répondre aux attentes économiques de ses citoyens.
Une dynamique solide
« En tant que distributeur, je pense que c’est notre mission de rendre les films tunisiens rentables », argumente Kais Zayed, cofondateur de Hakka Distribution en 2013. Il joue un rôle-clé entre les producteurs de films et les spectateurs, et les œuvres tunisiennes représentent plus de 70 % de son chiffre d’affaires qui provient uniquement de la vente de tickets. Pour Kais Zayed, la distribution n’était pas une fin en soi. En 2012, il se lance comme exploitant du Ciné Madart à Carthage, qui propose des films d’auteur, d’art et d’essai. « Mais il y avait une apathie au niveau de l’offre des films que nous voulions projeter », précise-t-il. Porté par les attentes du public et les propositions de producteurs, il crée l’entreprise de distribution qui deviendra partenaire du réseau MK2.
REGARDE-MOI في عينيّا | Bande-annonce officielle
Durée : 02:27
« A Ciné Madart, nous sommes passés de 12 600 spectateurs en 2012 à plus de 50 000 en 2018 », annonce-t-il. La dynamique est solide. Résultat : même le géant français Pathé a inauguré en février le premier multiplex du pays, dont les tickets coûtent environ le double du prix moyen. Un deuxième est en construction à Sousse. « Nous sommes devenus un marché à potentiel et un potentiel marché », estime Kais Zayed.
Pour atteindre ces chiffres, il a fallu chercher un nouveau public. Un défi relevé par Dachra. « On a fait presque 50 000 entrées dans le sud tunisien », s’étonne-t-il, sans parler des semaines de complet à Sousse, Sfax, Monastir, Bizerte… « C’est ma grande surprise et ma fierté. Je me suis rendu compte que le vrai public tunisien n’est pas à la capitale », s’enthousiasme son réalisateur, Abdelhamid Bouchnak.
« Initiateur d’une nouvelle vague »
La joie du réalisateur est d’autant plus grande qu’il a produit ce film à son propre compte. Un pari risqué. « Heureusement que ça a marché, sinon j’aurais eu de gros problèmes financiers, souffle-t-il. Dachra a essayé de créer un nouveau style de production, de nouveau visages, de nouveaux dialogues. » Cela a encouragé d’autres réalisateurs à se lancer dans leurs premiers longs-métrages. « L’objectif du film n’est pas d’être le premier, le seul ou le meilleur, mais d’être l’initiateur d’une nouvelle vague », confie-t-il en plein tournage d’une série télé qui sera diffusée durant le mois de ramadan.
Cette « nouvelle vague » d’artistes, c’est une « lame de fond », commente Kmar Bendana, historienne et membre de la Fédération tunisienne du cinéma amateur depuis les années 1960. « Je vois la révolution dans ce genre de phénomène. On est en train de devenir des sujets politiques. L’art exprimé par des Tunisiens sur la réalité des Tunisiens est en soi une forme de représentativité politique », ajoute-t-elle.
Extrait de "La belle et la meute", de Kaouther Ben Hania
Durée : 01:08
Une révolution culturelle lente, mais certaine face à la torpeur qu’a connue le cinéma tunisien durant la dernière décennie de la dictature de Ben Ali. De nombreuses salles ont fermé. On est passé d’une centaine de salles à l’indépendance pour trois millions d’habitants à une dizaine pour onze millions d’habitants en 2011, indique Hichem Ben Ammar, directeur de la Cinémathèque tunisienne.
« On a tué la poule aux œufs d’or ! »
L’une des raisons de cette désertification cinématographique est l’abandon du rôle de l’Etat dès le début des années 1990, notamment par la privatisation de la Société tunisienne de production et d’expansion cinématographique, une des innombrables conséquences du plan d’ajustement structurel de 1986. « Cette société était déficitaire car elle regroupait toutes les étapes de l’industrie cinéma : production, exploitation, distribution, etc. C’est la distribution qui était rentable. En la privatisant intégralement, on a tué la poule aux œufs d’or !, se souvient le directeur de la Cinémathèque. Ce mastodonte étatique du 7e art a été en partie cédé au magnat du cinéma Tarak Ben Ammar. » Une transaction contestée par le Syndicat des producteurs tunisiens affilié au patronat, au lendemain de la révolution.
L’image des salles en était dégradée. A quelques exceptions près, les cinémas avaient la réputation d’être malfamés, les spectateurs étant attirés par l’obscurité et l’intimité plutôt que par l’écran. Un seul distributeur monopolisait le marché, sans réelle diversité de l’offre et en décalage entre les sorties mondiales et celles en Tunisie. Sans compter l’explosion des antennes paraboliques et du téléchargement sur Internet qui donnaient accès à un flot considérable de films et de séries. Et sans oublier le piratage.
Cette dynamique positive est réelle, mais elle tient sur un fil. D’abord, à cause de la bureaucratie. « Nous avons reçu l’accord pour utiliser un drone un mois après la fin du tournage », se rappelle Imed Marzouk en grinçant des dents. Quant aux hélicoptères, c’est la croix et la bannière. Il critique le manque de conscience étatique des enjeux économiques que représente le cinéma. Ces questions logistiques sont « rapidement traitées au Maroc en revanche », regrette-t-il. Sans oublier le couperet de la sécurité. En effet, « l’attentat-suicide survenu en novembre 2018 à l’avenue Habib-Bourguiba, bien qu’il n’ait causé aucune victime, nous a fait perdre un film américain. Les assurances ne suivent pas et considèrent que le risque est trop important », conclut-il.