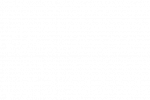A Nairobi, comment les « matatus » ont pris le contrôle de la rue

A Nairobi, comment les « matatus » ont pris le contrôle de la rue
Par Robert Heinze
Gares routières, cœurs battants de l’Afrique (2). Dans la capitale kényane, les transports sont dominés par des minibus informels qui, depuis cinquante ans, entretiennent des relations fluctuantes avec l’Etat.
Un chauffeur de « matatu » à Nairobi, en juillet 2015. / SIMON MAINA / AFP
Dans le centre de Nairobi, capitale du Kenya, l’avenue Moi se métamorphose vite d’une zone calme, bordée de cafés et de boutiques, en une ramification de rues et ruelles bruyantes aux allures chaotiques. Là, des dizaines de minibus bariolés, les matatus, d’où s’échappent des airs de reggae ou de hip-hop kényan, se disputent les places de parking au milieu des motos zigzagantes et des vendeurs à la sauvette chargés de toutes sortes de marchandises. Cette partie de la rue accueille les terminus des matatus, à qui le Central Business District (CBD), le quartier des affaires, reste inaccessible.
Au Kenya, les matatus se développent depuis une cinquantaine d’années. Ce moyen de transport a bénéficié de la faillite de l’urbanisme colonial. A l’époque, Nairobi était très largement ségréguée. Rien n’avait donc été pensé pour circuler librement à travers la ville. Les déplacements y étaient longs et difficiles. Les routes de Kenya Bus Services (KBS), l’entreprise privée qui avait alors le monopole des transports publics à Nairobi, suivaient les grands axes routiers, ne desservant les quartiers africains qu’à leur marge. En outre, les bus de KBS étaient chers, peu confortables et desservaient de nombreux arrêts sans respecter les horaires établis.
Les restrictions imposées par l’Etat en matière de concession de licences aux « véhicules de service public » poussèrent de plus en plus de chauffeurs de taxis à se passer de ladite licence. Et le succès populaire de ceux qu’on a vite surnommés les « taxis pirates » a incité les opérateurs disposant d’une licence à ne plus la renouveler et à continuer eux aussi leur pratique en dehors du cadre légal. Bientôt, donc, les taxis pirates ont concurrencé KBS sur ses propres trajets ; d’autant que ces véhicules pénétraient, eux, dans les quartiers réservés aux populations africaines.
A la fin des années 1960, les taxis pirates ont été rebaptisés matatus, en référence au prix du voyage original de 3 pence (« mapeni matatu » en swahili). Les premières flottes furent progressivement remplacées par des minibus, pour accueillir plus de passagers. Et parce qu’ils ne pouvaient pas suivre les bus de KBS, toujours en activité dans le CBD, les matatus ont pris l’habitude de s’arrêter juste à la limite extérieure du district, aux coins des rues.
Politique d’africanisation
En 1973, le président Jomo Kenyatta a quasiment légalisé ce secteur économique en abolissant officiellement la licence pour les matatus. Ce tournant marqua le début du succès de l’économie informelle dans le pays, avec en tête, justement, le secteur des transports. Les représentants des matatus avaient fait pression sur Jomo Kenyatta pour qu’il les accepte comme partie intégrante des transports en commun. Et le gouvernement y vit l’opportunité de mener à bien sa politique d’africanisation qui offrait aux wanainchi (les gens ordinaires) une chance de participer à l’économie.
En parallèle, les opérateurs de matatus ont aussi commencé à réguler leur fonctionnement. Ils se sont organisés en associations pour contrôler l’accès aux terminus ainsi qu’aux routes qu’ils desservaient. Ces organisations, en lien avec l’Etat, ont contribué au renforcement des règlements et se sont associées avec les forces de l’ordre pour endiguer les activités de ceux qui n’étaient pas affiliés. De façon ironique, les opérateurs qui s’étaient établis dans le secteur grâce à la dérégulation se sont employés à autoréguler le secteur et à en interdire l’entrée aux nouveaux venus.
Décoration d’un « matatu » dans une banlieue de Nairobi, en avril 2016. / TONY KARUMBA / AFP
Durant la décennie 1980, la situation a encore évolué. Le gouvernement de Daniel arap Moi a été beaucoup plus hostile aux matatus que ses prédécesseurs. Moi les associait en effet aux forces de l’opposition. Son chef du gouvernement a même ordonné une série de mesures destinées à réguler le secteur des transports artisanaux en rendant obligatoire une « licence spéciale ». Ces mesures ont rencontré un écho favorable dans la population, même si la décennie qui suivit fut une période de conflit ouvert entre les matatus et l’Etat, au point que les associations professionnelles ont déclenché des grèves à plusieurs reprises.
Moi décida finalement de dissoudre les associations en 1989, trois ans avant la tenue des premières élections multipartites. Ce qui donna l’opportunité à d’autres groupes d’investir le secteur. C’est ainsi que, pendant les années 1990, des groupes criminels tels que les Mungiki ont fait leur apparition dans le monde du transport en prenant le contrôle des terminus mais aussi des routes qui y étaient associées. Des membres de ces groupes se sont installés aux différents terminus situés le long des routes et ont commencé à exiger des « frais d’utilisation ».
Contre toute attente, beaucoup de chauffeurs de matatus se sont assez bien accommodés des Mungiki, qui, après avoir (souvent violemment) pris le contrôle d’une route, la géraient finalement sans trop de violences, à l’inverse de la police ou d’autres groupes considérés, eux, comme criminels.
Violent coup de filet
Après un changement de gouvernement en 2002 et un violent coup de filet policier l’année suivante, les Mungiki se sont désengagés de la gestion du réseau de transport de Nairobi. Ce qui laissa place au gouvernement pour coopérer avec deux associations fondées en 1994 et censées être les interlocuteurs de l’Etat à l’échelle nationale dans le secteur. En 2010, une nouvelle législation a introduit une autre forme de gestion du réseau routier, basée sur des sociétés de coopération bancaire. Celles-ci agissent comme assureurs et prêteurs, mais contrôlent aussi l’accès aux routes.
L’une des deux associations des propriétaires de matatus, la Matatu Vehicle Owners Association, demeure aujourd’hui une organisation puissante. Elle est souvent consultée par l’Etat ou par les ONG internationales en matière de gestion des transports en commun à Nairobi. Les conditions d’emploi y sont cependant peu ou pas encadrés par la loi. A ce jour, ni l’Etat kényan ni les propriétaires de matatus n’ont aucune velléité de régulation. Quant aux différentes tentatives des syndicats de mettre la main sur ce secteur, elles ont échoué.
Robert Heinze est chargé de recherche au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (Cessma) de l’université Paris-Diderot.
Cette série sur les gares routières en Afrique subsaharienne a été coordonnée par Sidy Cissokho, chercheur associé au sein du projet African Governance and Space (Afrigos), hébergé par l’Université d’Edimbourg. Elle est la prolongation d’une collaboration avec Michael Stasik lors de la European Conference of African Studies à Bâle en 2017, puis à l’occasion d’un numéro spécial de la revue Africa Today consacré aux gares routières en Afrique.
Sommaire de notre série « Gares routières, cœurs battants de l’Afrique »
A travers le regard de journalistes et d’universitaires, Le Monde Afrique interroge ces lieux de transit qui racontent une tranche de la vie des Kényans, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Béninois, des Ghanéens ou des Sud-Soudanais.