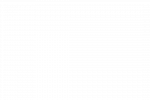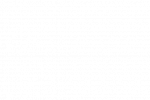« Ma mère m’a appris à être un homme. Pas mon père » : les confidences du poète Benjamin Alire Saenz

« Ma mère m’a appris à être un homme. Pas mon père » : les confidences du poète Benjamin Alire Saenz
Propos recueillis par Pauline Croquet
Auteur du très salué « Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers », le romancier et poète américain d’origine mexicaine a mis la communauté chicano au cœur de ses romans pour adolescents.
Benjamin Alire Saenz, 64 ans, est le premier Américain d’origine mexicaine à avoir reçu le prix littéraire PEN/Faulkner. / Collection pêrsonnelle
Les meilleurs romans d’apprentissage ont la capacité de marquer les lecteurs à tout âge. A l’adolescence, ils vont droit au cœur ; à l’âge adulte, ils reviennent souvent à l’esprit. Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers est de ceux-là. Publié en 2012 aux Etats-Unis, il met en scène l’amitié puis l’amour naissant entre deux lycéens américains d’origine mexicaine qui se rencontrent un été à la piscine.
Benjamin Alire Saenz, l’auteur de ce roman, a toujours été un fronterizo, un frontalier habitant des terres américaines touchant le Mexique, le pays de ses ancêtres. Une situation qui nourrit constamment son travail, qu’il s’agisse de ses écrits de littérature générale ou de ses romans pour adolescents. Le romancier s’est livré au Monde lors de son passage à Paris pour la réédition de son roman en version collector chez Pocket Jeunesse, jeudi 2 mai.
Même si les lecteurs français vous connaissent pour « Aristote et Dante », vous n’avez écrit que tardivement de la littérature pour adolescents. Comment en êtes-vous venu à vouloir écrire pour les plus jeunes ?
Je n’ai jamais eu vraiment l’intention d’écrire pour les jeunes gens. Pis, quand on me demandait si j’aimerais écrire pour eux, j’étais très snob et je répondais : « Non. Je suis un poète. » Je ne lisais pas de romans young adult et donc je ne me rendais pas vraiment compte de ce que c’était. Bien sûr, j’avais lu certains romans d’apprentissage, comme le très beau Une paix séparée (Autrement, 2008), de John Knowles. En revanche, je n’ai jamais trop aimé J. D. Salinger, c’est terrible à dire parce que tout le monde l’adore.
Quand j’étais professeur de littérature à l’université d’El Paso, j’ai demandé à mes étudiants d’écrire une histoire à la première personne. L’un d’entre eux m’a fait justement remarquer que, de tous mes livres, aucun n’était écrit à la première personne. Je m’y suis donc essayé sur un de mes projets de livre où le héros Sammy avait 17 ans [Ce qui donnera par la suite le roman Sammy and Juliana in Hollywood, publié en 2004 aux Etats-Unis]. Et ce récit à la première personne m’a vraiment intéressé quand je me suis rendu compte que j’y mettais une part de mon histoire personnelle. De comment j’ai grandi.
Vos récits ont pour héros des protagonistes chicanos, des Américains d’origine latine, mexicaine dans votre cas. Les Chicanos sont-ils trop peu représentés dans les fictions pour adolescents ?
Ils ne le sont jamais assez, mais ils le sont de plus en plus. Vous savez, je n’aime pas romancer le fait d’être mexicain-américain, mais j’adore l’être. J’ai grandi en parlant deux langues, et celles-ci se battent dans ma tête. Mais elles s’entrelacent aussi. J’ai envie d’en refléter les nuances et les difficultés, les sentiments que cela génère. Aux Etats-Unis, on adore nous représenter mangeant des tortillas et des tamales, écoutant de la musique de mariachis. Mais c’est à nous de raconter notre propre ethnicité. Cependant, je n’écris pas sur ce que c’est d’être mexicain-américain ni sur ce que c’est d’être gay. J’écris juste sur l’expérience d’être.
Aristote comme Dante parlent toutefois souvent dans le livre de ce qu’est être mexicain, d’avoir une double culture. Quelle est votre définition personnelle ?
Je me définis comme chicano, pas vraiment américain et pas vraiment mexicain. A certains égards, je suis très mexicain et je ne suis jamais vraiment considéré comme très américain. Mais quand je vais au Mexique, je parais très américain. J’ai aussi habité en Belgique quatre ans, et là-bas je me suis senti très américain.
Cette identité change constamment. Je pense à l’identité plus comme quelque chose de subjectif, dont je prends conscience sur le moment. Après, la façon dont je me définis a peu d’importance parce que les autres nous appelleront toujours mexicains. On a toujours vécu séparés des gringos, on était un peu plus intégrés à l’école. Je suis entré au lycée en 1968, et j’ai été, par exemple, président de ma promotion au lycée. Mais après les cours, on ne traînait pas avec les gringos, on avait notre propre quartier. Nos vies étaient constamment séparées des Blancs.
Quel genre d’adolescent étiez-vous ?
J’étais un bon élève, même si je n’aimais pas trop le lycée parce que j’estimais que j’allais en cours avec une bande d’abrutis. Dans le quartier où j’ai grandi, on se moquait un peu de moi, mais je n’en avais rien à faire. Des mecs qui se croyaient appartenir à des gangs passaient devant chez moi et me lançaient des noms d’oiseaux pendant que je lisais sur le perron. Je ne prenais même pas la peine de les regarder, je restais le nez dans mon bouquin et je leur faisais juste des doigts d’honneur. Ils ne me faisaient pas peur.
Ah, et aussi je ne voulais pas porter de chaussettes. Et ma mère à ce propos me disait constamment : « les Américains ne font pas ça. » Et je lui demandais : « Si on n’est pas américains que sommes-nous alors ? » J’étais très proche de ma mère. Comme je n’avais pas de bureau dans ma chambre, je faisais mes devoirs sur la table de la cuisine pendant qu’elle préparait le dîner. Et on se parlait beaucoup.
Dans « Aristote et Dante », vous redéfinissez également, à votre façon, la virilité.
Oui, je pense que j’ai grandi sans cesser de penser à ce que signifiait « être un homme ». Mon père voulait tout le temps m’emmener avec lui. Quand on vivait dans une ferme, il voulait m’emmener chasser le cerf, je devais avoir dix ans ; j’ai dit non. Mon père a été très blessé par ce refus, il m’a balancé : « Alors tu vas rester à la maison à traîner dans les jupes de ta mère ? » Ce à quoi j’ai répondu : « maman est de meilleure compagnie. » Il était furieux, il estimait qu’un homme devait préférer rester avec son père.
Mes frères étaient bagarreurs comme lui. Plus tard, quand il me répétait ce genre de choses, je lui demandais : « quel mal y a-t-il à préférer traîner avec maman ? Tu l’as bien épousée ! » D’ailleurs, quand il voulait me blesser, il me répétait : « tu es comme ta mère. » Ce qui ne me heurtait pas, car j’admirais ma mère, Eloisa, plus que mon père.
Il était un homme bien, mais ce n’était pas un bon père. Il buvait beaucoup, il pouvait disparaître pendant deux semaines et rentrer comme si de rien n’était. Je me rappelle d’une fois, j’étais tout petit, on était autour de la table et mon père venait de rentrer. Ma mère était en train de laver le linge et elle a débarqué devant mon père avec une chemise à lui recouverte de maquillage. Et elle lui a dit, sans s’énerver : « Juan, tu crois que je vais laver ça ? », en espagnol, et elle a mis le feu à la chemise avec un briquet. Elle savait s’affirmer. C’est ainsi que ma mère m’a appris à être un homme. Pas mon père.
Une part de ma masculinité a aussi à voir avec le choc post-traumatique que j’ai affronté en étant agressé sexuellement plus jeune. C’est resté longtemps mon secret, et puis j’ai réussi par la suite à me sentir à l’aise dans ma sexualité. Cela a été très compliqué de me dire que j’étais gay, je ne savais pas quoi faire dans la mesure où je n’avais pas confiance dans les hommes, je ne voulais pas être touché par un homme. Mais mon homosexualité m’a permis de réfléchir et de décider quel genre d’homme je voulais être. Pour moi en tant qu’homme, il était important d’être doux, de devenir un intellectuel, de partager mes sentiments, de partager mon savoir avec des plus jeunes.
En tant qu’intellectuel d’origine mexicaine et citoyen des Etats-Unis gay, vous sentez-vous en colère contre la politique de Donald Trump ?
« Colère » n’est pas le mot ; « offense » l’est plus. Quand Trump a comparé les migrants d’Amérique centrale à des animaux, cela m’a énervé aux larmes. C’est un horrible être humain et il est déshonorant. Ma famille était pauvre et d’origine étrangère et elle a toujours été plus civilisée qu’il ne le sera, lui qui a grandi avec tant de privilèges.
J’ai connu l’époque des grandes manifestations pour les droits civiques aux Etats-Unis, les débats sur l’émancipation des femmes et j’ai grandi en plein mouvement chicano. Je pensais légitimement que nous allions être égaux, et cela n’est pas arrivé. J’ai été obligé de devenir militant quelque part. Quand je suis entré à l’université d’El Paso pour enseigner dans le département d’anglais, nous étions seulement deux à être issus de minorités. Quand j’ai gagné le prix littéraire PEN-Faulkner aux Etats-Unis en 2013, j’étais très fier et heureux, et puis je me suis rendu compte que j’étais le premier Américain d’origine mexicaine à le recevoir, et cela m’a mis très en colère. C’est fatigant.
Je me suis demandé si j’allais devoir être un pionnier toute ma vie, devoir ouvrir la voie aux Mexicains-Américains, aux autres gays. Je n’aime pas avoir à me présenter aux gens comme un homme gay, comme un Chicano, devoir passer ma vie en conflit.
Les lecteurs vous réclament souvent la suite des aventures d’« Aristote et Dante ». Est-elle prévue ?
Oui, je l’ai d’ailleurs presque terminée.
Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers, de Benjamin Alire Saenz (collector, Pocket Jeunesse, 8,95 euros).