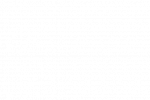Istanbul, la défaite de trop pour Erdogan

Istanbul, la défaite de trop pour Erdogan
Editorial. L’invalidation de l’élection d’un opposant à la mairie du Grand Istanbul montre que le président turc a franchi un pas de plus dans le mépris ouvert des règles de la démocratie.
Editorial du « Monde ». Un régime autoritaire qui se sent menacé est prêt à tout. En permettant l’invalidation, mardi 7 mai, de l’élection d’Ekrem Imamoglu, du Parti républicain du peuple (CHP), la principale force de l’opposition, à la mairie du Grand Istanbul, le président Recep Tayyip Erdogan – qui se targue pourtant de tirer sa légitimité du suffrage universel – a franchi un pas de plus dans le mépris ouvert des règles de la démocratie.
Certes, à peine 13 000 voix, sur quelque 10 millions de votants, séparent le vainqueur du scrutin de l’ex-premier ministre Binali Yildirim, candidat de l’AKP (Parti de la justice et du développement), le parti islamiste au pouvoir depuis novembre 2002. Mais les bulletins ont été comptés et recomptés. Et le Haut Conseil électoral, qui a annulé le scrutin au prétexte qu’un certain nombre de chefs de bureaux de vote n’étaient pas des fonctionnaires, n’a pas contesté l’élection des maires d’arrondissement qui, elle, a été à l’avantage de l’AKP.
L’annulation d’une élection aussi symbolique que celle d’Istanbul marque un tournant. Cette moitié de la Turquie qui ne se reconnaît pas dans l’autoritarisme pieux, conservateur et nationaliste de Recep Tayyip Erdogan dénonce un véritable putsch électoral. « Il est possible de présenter un candidat contre l’AKP, mais pas de gagner », a résumé Onur Adiguzel, coprésident du CHP.
Ces dernières années, les irrégularités et les fraudes n’ont pas manqué, notamment lors du référendum d’avril 2017 instaurant une république présidentielle, remporté d’une très courte tête par celui que ses partisans appellent le « Rais ». Les résultats ne sont pourtant pas toujours acquis d’avance : le 31 mars, le pouvoir a perdu aussi la capitale Ankara et nombre des grandes villes à l’issue des élections municipales. Une perte d’autant plus cinglante que ces villes étaient, pour la plupart, dirigées par les islamistes depuis un quart de siècle.
Virage autoritaire et nationaliste
Lui-même ancien maire d’Istanbul, M. Erdogan rappelle volontiers que « remporter Istanbul, c’est remporter la Turquie ». Cette défaite dans la cité qui fut son tremplin politique était un camouflet – la défaite de trop. Perdre cette ville qui concentre un bon tiers de la richesse nationale, c’est aussi priver l’AKP de capitaux et de fonds publics précieux pour nourrir entrepreneurs amis et clientèle.
Le virage autoritaire et nationaliste de Recep Tayyip Erdogan, arrivé au pouvoir comme libéral et pro-européen, l’a coupé des parties les plus dynamiques du pays. Il riposte en durcissant encore la répression : la confirmation par la Cour constitutionnelle, le 5 mai, de la condamnation à la prison à perpétuité de deux journalistes, Ahmet Altan et Nazli Ilicak, accusés contre toute évidence d’implication dans le putsch militaire raté du 15 juillet 2016, en est un nouveau signe. Depuis 2016, 55 000 personnes ont été arrêtées et plus de 150 000 fonctionnaires limogés.
Le « Rais » veut rejouer le match, comme il l’a fait après les législatives de juin 2015, lorsque son parti a perdu la majorité tout en restant la première force du pays. Six mois plus tard, l’AKP triomphait, sur fond de reprise du conflit avec la rébellion kurde et de chantage au chaos. Les Stambouliotes retourneront aux urnes le 23 juin. L’enjeu est tel, dans une Turquie polarisée comme jamais, que tous les dérapages sont possibles. Mais pour la première fois, l’opposition turque, fragmentée, trouve une figure charismatique autour de laquelle faire bloc : Ekrem Imamoglu, maire éphémère.