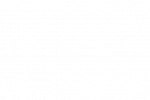En Algérie, la tenue de l’élection présidentielle apparaît de plus en plus incertaine

En Algérie, la tenue de l’élection présidentielle apparaît de plus en plus incertaine
Le Monde.fr avec AFP
Le Conseil constitutionnel a enregistré le dépôt de deux dossiers de candidature, mais ceux-ci ont peu de chances d’être validés.
Des étudiants manifestent à Alger, le 21 mai 2019. / RYAD KRAMDI / AFP
Pas de candidats ? Deux candidats ? En Algérie, la situation est devenue encore plus confuse, dimanche 26 mai, autour de la présidentielle prévue le 4 juillet, un scrutin catégoriquement rejeté par le mouvement de contestation et dont la tenue apparaît de plus en plus incertaine.
A l’expiration du délai légal, samedi à minuit, le Conseil constitutionnel a annoncé avoir enregistré le dépôt de deux dossiers auprès de son secrétariat général, de la part de Abdelhakim Hamadi et Hamid Touahri. Mais les candidatures de ces deux inconnus ont de maigres chances d’être validées, car elles vont se heurter aux conditions rédhibitoires fixées par la loi, notamment celle liée à l’obligation d’obtenir 60 000 parrainages d’électeurs ou 600 signatures d’élus.
Selon la presse, Abdelhakim Hamadi avait déjà déposé sa candidature pour l’élection du 18 avril, finalement annulée. Le Conseil constitutionnel a dix jours pour statuer sur la validité des deux candidatures, selon la loi électorale.
Avant l’annonce du Conseil, la radio publique avait indiqué que le pays vivait une « situation inédite » et qu’aucun dossier de candidature n’avait été déposé. Selon elle, le seul candidat, le militaire à la retraite Benzahia Lakhdar, un ex-militant du Front de libération nationale (FLN, du président déchu Abdelaziz Bouteflika), s’était rétracté au moment de déposer son dossier. Le site d’informations TSA affirme qu’aucun candidat n’est parvenu à réunir le nombre de signatures nécessaires.
« Il est fort probable que le pouvoir annonce bientôt le report de cette joute à une date ultérieure », écrit le quotidien francophone El Watan sur son site Internet.
Eviter un « vide constitutionnel »
L’Algérie est secouée depuis le 22 février par des manifestations massives déclenchées par la volonté de M. Bouteflika de briguer un cinquième mandat. Celui-ci a démissionné le 2 avril sous la pression de la rue et de l’armée, mais les manifestants restent mobilisés, réclamant le départ de l’ensemble du « système » au pouvoir durant les deux décennies de règne de Bouteflika. Le mouvement de contestation rejette la tenue d’une élection présidentielle tant que leur revendication n’a pas été satisfaite et réclame des structures de transition à même de garantir une élection libre et équitable.
Aucune personnalité d’envergure n’a fait publiquement acte de candidature à la présidentielle et aucun grand parti au pouvoir ou d’opposition n’a désigné de candidat. Le pouvoir actuel et son président par intérim, Abdelkader Bensalah, désigné le 9 avril, ont dit vouloir s’en tenir aux délais constitutionnels : l’élection d’un nouveau chef de l’Etat dans les 90 jours suivant le début de l’intérim.
Homme fort du pays, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée, a opposé une fin de non-recevoir aux revendications de la contestation. Il a jugé « irraisonnable voire dangereux » le départ des figures du « système » et appelé à accélérer les préparatifs de la présidentielle afin d’éviter un « vide constitutionnel » et de juguler « ceux qui veulent faire perdurer la crise ». Le chef d’état-major a aussi appelé les manifestants à « s’unir » avec l’armée afin de déjouer « l’infiltration » des manifestations par les « instigateurs de plans pernicieux », et a assuré n’avoir « aucune ambition politique ».
Le retour au centre de l’échiquier politique de l’armée, considérée comme le réel détenteur du pouvoir jusqu’à l’arrivée de Bouteflika, fait craindre à certains observateurs un possible scénario « à l’égyptienne ». En Egypte, le chef de l’armée Abdel Fattah Al-Sissi s’est fait élire président après un coup d’Etat militaire en 2013 contre le président élu, Mohamed Morsi, et après avoir assuré que l’armée « resterait éloignée de la politique ».