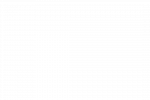La restauration, levier d’intégration pour des femmes réfugiées

La restauration, levier d’intégration pour des femmes réfugiées
Une start-up parisienne lancée à la fin de 2016 aide les femmes immigrées ou réfugiées à devenir chef à leur compte.
A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés jeudi 20 juin 2019, nous publions cet article distingué lors du concours HCR-Le Monde, créé par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à destination des étudiants en école de journalisme. Le thème choisi pour 2019 était « Entreprises et réfugié(e)s : une intégration par l’emploi ». Lauréate de l’édition 2019, Aude Le Gentil est étudiante à l’Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille. Elle a raconté l’itinéraire de Nitha, du Sri Lanka aux cuisines de Deliveroo, en Seine-Saint-Denis.
Nitha, 37 ans, travaille pour la société de livraison de repas Deliveroo, en Seine-Saint-Denis / AUDE LE GENTIL
Elle semble petite et menue dans son uniforme gris, mais sous sa toque pointe un air décidé. Il est 15 h 30 et Nitharshini Mathyalagan achève ses commandes du midi. A la tête d’une activité de traiteur appelée Voyage au Sri Lanka, la restauratrice confectionne dhals de lentilles, biryanis aux légumes et lassis à la mangue depuis le matin.
« Nitha » nous accueille à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), près des cuisines partagées de Deliveroo, l’entreprise de livraison de repas avec laquelle elle collabore. Celle-ci lui fait bénéficier de ses cuisines partagées ainsi que de son portefeuille de livreurs et de clients en échange d’une commission. Interdiction en revanche de visiter les lieux : Deliveroo n’accepte pas les visiteurs. Le français de Nitha est hésitant, alors c’est en anglais que la femme de 37 ans raconte son histoire.
Fuir le Sri Lanka
Son récit commence par un départ. En 2007, Nitha et son mari, Hushanel, quittent le Sri Lanka, rongé par le conflit qui oppose le gouvernement cinghalais aux indépendantistes tamouls, et s’installe en Malaisie. Un sourire pudique suit lorsque l’on tente d’en savoir plus. « C’est difficile parfois de partager mon histoire. »
Leur fillette, Hereshini, n’a que 6 mois. A Kuala Lumpur, la famille obtient le statut de réfugiée, mais ne peut ni travailler ni bénéficier de l’école gratuite. Hushanel gère la maintenance d’un immeuble, sans être déclaré. « La plupart du temps, nous n’avions pas 10 ringgits [un peu plus de 2 euros] de côté », confesse Nitha.
Avec un four prêté par une voisine, la réfugiée tamoule se met à cuisiner. Son idée : vendre ses plats. L’exilée pioche dans les recettes familiales, suit une formation, et se mue en pâtissière perfectionniste. « Je peux passer deux jours sur une pièce montée et j’aime ça ! »
Un microcrédit du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) lui permet d’acheter un four plus grand. Son sens du commerce fait le reste. Adolescente, déjà, elle vendait des glaces à ses amis sur les plages de Batticaloa, dans l’est de son île. Rapidement, l’entreprise grandit.
Non-reconnaissance des diplômes locaux
En novembre 2015, Nitha et sa fille s’installent en France à la faveur d’un programme de réinstallation du Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés. La France, pour elle, c’est la perspective de pouvoir travailler légalement, « d’inscrire Hereshini dans une école gratuite ». Il faut tout recommencer.
Son conjoint, Hushanel, n’a pas pu les accompagner immédiatement, leurs dossiers ayant été traités séparément. Il ne les rejoint qu’après un an et demi d’attente. La famille est installée dans un logement social à Aubervilliers (Seinte-Saint-Denis).
En France, difficile pour Nitha de faire valoir ses compétences. La méconnaissance du français, la non-reconnaissance des diplômes locaux et les discriminations se dressent comme autant de barrières pour les réfugiés. En 2016, 56 % d’entre eux occupaient un emploi, selon un rapport de l’OCDE paru en janvier, soit neuf points de moins que les personnes nées dans l’Union européenne. Les femmes réfugiées accusent un retard plus grand encore, avec un taux d’emploi de 45 %. Ces dernières « doivent à la fois faire face aux obstacles auxquels sont confrontés les migrants, les réfugiés et les femmes », insiste le rapport.
Contre les discriminations et l’autocensure
La passion, la motivation, le talent, Nitha les a. Il lui manquait un coup de pouce. Celui-ci va s’appeler Meet my Mama. Cette start-up lancée ) la fin de 2016 à Paris aide les femmes immigrées ou réfugiées à devenir chef à leur compte. « On connaît tous une très bonne cuisinière qui ne mesure pas son talent, argumente Youssef Oudahman, l’un des fondateurs. Nous voulions leur donner du pouvoir dans un milieu trop masculin. »
L’entreprise fournit le matériel et les premiers clients, épaule les femmes dans les démarches administratives, forme à la prise de parole. Une façon de lever les freins qui ralentissent la carrière des exilées. Youssef en identifie trois : les discriminations, le poids des tâches domestiques et des enfants à charge, et l’autocensure. Convaincue, Nitha devient la première « Mama ».
Pour Nitha travailler était indispensable : financièrement, son foyer repose sur elle. « Mon mari s’occupe de notre fille et de ma mère, qui n’est pas autonome. Mais sa demande d’asile n’a pas encore été traitée, il ne peut pas chercher un emploi. » Plus encore, Nitha ne supporte pas l’idée de « rester à la maison, à attendre le RSA ». Est-elle une femme d’affaires ? La Sri-Lankaise éclate de rire et corrige avec fierté : « Je suis autoentrepreneur. » Nitha fait une pause. Des bâillements suivent. « Je ne me suis pas assise depuis ce matin », s’excuse-t-elle. Ses doigts sont cerclés de pansements. La cuisine dévore tout son temps et son pays lui manque. « Mais j’ai trop peur pour y retourner. »
« Redevenir des modèles »
« Parfois, mon mari me dit : “Tu sais, tu peux changer si c’est trop dur”, poursuit la chef, mais je ne veux me consacrer qu’à la cuisine. » L’exilée assure avoir trouvé « une nouvelle famille » chez Meet my Mama. Mieux : Nitha se sent libre et confiante. « Maintenant, décrit-elle, je me gère toute seule. Je peux m’organiser comme je le souhaite, m’absenter pour ma fille ou ma mère si besoin. » Gagne-t-elle bien sa vie ? Haussement d’épaules : « Certains mois oui, d’autres fois, c’est plus dur, c’est comme ça, les affaires. »
En quittant leurs pays, observe Youssef Oudahman, les réfugiées ont presque tout perdu, y compris l’estime d’elles-mêmes. En lançant leur activité, ces femmes ont le sentiment de « redevenir des modèles pour leur foyer et pour la société », d’appréhender les codes de la vie en France, de tisser des liens… Bref, trouver une place. Pour parachever son intégration, Nitha caresse un rêve : ouvrir sa pâtisserie.