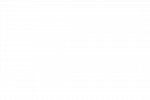CAN 2019 : une fête « au goût amer » pour les Ultras égyptiens

CAN 2019 : une fête « au goût amer » pour les Ultras égyptiens
Par Hélène Sallon (Le Caire, envoyée spéciale)
Suite aux événements meurtriers de 2012 et 2015, des centaines de membres de ces groupes de supporteurs ont été arrêtés et condamnés.
Des Ultras du club égyptien Al-Ahly, au Caire, en septembre 2011. / Amr Dalsh / REUTERS
Alors que, sur l’écran, le stade vibre à l’entrée de Mohamed Salah, l’attaquant vedette de l’équipe nationale égyptienne, Soliman (le prénom a été modifié) a les yeux rivés sur son favori, le milieu de terrain sacré meilleur joueur du club de Zamalek, Tarek Hamed. Pour le deuxième match de l’Egypte à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), contre la République démocratique du Congo mercredi 26 juin, comme pour le premier, le jeune homme de 30 ans est resté à la maison. Loin de l’animation du stade et des cafés.
Le football est pourtant comme une seconde religion pour ce capo des Ultras White Knights, un des meneurs du groupe de supporteurs du club de Zamalek. « Je suis la CAN bien sûr. Tous ceux qui ont la passion du football la suivent. Mais, cette année, elle a un goût amer alors que des dizaines d’entre nous sont en prison », confie le jeune homme par téléphone.
Depuis que les groupes d’Ultras ont été créés en 2007 dans les deux plus grands clubs nationaux, Al-Ahly et Zamalek, une relation de défiance s’est tissée avec les autorités, émaillée de nombreux affrontements. Propulsés en première ligne de la révolution du 25 janvier 2011, les Ultras sont devenus la bête noire des autorités. La défiance a cédé la place à la haine après le drame de Port-Saïd, en février 2012, où 74 supporters d’Al-Ahly ont été tués dans des affrontements avec les supporteurs du club d’Al-Masry, qui se sont déroulés sous les yeux des policiers. Dès lors, les stades ont été fermés au public pour les matchs locaux, à l’exception d’un seul en février 2015, où plus de 20 supporteurs de Zamalek ont trouvé la mort.
« Rugosité et humour grinçant »
Des centaines de membres des Ultras ont été arrêtés et condamnés, notamment pour incitation à la violence. Les deux leaders des White Knights, Saïd Mucharreb et Moustafa Tabla, sont en prison depuis cinq ans. Soliman, un temps poursuivi pour « appartenance à une organisation terroriste », a été blanchi. Interdits par la justice en 2015 à la suite d’une plainte du dirigeant du club de Zamalek, Mortada Mansour, les deux groupes d’Ultras se sont autodissous en 2018 après une ultime confrontation entre Ultras Ahlawy et forces de police en marge d’un match de la Ligue africaine. Sans disparaître.
Les White Knights continuent d’exister sous forme de communauté virtuelle. Lors des matchs où joue leur club, ils se retrouvent dans des cafés sans tee-shirts ni écharpes aux insignes du groupe. « Les arrestations continuent, même dans les cafés et chez nous », déplore Soliman. Ils ne peuvent aller au stade que pour les matchs de la Confédération africaine de football. « On n’entre pas comme Ultras. Ils arrêtent des chefs et des membres avant le match. Mais, une fois entrés, on est les seuls à chanter, tout le monde nous suit », poursuit le jeune homme. Pour la CAN, les autorités ont imaginé un nouveau système afin de contrôler ceux qui achètent des places. « La carte de supporteur a été faite pour nous empêcher, nous les Ultras, d’aller au stade », explique Soliman, alors que beaucoup sont fichés par la sécurité.
Quand la culture des Ultras a déferlé sur l’Egypte, pays féru de ballon rond, elle a vite fait mouche dans la jeunesse. Les membres actifs – plusieurs milliers avant la révolution – se recrutent chez les 15-30 ans, beaucoup dans les classes populaires, mais aussi dans les classes moyennes et supérieures. Ils revendiquent une position apolitique mais réunissent des jeunes aux affiliations variées : de gauche, proches du régime ou des Frères musulmans. « Les Ultras abolissent les différences sociales. La rugosité et l’humour grinçant sont notre langage commun. Nous sommes une société qui fonctionne sur les règles d’égalité et de bravoure. Tout ça nous rend foncièrement hostile à l’autorité », explique Soliman.
« Nous faisons peur au pouvoir »
Désorganisés en apparence, ils cultivent en réalité une véritable discipline. Divisés en bataillons sous l’autorité d’un capo dans chaque quartier, ils se répartissent les tâches pour animer les stades : chants, graffitis, banderoles, slogans… Face à cette organisation capable de mouvoir un stade entier et de les défier dans leurs chants, les autorités ont d’abord été divisées. « Il y a ceux qui pensaient que c’était dangereux d’avoir des jeunes organisés hors de leur contrôle et ceux qui trouvaient ça cool, et qu’il valait mieux que la colère de la jeunesse se déverse dans les stades plutôt que dans la rue », explique Soliman.
De l’avis des Ultras, ce sont les autorités qui ont initié les hostilités par leur volonté de contrôle. « Etre ultra, c’est être assez fou pour investir tout son temps et son argent pour sa passion. Quand le régime a commencé à vouloir mettre des règles pour nous contrôler, la réponse a été : “Allez vous faire foutre” », poursuit-il.
« Les Ultras font peur au pouvoir, car ils sont imprévisibles et ne craignent pas l’opposition avec les forces de sécurité. Ils ont une capacité de mobilisation et de fascination sur les jeunes qui est vue comme une menace pour la stabilité et le maintien de l’ordre », analyse Suzanne Gibril, sociologue à l’Université libre de Bruxelles. Cette menace est devenue évidente lorsque a éclaté la révolution du 25 janvier 2011. Les Ultras ont laissé le libre choix à leurs membres de participer, à titre individuel. Beaucoup ont rejoint les manifestations. « On rejetait l’injustice, la diffamation et la dureté du régime. On est descendu exprimer notre colère. On savait que c’était la dernière opportunité d’obtenir nos libertés et nos droits, alors que le régime commençait à serrer la vis contre nous depuis 2010 », explique Soliman.
« Face à face avec l’armée »
Quand les heurts ont commencé à émailler la révolution, comme lors des affrontements de la rue Mohamed Mahmoud en novembre 2011 où deux d’entre eux sont morts, les Ultras se sont retrouvés en première ligne. « On s’est retrouvés dans un face-à-face avec l’armée. Les gens nous voyaient comme des boucliers et se mettaient en retrait », explique le White Knight. Ce rôle a fait d’eux des héros aux yeux des révolutionnaires, qui par milliers portaient leurs tee-shirts et chantaient leurs chants, mais les a définitivement rangés au rang de menace aux yeux de l’armée. « Ça a été la plus grande erreur des Ultras. On est des supporteurs de foot avant tout mais, comme la société n’a pas de jeunesse organisée, on n’a pas eu le choix. Les massacres dans les stades ont été une sorte de punition pour ce rôle qu’on a eu », précise Soliman.
Depuis la reprise en main du pouvoir par l’armée et son homme fort, le président Abdel Fattah Al-Sissi, à l’été 2013, plus aucun espace n’est laissé à la contestation du pouvoir. Les chants de défiance des Ultras envers la police et les autorités, ou pour honorer la révolution de Tahrir ou le drame de Port-Saïd, n’y font pas exception. Conspués par les médias aux ordres du pouvoir et réprimés par les forces de sécurité, les Ultras tentent de faire oublier leur rôle politique dans l’espoir de pouvoir se reformer et d’accéder à nouveau aux stades. « Les autorités pensent que les Ultras, c’est fini ! Mais c’est impossible. Cette croyance continue d’exister parmi les jeunes et elle ne disparaîtra pas, à moins de fermer les clubs », assure Soliman.