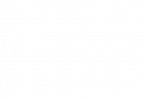Ancien chef du « Weekly Shonen Jump », Hiroki Gotô livre les secrets du légendaire magazine de manga

Ancien chef du « Weekly Shonen Jump », Hiroki Gotô livre les secrets du légendaire magazine de manga
Propos recueillis par Pauline Croquet (Propos recueillis par)
Il fut rédacteur en chef du magazine pendant l’âge d’or du manga, à la fin des années 1980 (avec la publication des séries comme « Dragon Ball », « City Hunter », « Captain Tsubasa », « Saint Seiya », etc.). Hiroki Gotô revient pour « Le Monde » sur cette folle période, lors de la Japan Expo.
Hiroki Gotô, le 4 juillet 2019 à Japan Expo. / Pierre Trouvé / Le Monde
Dragon Ball, City Hunter, Jojo’s Bizarre Adventure, Captain Tsubasa, Saint Seiya…, n’importe quel lecteur de manga français, ou enfant qui a grandi avec une télévision dans les années 1980-1990, connaît au moins une de ces séries majeures du manga. Elles ont pour point commun d’avoir été toutes publiées à l’âge d’or de la BD japonaise et dans le même magazine, le « Jump », diminutif du Weekly Shonen Jump. Ce leader du marché et machine à hits a célébré en 2018 son cinquantième anniversaire.
Invité d’honneur de la dernière édition du Japan Expo qui s’est clôturée dimanche 7 juillet, Hiroki Gotô a dirigé la publication du Jump entre 1986 et 1993. Son équipe a amené le magazine à dépasser le tirage de 6 millions d’exemplaires au tournant des années 1990.
Avant d’en devenir le rédacteur en chef, et, à ce titre, superviser la cohérence et l’évolution de son offre éditoriale, Hiroki Gotô était un jeune éditeur fougueux qui a intégré la rédaction en 1970, comme il le raconte dans son livre Jump : l’âge d’or du manga (Kurokawa), qui vient de paraître en France. L’ouvrage, inédit, et servi par une traduction française soignée de Julie Seta, éclaire sur une économie secrète qui a rayonné dans le monde entier.
Vu de France, les secrets de fabrication du « Weekly Shonen Jump » ont l’air très bien gardés. Qu’est ce qui vous a poussé à partager vos mémoires de rédacteur en chef ?
Plus qu’une volonté de révéler des secrets, il s’agit d’une volonté de témoignage. Tous les rédacteurs en chef qui m’on précédé sont décédés aujourd’hui, et je me suis alors rendu compte que j’étais le dernier témoin vivant de cette période du Shonen Jump. Je me suis dit qu’il était dommage que tout ce savoir disparaisse et que je me devais, dans un souci de transmission historique, de raconter comment est né le Shonen Jump moderne. Ce que j’ai fait pour les 50 ans du magazine.
Vous conceviez des œuvres de divertissement à destination des enfants. Mais, à la lecture de votre ouvrage, on est frappé de voir que, selon vous, le travail des auteurs a une dimension politique et sociétale.
Un magazine de manga et son équipe doivent répondre aux envies des lecteurs. C’est pour cela qu’on avait mis en place le fameux sondage d’opinion [un petit questionnaire glissé dans le magazine retourné chaque semaine par des milliers d’enfants qui recevaient un petit cadeau en échange] pour savoir ce qui intéressait nos lecteurs, ce qu’ils avaient dans la tête, les différentes modes… Et on partageait bien entendu ces précieuses données avec nos auteurs. C’est grâce à cela qu’on a réussi à être en phase avec notre époque.
A tel point d’ailleurs que le slogan du magazine vient aussi des enfants ?
Exactement. On leur demandait souvent, dans les enquêtes, de choisir les mots qui leur paraissaient les plus importants. Ceux qui sont revenus le plus souvent : « l’amitié », « l’effort » et « la victoire », sont devenus les mots fondateurs de l’esprit Jump.
Vouliez-vous avant tout rendre l’état d’esprit des petits Japonais ?
Avec ces enquêtes, on s’est rendu compte de façon unanime d’une chose : les enfants sont des êtres positifs, très braves et courageux. Quand on demandait « qu’est ce qui vous préoccupe ? », beaucoup mentionnaient les résultats scolaires, les performances sportives ou encore leur avenir et leur orientation. Mais, à leur niveau, même s’ils avaient des difficultés, ils restaient combatifs et positifs.
Ils avaient besoin d’être encouragés, d’avoir la sensation qu’ils pouvaient décrocher des victoires. A partir de là, on s’est donc dit qu’il fallait des histoires réjouissantes avec un fond positif. Dit comme ça, cela parait évident, mais on avait besoin de vérifier ces intuitions. C’était notre rôle et notre stratégie d’inciter nos auteurs à faire des œuvres avec des héros auxquels les enfants pouvaient facilement s’identifier.
Très vite, quand on tient compte des critères, on se rend compte que ce qui leur correspondait c’était des mangas de sport avec de l’affrontement, de la tension et la satisfaction de la victoire. Cela va correspondre aussi aux kenka manga, les mangas de bagarre.
« Jump » a bâti son succès en recrutant de jeunes mangakas et en faisant tout pour les amener vers le succès. Certains, comme Akira Toriyama, le père de « Dragon Ball », sont même devenus des légendes vivantes. Est-ce que vous n’avez pas eu des difficultés à gérer et à travailler avec des inconnus devenus des superstars ?
Bizarrement non. Même une fois devenus célèbres, l’immense majorité des dessinateurs de manga continuaient à écouter nos conseils, nos directives. Cependant, comme dessiner un manga à un rythme hebdomadaire est extrêmement soutenu et fatigant, il arrivait que les mangakas les plus célèbres tentent d’imposer des repos ou des retards de rendu.
Comme vous le savez, le système du Jump est impitoyable. Il y a une règle que tout le monde accepte et garde en tête, c’est que si votre manga ne marche plus on l’arrête. Cette règle était toujours bien acceptée par les nouveaux mangakas. Mais il est arrivé que de grandes stars qui avaient connu le succès avec une précédente série, refusent l’arrêt de leur nouveau manga, moins populaire.
Votre livre nous permet d’ailleurs d’appréhender la relation particulière, le duo que forment le mangaka et son « tanto », son responsable éditorial attitré, système spécifique à la BD japonaise et plus méconnu chez nous où l’auteur est au centre de la production.
Effectivement. Nous avons peut-être un sens de l’évidence différent au Japon, mais pour nous ce système est né d’un fait tout simple : un jeune qui veut devenir dessinateur de manga va devoir, avant de le devenir, travailler sans relâche sur des planches pour faire ses preuves. Or cela réclame énormément de temps et d’efforts, et la plupart des gens qui s’y essayaient arrêtaient leurs études ou leur travail afin de se consacrer à cette tâche. Cela signifie qu’ils n’avaient pas de revenu pendant un temps.
Dès que vous devenez mangaka, vous n’avez plus d’argent, et vous devez en gagner au plus vite. Le rôle du tanto est donc justement là pour aider le jeune mangaka à vivre convenablement de son manga. Cela passe par l’aide dans ses tâches administratives et quotidiennes, comme lui donner des conseils pour que le manga soit publié le plus vite possible. Et comme ce mode de fonctionnement a toujours été efficace, on l’a gardé.
Vous avez contribué à l’énorme succès de nombreuses séries. Certaines sont devenues iconiques, bibliques même dans l’industrie du manga. Mais, en tant que rédacteur en chef, avez-vous eu des regrets à laisser filer des mangakas talentueux à la concurrence ?
Il y en a eu plein, mais on ne peut pas tout faire. Si on avait eu tous les gens qu’on voulait, on n’aurait pas pu s’occuper correctement de tout le monde. On a recruté des auteurs, notamment par des concours, pour lesquels cela ne fonctionnait pas très bien au final dans le Shonen Jump. Ils sont allés exercer pour d’autres magazines de notre maison d’édition [Shueisha] qui s’adressaient à une tranche d’âge plus adulte. Je regrettais et m’interrogeais souvent sur le fait que cela n’ait pas pris chez nous.
Bien que vous soyez devenus leader des magazines de prépublication de manga au Japon, à la même époque et dans des groupes d’édition différents, certains auteurs ont représenté une concurrence féroce pour vos mangakas. On pense par exemple à la dessinatrice Rumiko Takahashi qui a reçu le grand prix du festival de BD d’Angoulême cette année.
Vous êtes dure de pointer ainsi les points faibles du Jump ! [Il se met à rire.] Je vais être plutôt franc avec vous : chez Jump, on avait toujours à cœur de séduire un public de petits garçons et on était sûr que pour ce faire il fallait des histoires écrites par les garçons. Les lectrices du Shonen Jump, à l’époque dont on parle, ne représentaient qu’à peine 10 % du lectorat. De mon temps, on a donc eu très peu de dessinatrices et on n’a même pas cherché à en avoir. Alors, quand Rumiko Takahashi est arrivée en faisant du manga pour garçons, ça a été un choc pour nous. Mais je n’exprime pas de regret dans le sens où on n’a pas essayé de copier un autre magazine. On s’est dit qu’ils avaient leurs propres armes et nous les nôtres.
Une partie des séries du « Jump » ne masquaient pas la violence. Quand elles sont arrivées en France, par les dessins animés dérivés, certaines scènes furent même caviardées. Est-ce qu’au Japon vous avez reçu des plaintes vous accusant de pervertir la jeunesse, comme cela a pu être le cas chez nous ?
Absolument pas. On a reçu surtout de plaintes à propos de L’Ecole impudique, le premier manga de Go Nagai [le créateur de Goldorak] mais cela concernait la grossièreté et la présence de blagues sexuelles. Au Japon, on n’est pas regardant sur la violence mais beaucoup sur la représentation de tout ce qui concerne le sexe.
Je comprends qu’on puisse discuter de la pertinence de la violence pour les jeunes enfants, mais le Japon est un pays où il ne se passe rien : il n’y a pas de guerre et peu de violence physique. En revanche, il existe de la violence ordinaire, notamment ce qu’on appelle le ijime, des élèves qui se font racketter et harceler à l’école. A leur niveau, donc, tous les enfants doivent lutter. Je pense que cela ne pose pas de problème de montrer de la violence dans les œuvres parce qu’ils expérimentent déjà la violence.
De plus, dans les mangas, la violence est tellement détachée de ce qu’on connaît, elle est fictionnelle et ne fait pas écho à une réalité. Il faut aussi voir que, par exemple dans Hokuto no Ken [Ken le survivant, en français], Dragon Ball mais aussi Jojo’s Bizarre Adventure pour ne citer qu’eux, la violence est présente, il y a des luttes de pouvoir politique, mais dans ces mangas, on y explique aussi que ce n’est pas bien. Les héros luttent même contre cela, ce n’est pas dépeint de manière positive. Ce sont des histoires qui se rapprochent d’un proverbe japonais qui dit « sois bienveillant avec le faible et sois défiant envers le fort ».
Hiroki Gotô, le 4 juillet 2019 à Japan Expo. / Pierre Trouvé / Le Monde
Est-ce que cela vous étonne que des produits dessinés avant tout pour des petits lecteurs japonais aient pu séduire des millions de lecteurs dans le monde ?
Evidemment, cela fait très plaisir. Et à l’époque on en n’avait absolument pas conscience. Nous avons pu ainsi mesurer la valeur de notre travail. Bien sûr, les œuvres appartiennent à leurs auteurs mais, dans l’ombre, nous, les tantos, on s’est sentis très valorisés.
Votre livre s’achève sur quelques conclusions envers l’industrie du manga et la transformation du marché de la prépublication, qui est désormais en chute. Pensez-vous que les magazines de prépublication de manga ont vocation à disparaître ?
Question très très difficile… Je pense qu’il y a 50 % de chances que cela arrive. Les habitudes de consommation ont changé : avant, les lecteurs étaient fans d’un magazine, d’un concept comme le Jump, parce qu’ils aimaient une ambiance, l’atmosphère dégagée par l’ensemble des pages et non pas seulement une série. Aujourd’hui, ils picorent uniquement ce qu’il leur plaît. Alors, au lieu d’acheter intégralement le magazine, ils préfèrent se tourner vers les volumes reliés de la série. L’avenir va donc dépendre de la façon dont va se maintenir le nombre de lecteurs qui adhèrent totalement au magazine.
Certains éditeurs actuels ont aussi redouté le passage au numérique, à la chute du papier avec l’avènement des smartphones…
Je n’ai pas peur du numérique car les habitudes de consommation du manga sont sur le support papier, selon moi. Internet est un média, une nouvelle manière de faire savoir aux autres personnes que telle ou telle œuvre existe. Ce qui m’inquiète plus, c’est que désormais les lecteurs ont tendance à dissocier l’œuvre de son univers de publication.
Durant votre carrière vous avez révélé ou accompagné des auteurs majeurs du manga shonen comme Akira Toriyama, Tsukasa Hojo, Tetsuo Hara pour ne citer qu’eux. Y a t-il un manga ou un mangaka pour lequel vous avez une affection particulière ?
Je vais tricher un peu, car, que ce soit en tant que tanto, rédacteur en chef adjoint ou rédacteur en chef, j’ai tellement édité de séries, j’ai tellement remanié d’histoires et je me suis tellement battu pour que les mangas soient bons que ce serait extrêmement difficile de choisir. Je ferai donc une pirouette en vous disant que toutes les séries qui ont compté pour moi sont celles que j’ai citées dans mon livre.
Jump, l’âge d’or du manga, de Hiroki Gotô, traduit par Julie Seta et supervisé par Grégoire Hellot, éditions Kurokawa, 336 pages, 18,90 euros.