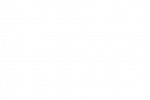Après l’affaire Rugy, une exigence de moralisation de la vie politique

Après l’affaire Rugy, une exigence de moralisation de la vie politique
Editorial. La démission du numéro deux du gouvernement montre une nouvelle fois que les Français veulent des responsables politiques irréprochables. Pour ces derniers, une seule solution : l’exemplarité.
Francois de Rugy, lors du défilé du 14-Juillet, à Paris. / LIONEL BONAVENTURE / AFP
Editorial du « Monde ». L’époque où un ministre mis en cause pouvait espérer tenir jusqu’à ce que la justice lui demande des comptes est révolue. D’année en année, les Français ont relevé leur degré d’exigence vis-à-vis de leurs élus. Ils ne supportent plus qu’ils jouent avec l’argent public. Ils les veulent irréprochables, non seulement sur le plan de la légalité, mais aussi de l’éthique.
Pour ne pas l’avoir compris, François de Rugy s’est retrouvé, une semaine durant, sous le feu roulant des révélations de Mediapart. Acculé, le numéro deux du gouvernement a démissionné, mardi 16 juillet, quelques heures avant la discussion au Sénat du projet de loi énergie et climat qu’il aurait été incapable de porter sereinement : à nouveau, il avait à défendre son honneur. Le site d’information l’accusait cette fois d’avoir, en 2013 et 2014, alors qu’il était député, réglé une partie des cotisations à son parti Europe Ecologie-Les Verts (EELV) en se servant de son indemnité parlementaire défiscalisée, tout en déduisant les sommes versées du calcul de ses impôts.
François de Rugy a contre-attaqué en dénonçant un « lynchage médiatique » ; il a affirmé avoir déposé plainte pour diffamation contre le site. Mais, politiquement, son sort était réglé. Il ne pouvait plus tenir, anéanti par la dévastation qu’avait causée dans l’opinion la mise à jour quasi quotidienne de comportements contestables : des dîners donnés lorsqu’il était président de l’Assemblée nationale aux travaux réalisés dans son appartement de fonction lorsqu’il est devenu ministre, tout donnait l’impression, à tort ou à raison, d’un élu qui se servait au lieu de servir et, ce faisant, contribuait à accroître le fossé entre le peuple et les élus, alors que la crise des « gilets jaunes » en avait révélé la profondeur.
Un système de défense intenable
Parce que, à ce jour, le cas Rugy relève davantage de la morale que de la loi, l’exécutif a obstinément refusé de le trancher à vif. Jusqu’au bout, Emmanuel Macron et Edouard Philippe sont restés fidèles à une ligne consistant à dire qu’ils se prononceraient sur des faits, non sur des « révélations ». Ils ont donc diligenté des enquêtes. Ce faisant, ils ont cru ériger un garde-fou. Mais ils se sont trompés. Leur système de défense était intenable : à quoi bon attendre l’avis de la déontologue de l’Assemblée nationale ou celui du secrétariat général du gouvernement, puisque, aux yeux des Français, François de Rugy, éthiquement défaillant, n’était déjà plus en capacité d’exercer sa fonction de ministre de l’environnement, au moment où ce thème est érigé en grande priorité ?
S’il ne fallait retenir qu’une leçon de l’affaire Rugy, ce serait celle-ci : rien ne résiste à la demande de moralisation de la vie politique. Pour ceux qui exercent une fonction politique, cette exigence suppose de savoir définir, chaque jour, la frontière entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. La tâche peut être complexe, car le pays a longtemps fermé les yeux sur le comportement de ses élus, mais, depuis que leur efficacité est mise en doute, le retour de bâton est brutal. Depuis la fin des années 1990, les lois dites « de moralisation » se sont multipliées sans empêcher les dérives individuelles qui, lorsqu’elles se produisent, jettent l’opprobre sur l’ensemble du personnel politique et accroissent l’ampleur de la défiance. Le seul antidote à cette suspicion tient en un mot : l’exemplarité. On en est, hélas, encore loin.