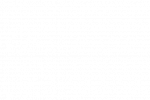Marchés financiers : le mystère de l’absence d’inflation devient le roman de l’été
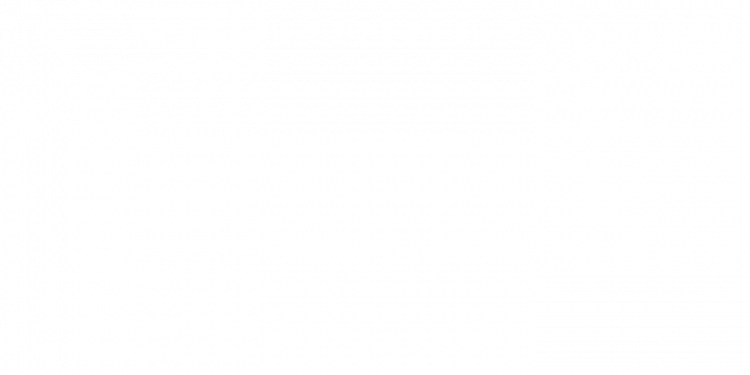
Marchés financiers : le mystère de l’absence d’inflation devient le roman de l’été
LE MONDE ARGENT
L’un des feuilletons de cet été pour les marchés aura de nouveau pour thème la énième prochaine étape « d’assouplissement monétaire » par les banques centrales observe Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement de Carmignac.
Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell avant son audience par une commission du Sénat américain le 11 juillet. / Leah Millis / REUTERS
Il y a un reproche qu’on ne peut pas faire aux marchés financiers, pour autant qu’on s’y intéresse un peu, c’est d’être devenus ennuyeux. Certes, jusqu’au début des années 70, ils constituaient une curiosité qui ne présentait d’intérêt pour le grand public que parmi les boursicoteurs. En Europe en particulier, ils pesaient bien peu par rapport à l’économie réelle, et le conservatisme légendaire des banquiers centraux n’avait d’égal que l’austère discipline des investisseurs institutionnels.
Le système financier international issu de la conférence de Bretton Woods, dont on célèbre le 75e anniversaire cet été, offrait toute la stabilité voulue aux économies du « monde libre ». Mais cette stabilité fut finalement perçue comme un carcan insupportable et à partir de 1973, le système des taux change fixes s’écroula, le rôle légal de l’or disparu, et le dollar se mit à fluctuer violemment.
La grande aventure des marchés financiers commençait, magnifiée par l’immense mouvement de désinflation et de financiarisation de l’économie des années 1980-1990. Celle-ci permit un financement sans contrainte des rêves technologiques les plus exaltés jusqu’à ce que ses excès boursiers éclatent comme une bulle de savon en 2000. Mais les marchés étaient déjà devenus plus forts que l’économie, et les banquiers centraux durent dès lors se résigner, sans jamais vraiment l’admettre, à contenir les effets de souffle sur l’économie réelle de l’éclatement de chaque bulle financière en baissant les taux d’intérêt à chaque fois davantage, alimentant la création de la bulle suivante.
Quand la monumentale bulle du crédit éclata en 2008, les banques centrales décidèrent de comprimer encore plus les taux d’intérêt, et même à s’aventurer dans des interventions d’une créativité inconnue jusqu’alors. Les marchés financiers s’enflammaient. La décennie 2009-2019 a constitué pour les marchés d’actions le plus formidable marché haussier de mémoire d’investisseur. Et dans le même temps les taux d’intérêt continuaient de baisser.
L’absurde est devenu la règle
Ce qui était impensable il y a seulement quelques années est devenu commun, L’absurde est même devenu la règle. Les marchés sont aujourd’hui prêts à payer l’Etat français pour lui prêter à dix ans, ce qui ne constitue même pas une aberration statistique : 13 000 milliards de dollars d’obligations dans le monde présentent des taux d’intérêts négatifs. Et comme les banques n’osent pas encore facturer leurs clients pour leurs comptes créditeurs, les particuliers ne voient dans cette situation que les avantages de taux hypothécaires historiquement bas.
Les entreprises se réjouissent également de conditions d’emprunt sans précédent, mais faute de confiance dans la croissance économique, cette aubaine nourrit davantage des placements financiers que des investissements productifs. Et l’un des feuilletons de cet été pour les marchés aura de nouveau pour thème la énième prochaine étape « d’assouplissement monétaire » par la Fed américaine et la Banque centrale européenne !
Des appels à la surenchère se font déjà entendre : la BCE ne devrait-elle pas non seulement reprendre ses achats d’obligations souveraines, mais les étendre aux actions ? Mario Draghi, président sortant de la banque Centrale Européenne, jouera-t-il son va-tout pour tenter une dernière fois de relancer la croissance et les anticipations d’inflation ?
Activité économique en diminution
Il faut dire que les banquiers centraux n’ont toujours pas percé le secret de l’absence d’inflation. Ce mystère occupera encore certainement nos économistes enquêteurs cet été. Comment se fait-il que même aux Etats-Unis, quasiment revenus au plein-emploi, avec des hausses de salaires qui se multiplient, les anticipations d’inflation ne décollent pas ? L’effet déflationniste de la globalisation, la multiplication des « petits boulots » dans les services aux Etats-Unis, « L’Amazonification » de la distribution rendent-ils vains tous les efforts des banques centrales ?
La clé de l’énigme réside-t-elle dans le constat que le consommateur roi peut désormais imposer des prix bas, qui obligent les entreprises à prendre sur leurs marges bénéficiaires le coût des augmentations de salaires ? Dans l’affirmative, la pression sur les marges aggraverait la faiblesse de l’investissement des entreprises, ce qui pérenniserait l’anémie de la croissance globale. C’est probablement cette crainte qui encourage les Etats-Unis à user de leur rapport de force avec leurs partenaires commerciaux pour s’adjuger la plus grande part possible d’un gâteau global d’activité économique en diminution.
D’ailleurs, les marchés n’ont plus aucun doute aujourd’hui : le positionnement extrême des investisseurs sur les valeurs de croissance et les obligations traduit une résignation unanime sur une économie sans ressort, une inflation sans avenir et des taux bas pour toujours. C’est peut-être ce qui pourrait nous réserver une surprise cet été, car comme disait Sherlock Holmes : « Rien n’est plus trompeur qu’un fait évident ». Suspense.