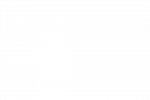Violences au lycée de Tremblay-en-France : « Peut-être qu’ils se sentent exclus par l’école, par la société »

Violences au lycée de Tremblay-en-France : « Peut-être qu’ils se sentent exclus par l’école, par la société »
Par Aurélie Collas
Près d’un mois après les émeutes devant ce lycée de Seine-Saint-Denis, des jeunes confient au « Monde » leur sentiment d’injustice, face à un système scolaire qui les malmène.
Le 17 octobre, des violences impliquant trente à cinquante jeunes embrasaient les abords du lycée professionnel Hélène-Boucher de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), dont la proviseure a été agressée devant l’établissement. Le troisième épisode d’émeutes en moins de deux semaines pour cet établissement. Des attaques toujours largement inexpliquées, malgré la mise en examen de sept jeunes le 27 octobre, entre violences urbaines, rejet de l’école et difficultés sociales.
Près d’un mois après cet embrasement, Le Monde est allé à la rencontre des lycéens de Tremblay pour entendre leur parole, tenter de comprendre leur interprétation de ces événements. Pas à la va-vite, à la sortie des cours, entre bravades et haussements d’épaules. Mais en prenant le temps d’une discussion de plusieurs heures, réfléchie, préparée.
Mercredi 9 novembre, ils étaient huit, âgés de 15 à 21 ans, à participer à une émission radio sur ces violences organisée par l’Office municipal de la jeunesse de Tremblay dans le cadre de sa webradio locale PerspectiV’Jeunesse, à laquelle nous avons été conviés. Un seul, Sébastien (le prénom a été modifié), vient du lycée Hélène-Boucher. Les sept autres sont élèves ou anciens élèves de Tremblay. Certains ont déjà quitté le système scolaire ; d’autres ont intégré des universités parisiennes.
Tous ont accepté de répondre à nos questions dans le cadre de cet atelier radio. Dans cette interview, ce sont pas les émeutes qu’ils décrivent et expliquent. Ils les ont suivies de loin, et n’en connaissent pas les raisons. Ce qu’ils expriment, c’est un rapport douloureux à l’école : des adultes qui ne les écoutent pas, un parcours scolaire subi, des orientations non choisies, un sentiment fort qu’on ne leur donne pas, en banlieue, les mêmes chances qu’ailleurs.
Le lycée professionnel Hélène-Boucher a été pris pour cible à trois reprises, début octobre, par des groupes de jeunes. Pour vous, que révèlent ces événements ?
Sébastien, 18 ans, ancien élève du lycée Hélène-Boucher. J’ai quitté le lycée en juin, et, pendant les trois années que j’y ai passées, il n’y a pas eu de problèmes, hormis quelques chamailleries entre élèves. Depuis le printemps, pendant les mobilisations contre la loi travail, il y a eu des « blocus » – avec caillassages, poubelles brûlées, jets de pierre, paintballs –, et les choses se sont intensifiées depuis. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que ce sont des élèves qui ne veulent simplement pas avoir cours.
Jonathan, 18 ans, ancien élève du lycée Léonard-de-Vinci. Pour moi, c’est sans doute lié à la proviseure, les CPE [conseillers principaux d’éducation] ou d’autres personnels qui ne cherchent pas à comprendre les élèves, qui appellent les parents pour rien, qui sont tout de suite dans la sanction plutôt que d’écouter, dialoguer.
Yacine, 21 ans, étudiant à l’université Paris-II. C’est un avertissement. Ces jeunes n’ont pas attaqué le lycée par hasard ; ils voulaient s’en prendre à l’institution, à l’Etat. Et il y a des raisons à cela. Peut-être qu’ils se sentent exclus par l’école, par la société. Peut-être qu’ils souffrent d’un manque de considération. Ce cri d’alarme, il faut essayer de le comprendre. Car si on se cantonne à l’image de jeunes qui font le bazar, on n’avancera pas.
Sukayna, 20 ans, étudiante à Paris-VIII. Bien sûr, je condamne ces violences, mais je comprends aussi un peu la colère de ces élèves. Lorsque j’étais en lycée professionnel, j’ai remarqué que beaucoup de mes camarades étaient là par défaut ; ils n’avaient pas choisi leur voie mais y avaient été orientés. Du coup, ils n’avaient plus envie d’étudier. Ils continuaient d’aller à l’école seulement parce qu’ils y étaient obligés. Si vous êtes dans une filière qui ne vous intéresse pas, si, en plus, vous avez des profs qui vous disent que ça va être dur pour vous, que vous n’aurez pas le bac, que la fac, ce n’est pas pour vous, vous baissez les bras et c’est la spirale de l’échec, du décrochage, parfois de la violence.
Vous parlez d’orientation après la classe de 3e. Est-ce que vous avez pu en faire le choix ou vous a-t-elle été imposée ?
Mohammed, 18 ans, ancien élève du lycée Léonard-de-Vinci. Le métier que je voulais faire, c’était éducateur sportif. En 3e, j’envisageais la série ES (économique et sociale), mais on m’a dit qu’avec 11 de moyenne, je n’avais pas les notes pour aller au lycée général. Alors j’ai fait une filière professionnelle vente.
Jonathan. Moi je voulais faire l’armée, être gendarme. En 3e, j’avais 13-14 de moyenne. Je suis allé voir la conseillère d’orientation qui m’a dit que pour ce métier, on pouvait faire n’importe quel bac. Donc j’ai choisi le plus facile, le bac pro.
Mariame, en 1ère au lycée Léonard-de-Vinci. Je n’ai pas le souvenir qu’on nous ait informés plus que ça au collège. On nous a surtout conseillé le bac pro parce qu’il y avait plus de places. Je crois que l’orientation, ça dépend beaucoup des places disponibles.
Sukayna. Je me souviens qu’en 3e, on me disait : si tu ne fais pas d’efforts, tu iras en pro. Même chose en 2nde : attention, tu peux être réorientée en pro. C’était une menace ! Et c’est ce qui s’est passé : on m’a réorientée dans une filière professionnelle après la 2nde.
Pensez-vous que l’école fonctionne comme cela partout, qu’elle donne les mêmes chances de réussite à tous ?
Yacine. Clairement non ! Quand je suis arrivé à l’université, j’ai eu l’impression que je n’avais pas passé le même bac que les Parisiens ! On n’avait pas la même culture générale, les mêmes connaissances. J’ai compris qu’en cours, dans leur lycée, personne ne parlait. Ils avaient conscience du fait que s’ils se taisaient, ils apprendraient plus vite, auraient plus facilement le bac et accéderaient à des études supérieures… Nous, on a des classes de 30 à 40 élèves, avec certains parfois qui ne savent pas pourquoi ils sont là ni ce qu’il y a après le bac. Et des profs souvent jeunes, débutants, qui font leur programme, alors qu’à Paris, les enseignants ont l’expérience et la pédagogie. En 1ère, j’ai eu un prof de maths qui venait des Comores et ne parlait pas français !
Sukayna. Il y a énormément d’absences de profs en banlieue. Il y a deux ans, en 1ère, je n’ai pas eu cours de SVT (sciences de la vie et de la terre) pendant un an ! En terminale, il a fallu rattraper tous les cours de 1ère et les notes étaient catastrophiques.
Mariame. En 3e, alors qu’on avait le brevet à la fin de l’année, on n’a pas eu d’anglais jusqu’en février. Ensuite, un remplaçant est venu, qui nous passait des films… On n’a pas eu non plus de maths de septembre à décembre.
Quels souvenirs avez-vous de l’école ? Plutôt heureux, plutôt douloureux ?
Jonathan. Moi, je n’en garde que des mauvais. J’étais nul en français. Au primaire, je ne savais pas parler, je venais des Antilles. Je me souviens de profs gentils, mais au collège, je n’arrivais pas à les comprendre. J’avais la haine contre une prof parce que je croyais qu’elle avait quelque chose contre moi. Un jour, j’avais un problème avec un élève, elle a pris mon carnet de correspondance, pas celui de l’autre. C’était en 4e. J’ai pété un câble…
Mohammed. Moi, j’ai toujours bien aimé l’école. C’était marrant. Il y a des profs qui sont cools, mais d’autres qui font des différences, qui ont leurs chouchous. Ceux qui ne suivent pas, ils s’en foutent, ils les laissent de côté. Si tu n’écoutes pas, tu sors du cours !
Quelles solutions selon vous faudrait-il mettre en place pour que des incidents comme ceux d’octobre ne se reproduisent pas ?
Yasmine, en 1ère au lycée Léonard-de-Vinci. Il y a un vrai manque de dialogue. Les profs, souvent, ils parlent, font des discours, mais n’écoutent pas ; les élèves n’ont pas leur mot à dire. C’est ça qui conduit des élèves se révolter.
Yacine. En France, on a une jeunesse à deux vitesses ; celle de la banlieue reste dans son monde, sans avoir les codes et les valeurs de ce qu’est la réussite dans ce pays. Il faut mettre dans la tête de ces jeunes que l’école sert à quelque chose, qu’ils sont des citoyens comme les autres, pas de seconde zone, qu’ils peuvent participer à la vie sociale, faire des études et réussir, au même rang que tous les autres.