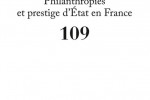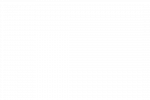Delphine Horvilleur : « On renvoie toujours la femme à son utérus »

Delphine Horvilleur : « On renvoie toujours la femme à son utérus »
Propos recueillis par Annick Cojean
Elle est l’une des trois femmes rabbins en France. Auteure, conférencière et jeune mère de famille, Delphine Horvilleur milite pour que les religions reconsidèrent le rôle et la place des femmes.
Je ne serais pas arrivée là si…
… si je n’étais pas passée par un ailleurs. Si je n’avais pas quitté le lieu de mon enfance et pris plein de virages, vécu en Israël puis aux Etats-Unis, entrepris des études de médecine puis de journalisme. Si je ne m’étais pas exilée de moi-même. Une phrase juive hassidique affirme qu’il ne faut jamais demander son chemin à quelqu’un qui le connaît, car on risquerait de ne pas se perdre. On dit aussi que c’est en visitant la maison du voisin qu’on comprend l’aménagement de son intérieur. Eh bien, c’est ce qui s’est passé pour moi. Il a fallu que j’aille très loin, dans tous les sens du terme, pour pouvoir explorer, interroger, revisiter mon identité. Mon identité juive.
Etait-ce un questionnement fondamental depuis votre enfance ?
Essentiel. Car j’ai grandi avec deux histoires familiales opposées. Du côté de mes grands-parents paternels, originaires d’Alsace-Lorraine, l’identité juive française est ancestrale. Mon grand-père avait une formation rabbinique mais était directeur d’école. La famille, profondément républicaine, était très attachée à la laïcité et à l’histoire de France, reconnaissante à tous ces Justes qui s’étaient mis en danger pour les sauver pendant la seconde guerre mondiale. C’était donc un narratif d’ancrage dans ce pays et aussi de confiance à l’égard de l’autre, ce non-juif qui avait été le sauveur.
Du côté maternel, c’était exactement l’inverse. Mes grands-parents, originaires des Carpates, étaient des survivants des camps de concentration, où ils avaient perdu chacun conjoint et enfants. Ils étaient arrivés en France un peu par hasard et avaient trouvé la force d’y construire une famille. Mais ils portaient un narratif de déracinement absolu, de deuil effroyable et d’impossible confiance envers le prochain qui avait assassiné les leurs. C’est entre ces deux histoires irréconciliables que j’ai dû naviguer très jeune. Héritière de deux mondes.
La confiance ou la défiance… Quelle attitude choisir ? En discutiez-vous au sein de la famille ?
Non. C’était un monde de silence. En tout cas chez mes grands-parents maternels. Ce n’était même pas un refus. C’était une impossibilité. J’ai le souvenir que, lorsqu’on débarquait chez eux, on les réveillait toujours. Ils dormaient. Telles des marmottes. Sans doute un peu shootés par les médicaments. Survivants. Traumatisés. Ils avaient reconstruit une famille sur des pierres tombales. Ou plutôt sur une absence de pierres tombales. Et moi, enfant, je n’avais de cesse de remplir les blancs de leur histoire. Et je m’imaginais que quelque chose passait entre nous, en dépit de leur incapacité à dire et de notre absence de langue commune, puisqu’ils ne parlaient que yiddish. Le lien avec mon métier actuel me frappe d’ailleurs, car l’idée de faire parler le silence du texte est au cœur de l’exégèse rabbinique.
Quelle sorte d’enfant étiez-vous ?
J’étais une petite fille mystique, pleine de questions sur le sens de la vie et sur le transcendant. Un peu ésotérique même, puisque j’étais persuadée de faire de la télépathie avec mes grands-parents silencieux, alors que ma famille était scientifique (père médecin), très rationaliste. Et puis, j’étais obsédée par ce tabou de la Shoah. Je me rappelle piquer des livres dans la bibliothèque de mes parents et lire les ouvrages d’Elie Wiesel à la lampe-torche sous mes draps. Il y avait quelque chose que je devais explorer secrètement.
Je fréquentais la synagogue, mais très tôt j’ai été dérangée par un hiatus entre les valeurs transmises à la maison, notamment l’égalité parfaite entre filles et garçons, et le discours religieux institutionnel. J’étais rebelle au discours normatif. Mais j’ai compris qu’il me faudrait apprendre à vivre avec toutes ces dissonances. C’est évidemment difficile, mais c’est la chose la plus intéressante à faire dans l’existence.
Créer des ponts entre des univers et des pensées discordantes ?
Bien sûr. Je donnais il y a peu une conférence à l’Université hébraïque, en Israël. Et, à l’heure des questions, un étudiant m’a demandé : « Comment pouvez-vous être rabbin et féministe ? » Puis : « Comment avez-vous pu être journaliste et vous intéresser à l’exégèse ? » Enfin : « Pensez-vous qu’un Etat puisse être à la fois juif et démocratique ? » Là, j’ai dit stop. Vous rendez-vous compte que vous posez en fait la même question ? Comment être à la fois là et là-bas ? Habiter un monde et un autre ? Concilier une conviction et un autre engagement ? Mais c’est ça qui est passionnant dans la vie ! Habiter plusieurs mondes, parler plusieurs langages, tisser des liens entre des univers pas toujours réconciliables.
C’est la complexité et la porosité qui me stimulent et m’exaltent. La conscience qu’il y a en moi plein d’altérités. Et le partage permanent entre la foi et le doute. Hélas, l’époque est aux murs, aux frontières, aux certitudes, aux mondes imperméables. Et on inculque aux jeunes l’idée qu’ils ne peuvent habiter qu’un seul univers. C’est faux !
Comment avez-vous trouvé votre voie ?
Je suis partie vivre en Israël après le bac, en 1992. J’avais le sentiment que j’allais y trouver une réponse à ma quête identitaire. J’allais être juive sur une terre où l’on parlait hébreu, où le calendrier était juif… Une « normalisation identitaire » en quelque sorte. Mais lorsque j’ai annoncé à mon grand-père paternel mon projet d’y étudier la médecine, il a observé un long moment de silence avant de dire : « C’est étrange, j’aurais imaginé autre chose pour toi… »
Et cela vous a déstabilisée ?
Cela m’a vexée ! J’ai eu l’impression qu’il piétinait mes rêves de jeune fille. D’autant qu’il ne m’a pas dit ce qu’il avait imaginé pour moi. Pourtant, sa réflexion fut, a posteriori, la plus grande bénédiction qu’il m’ait été donné de recevoir. Et dans les nombreuses circonstances de ma vie où j’ai douté, amorcé un virage, viré de bord, sa phrase m’est revenue, comme si elle m’offrait la possibilité d’un ailleurs. Une autorisation à sortir des sentiers battus et à imaginer pour moi autre chose. Tout m’était permis !
Vous êtes quand même partie pour Israël.
Oui. Le pays était alors en plein processus de paix, j’étais très engagée politiquement, optimiste et fervente, convaincue que les accords d’Oslo allaient marcher. Et puis tout s’est effondré, en 1995, avec l’assassinat du premier ministre Yitzhak Rabin. J’ai été foudroyée. Les attentats se sont multipliés. Toutes les semaines, le bus 18 qui m’amenait à l’université explosait. Et Benyamin Nétanyahou est arrivé au pouvoir. Que la religion ait pu nourrir ce fondamentalisme et cette violence politique a provoqué une profonde remise en cause de mon engagement. Quelque chose de ce pays m’échappait totalement. Alors, en 1997, je suis rentrée en France souffler un peu.
Et ce fut le premier virage.
C’était une période où je me cherchais beaucoup. Et comme l’écriture avait une place importante dans ma vie, je me suis tournée vers le journalisme. J’ai fait une école et des stages passionnants, y compris en Israël au moment de la deuxième Intifada. Je me suis aussi posée quelques mois au Liban pour apprendre l’arabe. Je tâtonnais, multipliant les explorations dans toutes sortes de directions. Et c’est à ce moment-là que j’ai découvert la vitalité d’une pensée talmudique créative et féconde. Et que j’ai eu envie de me plonger dans les textes. Il me fallait absolument revenir à l’étude juive.
Tandis que mes collègues de France 2 filaient le soir à leurs cours de danse ou de yoga, moi, je fonçais à mes cours de talmud. Avec une urgence qui me paraissait vitale. Je me suis alors heurtée à un obstacle qui a provoqué un nouveau virage de mon existence : mon genre ! La plupart des centres d’études parisiens auxquels je m’adressais pour faire de l’exégèse rabbinique n’acceptaient pas les femmes. C’était stupéfiant. La preuve que l’érudition féminine reste quelque chose d’extrêmement subversif dans les religions. Une femme qui pense, qui a accès au savoir, a potentiellement accès au pouvoir. C’est une question politique. Alors, on les tient à distance des textes…
Avec quelle explication officielle ?
Apologétique… et parfaitement malhonnête. On vous explique que la femme est déjà tellement élevée, spirituellement, qu’elle n’a pas besoin de cela. N’a-t-elle pas d’ailleurs d’autres choses sacrées et merveilleuses à faire, comme donner la vie ? C’est le même discours dans toutes les religions : on encense le féminin pour mieux enfermer la femme dans le rôle d’épousailles et de maternité. Et cela me désespère d’entendre aujourd’hui des gamines de 20 ans reprendre ces propos.
Comment avez-vous contourné l’obstacle ?
En partant pour New York. Et en découvrant là-bas un autre judaïsme : une pensée religieuse libérale, moderne, ouverte et créative, égalitaire entre hommes et femmes… à l’opposé de la pensée conservatrice qui est la norme en France. Tout à coup, il devenait possible à une jeune femme d’étudier le Talmud, de s’inscrire dans un schéma libéral et même d’envisager la voie rabbinique. Oui ! J’ai soudain pu verbaliser mon envie pour la première fois. « Rabbin ! » Un mot que je n’aurais jamais pu prononcer en France. Mais, à New York, toutes les pièces du puzzle s’emboîtaient, et j’ai compris que c’était ma voie.
Mais rabbin pour quoi faire ?
Enseigner et transmettre. Car j’aime infiniment ce rapport au texte et à l’étude, constamment dans l’échange. Et puis, accompagner les autres dans tous les moments importants du cycle de la vie : naissance, mariage, maladie, mort. Un rôle de pasteur.
Est-ce un métier ? Une mission ? Un sacerdoce ?
Je ne sais pas quel est le mot juste. En tout cas pas un sacerdoce, puisque le judaïsme n’a pas de dogme, et le rabbin ne fait pas vœu de quoi que ce soit. Un métier, sans doute, mais qui ne s’arrête pas aux portes ou horaires de votre bureau. Une fonction, mais sans définition précise. Certains rabbins sont avant tout des pasteurs et des accompagnants. D’autres sont des intellectuels qui continuent d’étudier. Moi, ma passion réside dans un questionnement permanent du texte, qui n’en finit pas de parler, et qui doit le faire de façon inédite par les voix des nouvelles générations.
Un texte inestimable car détenteur de vérité ?
Non ! Il nous guide, il nous verticalise, il nous élève vers plus grand que nous-mêmes. Il incite aux questions sans nécessairement apporter de réponses, mais en vous faisant grandir. Et j’aime qu’on y trouve le reflet de l’humanité, chaque génération apportant une interprétation différente. Ce n’est pas un rapport à la vérité ou à un dogme quelconque. Moi, toute rabbin que je suis, je ne sais pas en quoi je crois ! Ce qui compte, c’est l’action. Et le rite qui se transmet et continue d’être un support pour penser la complexité du monde.
Avez-vous été tentée de rester rabbin à New York ?
J’aurais pu. Mais le vrai défi, c’était de revenir ici, dans ce pays où le Consistoire, censé être l’organe représentatif des juifs de France, ne reconnaît pas les femmes rabbins. Le Mouvement juif libéral de France m’a accueillie, et j’ai intégré une grande synagogue du 15e arrondissement, en 2008, alors que j’étais enceinte de huit mois. Je me souviens d’avoir alors croisé une personnalité du Consistoire qui m’a lancé : « Bonne installation. Et bon accouchement, parce que c’est ça qui compte dans la vie d’une femme ! » Vous voyez le niveau de misogynie ? On renvoie toujours la femme à son utérus. Welcome back to France !
Il y a trois femmes rabbins aujourd’hui en France.
Oui, et plusieurs autres sont en formation. Hommes et femmes sont mélangés dans ma synagogue, et cela paraît désormais une évidence. Il arrive même que des petits garçons viennent me voir en me disant qu’ils auraient bien aimé être rabbin, mais qu’ils ne peuvent pas car c’est un métier de fille !
Le rabbinat renforce-t-il la connexion avec vos grands-parents ?
Quand j’étudie, quand je prie, j’ai en effet l’impression que le dialogue avec les générations passées est en œuvre. Mais un héritage n’est vivant que si l’on s’en empare pour le transformer. Et je ne me sens jamais autant héritière de la tradition juive et de ma famille que lorsque je fais d’autres lectures que celles qu’elles proposaient. Je souhaite à mes enfants la même liberté.
Quand on bénit des enfants dans le judaïsme, on place les mains sur leur tête en appuyant fortement. Ce geste semble signifier : « Ne bouge pas d’ici. » Mais il dit l’inverse : « Sois suffisamment lesté par ce que je te transmets pour partir au loin. » Et on leur murmure à l’oreille : « Puisses-tu être comme ce personnage de la Bible dont le nom signifie : “oublie et fructifie”. » Pour naviguer, un bateau doit lever l’ancre en étant parfaitement lesté. Eh bien, j’ai l’impression que mon travail de rabbin et de maman, c’est du lestage.
C’est aussi donner une boussole ?
D’abord du lestage. Car rien n’est pire dans l’existence que voyager léger. Sans bagage ni transmission. Il y a quelque chose d’une insoutenable légèreté de l’être. Des gens viennent parfois me voir, douloureux : leurs parents, au nom de la liberté, n’ont rien voulu leur imposer et ne leur ont transmis aucune tradition religieuse. Leur bateau n’est pas lesté, ils ne savent pas naviguer. Voilà le paradoxe : il faut donc suffisamment offrir, suffisamment lester, pour permettre de prendre son envol, dans ce que Derrida appelle une « infidèle fidélité ».
Pensez-vous être l’incarnation de ce paradoxe ?
Mes grands-parents m’ont transmis un judaïsme très fort, mais également une histoire désastreuse, une histoire lacrymale, une histoire à hurler. Et je me souviens clairement du jour où, adolescente, je me suis dit que mon judaïsme à moi ne pouvait être un judaïsme de mort. J’étais bel et bien héritière d’Auschwitz, mais je me devais d’être infidèle en inscrivant cet héritage dans du vivant.
Quel moment vous procure le plus grand plaisir dans votre fonction ?
Une fois par mois, j’invite dans ma synagogue tous les petits entre 2 et 6 ans et j’adapte pour eux un office de shabbat, avec des musiciens et des marionnettes. Comme un spectacle. Ils viennent avec parents et grands-parents mais ils s’emparent de la synagogue en un joli bordel. La quintessence du judaïsme de vie ! On prie, bien sûr, mais on imprègne aussi leur identité juive de quelque chose de joyeux et intense qui les nourrira. Ils posent des questions, ils remettent en cause les histoires, ils ont toutes les audaces. C’est une promesse de vie et de renouvellement. Mes deux plus jeunes filles sont là. Et c’est drôle : à quelqu’un qui demandait récemment à la plus jeune, qui a 4 ans, quel métier exerçait sa maman, elle a répondu : chanteuse !
Propos recueillis par Annick Cojean
Parution en livre de poche de son dernier ouvrage : « Comment les rabbins font les enfants »
Parution du nouveau numéro de la revue trimestrielle Tenou’a (dont elle est rédactrice en chef), consacré à la violence.
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale ici