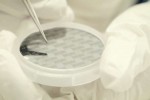Choisir sa contraception, un « parcours du combattant » pour de nombreuses femmes

Choisir sa contraception, un « parcours du combattant » pour de nombreuses femmes
Par Charlotte Chabas
Informations contradictoires, choix imposés, refus à répétition… Face au monde médical, les femmes ont souvent « le sentiment de ne pas avoir la main sur [leur] corps ».
Une personne tient une plaquette de pilules contraceptives dans une pharmacie à Caen, en 2009. | MYCHELE DANIAU / AFP
Le bout de papier est un peu chiffonné, mais on y lit encore le nom et le numéro de téléphone griffonné au Bic bleu. « A Paris, cette petite chose est aussi rare et précieuse qu’un bon coin à champignon », sourit Laure A., 27 ans. C’est une collègue et amie qui lui a refilé le tuyau : une sage-femme « sympa et ouverte, sans liste d’attente interminable, et qui ne se braque pas dès qu’on pose des questions », résume cette commerciale dans un groupe cosmétique. Un « soulagement » pour la jeune femme, qui avait connu auparavant des expériences « décevantes, pour ne pas dire douloureuses ».
A 13 ans, d’abord, chez le médecin de famille qui la suivait depuis sa naissance, dans le Val-d’Oise. « Je venais pour une angine, il a regardé mes seins en me disant qu’il était temps », se souvient Laure A. Temps de quoi ? L’adolescente timide n’ose même pas le demander. « Je piquais un fard dès qu’on me parlait de vestiaires, alors imaginez-moi parler pilule », plaisante cette petite brune aux boucles bien domptées.
Bien sûr, sa mère lui avait déjà parlé sexualité et contraception, « mais ça se résumait encore à “sortez couvert”, et l’image vague d’une sorte de parapluie sexuel ». Pour son plus grand malheur, l’adolescente a « quelques comédons un peu vicieux ». Le médecin lui prescrit le jour même la Diane 35, un médicament antiacnéique détourné pour un usage de contraceptif oral. « Pas une seule fois il m’a demandé si j’avais eu une relation sexuelle ou si je prévoyais d’en avoir une », dit encore la jeune femme avec colère.
La réponse est pourtant non. Aux deux questions. Ce n’est qu’à 18 ans qu’elle connaît sa première expérience sexuelle. « Etait-ce vraiment nécessaire de me faire prendre un traitement pendant cinq ans à une période où tant de choses se jouent ? » s’interroge Laure A., qui ne doute pas que la pilule a eu un rôle dans l’arrivée des « petites rondeurs qui l’ont fait détester si longtemps son corps ».
Le « déclic » Diane 35, retiré du marché
La jeune fille continue pourtant de prendre sa pilule, sans poser de questions. En 2012, Laure a 22 ans. Dans les journaux, à la télévision, on parle de « son » médicament, posé sur sa table de chevet. La Diane 35 est soudain sur le banc des accusés ; on lui impute des thromboses veineuses, plusieurs morts.
Arrivée à Paris pour ses études, Laure A. prend rendez-vous chez une gynécologue de sa rue. Après deux mois d’attente, le rendez-vous est « expédié en quinze minutes ». « Quand je lui ai demandé quels étaient les risques, elle a soupiré en disant que c’était du grand n’importe quoi, mais sans expliquer pourquoi », se souvient-elle.
L’étudiante ressort avec une prescription pour une autre pilule, de deuxième génération cette fois. Quelques mois plus tard, en janvier 2013, la Diane 35 est retirée du marché. Le scandale des pilules de troisième et quatrième générations éclate. « Ça a été un déclic, je me suis dit que pendant neuf ans j’ai pris un truc sans vraiment savoir s’il était bon pour moi », explique Laure A.
« Pas de stérilet pour les femmes qui n’ont pas eu d’enfants »
Après des années à « se laisser faire », elle entre en « crise de boulimie d’informations ». Elle fouille Internet, interroge ses amies, ses cousines, ses collègues, prend rendez-vous chez un autre gynécologue à Paris, avec « beaucoup de questions, mais une piste » : le stérilet en cuivre. « Moins de molécules, des règles plus normales, ça me semblait correspondre à mon envie de revenir à quelque chose d’un peu plus naturel », résume Laure A.
Le soignant refuse pourtant : « Pas de stérilet pour les femmes qui n’ont pas eu d’enfants, point », se rappelle-t-elle. Une assertion longtemps martelée par l’église catholique, qui considérait le dispositif comme abortif, et encore portée par une partie de la profession, malgré les dénégations des spécialistes. Laure A. sort avec une nouvelle prescription de pilules, et « le sentiment de ne pas avoir la main sur [son] corps ». Quelques mois plus tard, une nouvelle gynécologue lui oppose un autre refus, au motif – faux, là encore – que « ça augmente le risque d’infertilité ».
Jusqu’à « la perle rare » de sa collègue, donc, quatre ans plus tard. Première surprise : les sages-femmes sont tout à fait habilitées à prescrire une contraception. « On est restées quarante-cinq minutes à parler, à échanger simplement comme deux adultes », se souvient-t-elle avec émotion. Une batterie d’examens, un nouveau rendez-vous quelques semaines plus tard, et le stérilet est posé. « En quelques mois, j’ai senti mon corps changer, ma libido revenir », dit Laure, qui reconnaît qu’il y a « peut-être un côté psychologique, mais peu importe ».
« Dur de savoir le vrai du faux »
Comme Laure A., nombreuses sont les femmes qui témoignent de leurs difficultés vis-à-vis du monde médical pour parvenir à choisir leur contraception. Dans un appel à témoignages lancé sur Le Monde.fr, elles sont des centaines à avoir multiplié les anecdotes pour raconter ces « refus à répétition », cette « absence de dialogue », ou encore ces « informations contradictoires ».
« Dur de savoir le vrai du faux quand des professionnels ont des avis si différents », raconte ainsi Anne B., 26 ans, qui, elle aussi, a dû faire plusieurs rendez-vous avant de trouver quelqu’un pour lui poser un implant contraceptif, en Picardie. « Pour les autres, c’était une hérésie », précise-t-elle, malgré le fait que, pour une grosse fumeuse comme elle, la pilule ne semblait « pas franchement le plus adapté ». Les gynécologues se contentent de lui « conseiller d’arrêter la clope ». « C’est devenu un tel réflexe de mettre tout le monde sous pilule », résume la jeune femme, qui n’hésite pas à parler de « parcours du combattant » pour choisir sa contraception.
Un « climat de défiance » généralisé
Pourtant, les controverses autour de la pilule contraceptive ont accentué la demande d’informations de la part des patientes. Lise, 34 ans, raconte ainsi sa « panique incontrôlable » au moment des premières publications sur le sujet. La conscience, soudain, d’être peut-être en train de « détruire [son] corps ».
Cette assistante maternelle de Perpignan a dû, elle aussi, changer de gynécologue pour trouver quelqu’un de « simplement ouvert à la discussion, qui a pris le temps d’apaiser mes craintes ». Elle l’a trouvé sur Gyn & co, une plate-forme participative qui répertorie, grâce aux commentaires des patientes, les soignants jugés « women friendly ». « Sur quelque chose d’aussi intime, c’est difficile de trouver quelqu’un avec qui on se sent en confiance », affirme-t-elle. Aujourd’hui, elle est toujours sous pilule, mais « c’est désormais un choix éclairé, qui correspond le mieux à ma situation, pas quelque chose qu’on m’a imposée ».
Pour Dominique Baranger-Adam, sage-femme libérale à Nantes, « les femmes ne veulent plus subir leur contraception, mais en être actrices ». Une nouvelle attitude qui « oblige les soignants à se remettre en question », se réjouit celle qui s’est toujours battue pour « laisser le choix aux femmes ». « Notre rôle est de remettre à plat les options, combattre les préjugés sur telle ou telle contraception douloureuse ou dangereuse, se former, rassurer », rappelle Mme Baranger-Adam, soulignant que « rien n’est définitif et tout s’adapte ».
Une étape « indispensable » selon la sage-femme pour lutter contre « un climat de défiance » de plus en plus généralisé contre l’univers médical, et notamment ses liens avec les laboratoires. A 33 ans, Eugénie F. a ainsi choisi de renoncer à toute contraception. Depuis huit ans, cette géomètre n’a pas vu de gynécologue, tétanisée à l’idée de retomber sur quelqu’un qui « la traitera de folle parce qu’elle a choisi de ne plus rien prendre ». Elle en sait pourtant les conséquences, et vit désormais avec « cette peur de découvrir un jour un gros problème de santé non traité ».