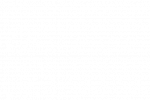« La mise en esclavage d’Africains est-elle plus acceptable en Mauritanie qu’en Libye ? »

« La mise en esclavage d’Africains est-elle plus acceptable en Mauritanie qu’en Libye ? »
Par Yann Gwet
Environ 13,6 % des esclaves dans le monde se trouvent en Afrique subsaharienne, précise notre chroniqueur. Sans susciter l’indignation.
De nombreux Africains ont exprimé leur indignation suite à un reportage de CNN montrant un marché d’esclaves en Libye. Sur Facebook, la bannière numérique « Je dis NON à l’esclavage en Libye – L’homme NOIR n’est pas une marchandise » était incontournable. A l’appel d’associations et de personnalités, une foule en colère a défilé dans les rues de Paris samedi 18 novembre.
Pour des raisons évidentes, cette colère est justifiée et son expression est salutaire. Mais elle soulève des questions que nous aurions tort d’ignorer. D’après l’Index global sur l’esclavage, environ 46 millions de personnes, dans 167 pays, étaient en situation « d’esclavage moderne » (travaux forcés ou mariages forcés) en 2016.
Sinistre catégorie
L’Afrique subsaharienne n’est pas épargnée. Un rapport conjoint du Bureau international du travail et de la Walk Free Foundation publié en août recense qu’environ 13,6 % des esclaves dans le monde se trouvent dans cette partie du monde. Dans cette sinistre catégorie, les lauréats sont la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et la Mauritanie. Dans ce dernier pays, le cas des militants anti-esclavagistes Moussa Biram et Abdallahi Mattalah, en prison depuis novembre 2016, a pourtant été médiatisé sans susciter de levée de boucliers.
Pour autant, des pays comme le Ghana, le Nigeria, l’Ethiopie et même l’Afrique du Sud – notamment via l’industrie du sexe – sont aussi concernés par une pratique qui prend certes plusieurs formes et impliquent différents types d’acteurs, mais dont le principe reste identique : la marchandisation de l’homme par l’homme.
Dès lors, la question se pose de savoir si pour certains d’entre nous la mise en esclavage d’Africains est plus acceptable au Soudan ou en Centrafrique qu’en Libye. L’esclavage intra-africain aurait-il une forme de légitimité ? Tout aussi préoccupante est notre dépendance collective à l’image. Il y a fort à croire en effet que c’est moins la réalité de l’esclavage des Noirs, qui n’est donc pas nouvelle et est suffisamment documentée, qui a ému les classes moyennes africaines, que son image – le fait de voir cet esclavagisme en action.
Tout aussi révélateur est cet appel quasi unanime à la classe politique africaine pour qu’elle s’insurge contre le scandale libyen. Outre que plusieurs leaders africains seraient bien inspirés de mettre fin à l’esclavage chez eux, n’est-il pas évident que nos dirigeants sont une partie du problème et non sa solution ? Après les révélations des « Panama Papers », celles, plus récentes, des « Paradise Papers » confirment, si besoin est, qu’une grande partie de l’élite africaine est obsédée par le pillage massif des ressources de nos pays. Mais peut-être faut-il une vidéo, courte de préférence, d’un grand média occidental montrant tel ou tel dirigeant africain en train de virer des millions de dollars dans son compte personnel pour nous voir – les classes moyennes africaines – déferler devant nos palais présidentiels ?
Je ne doute pas que beaucoup des indignés du moment savent que nos leaders et la nature des régimes qu’ils incarnent, bien souvent avec l’appui des puissances occidentales, sont la cause du problème. Mais il est plus commode de s’attaquer à la conséquence plutôt qu’à la cause de ce problème. Car s’attaquer à la racine du mal supposerait deux conditions : d’abord reconnaître l’ampleur de ce mal.
Cette passion de la légèreté
En 2017, l’Afrique reste de loin le continent le plus pauvre, celui dont les indices de développement ont progressé le moins vite depuis cinquante ans, celui où les êtres humains mènent la vie la plus inhumaine. Le scandale libyen tant décrié résulte en grande partie de cette indignité. Mais la réalité de l’Afrique intéresse moins les classes moyennes africaines que l’image que celles-ci veulent véhiculer du continent (pas si pauvre, pas si misérable, etc.).
Emprisonnées dans le confort d’un afroptimisme compulsif, elles ignorent cette réalité pour mieux faire valoir leurs intérêts. Il n’y a qu’à prendre place dans une de ces conférences qui pullulent sur le continent, où se succèdent des Africains globalisés et satisfaits d’eux-mêmes qui expliquent que « c’est ici que ça se passe », qu’on « sent bien que les choses bougent », ou encore que « l’Afrique est le continent de l’avenir », pour s’en convaincre.
Ensuite, il faudrait, d’une manière ou d’une autre, s’engager dans le combat politique. Sur ce point, l’histoire est formelle : seule la détermination d’hommes et de femmes organisés autour d’un idéal commun change le monde. Or, à une époque où le « jeune entrepreneur africain », nécessairement « innovant », qui multiplie les applications comme d’autres les brevets de recherche, incarne la figure du héros africain, les choses sont mal engagées.
Raymond Aron avait raison : « L’Histoire est tragique. » Nous n’en avons pas assez conscience. Elle n’a que faire des bons sentiments et des indignations vertueuses, elle ne récompense pas les belles âmes, elle ne se soucie même pas de justice. Tant que nous ne nous guérirons pas de cette passion de la légèreté qui nous habite, alors l’Histoire nous sera impitoyable. La preuve.
Yann Gwet est un essayiste camerounais.