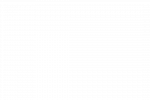En Syrie, une « Pax Poutina » compliquée
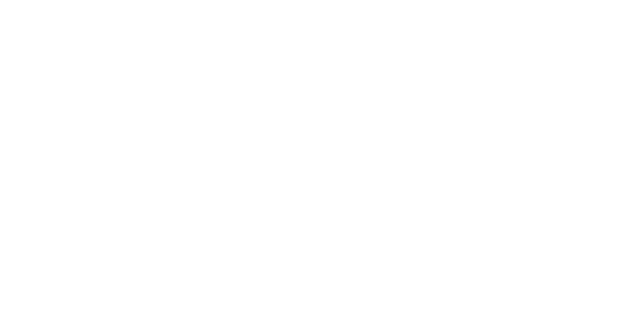
En Syrie, une « Pax Poutina » compliquée
Editorial. Célébrant, le 11 décembre, sa victoire sur le sol syrien aux côtés de Bachar Al-Assad, Vladimir Poutine a annoncé du retrait d’une « partie significative » des forces russes du pays.
Le ministre de la défense russe et les présidents russe et syrien aux côtés de militaires sur la base de Latakia en Syrie, le 11 décembre. / SPUTNIK / REUTERS
Editorial du « Monde ». En passe de gagner la guerre en Syrie, Vladimir Poutine voudrait désormais y imposer sa paix. L’annonce du retrait d’une « partie significative » des forces russes déployées dans le pays laisse d’autant plus sceptiques les Occidentaux que le président russe a déjà fait une telle promesse en mars 2016, sans qu’elle soit suivie d’effet. De son propre aveu, la base aérienne de Hmeimim, comme la base navale de Tartous, piliers du déploiement russe, devraient rester « opérationnelles ».
Les déclarations de l’homme fort du Kremlin, qui a célébré le 11 décembre sa victoire sur le sol syrien aux côtés de Bachar Al-Assad avant de rencontrer au Caire le maréchal Sissi, puis le président Recep Tayyip Erdogan à Ankara, n’en sont pas moins hautement symboliques. Moscou est redevenu incontournable au Moyen-Orient. Cette séquence met fin à un déclin de l’influence russe commencé avant même la chute du Mur, au milieu des années 1970, quand l’Egypte d’Anouar Al-Sadate expulsa les conseillers soviétiques pour rejoindre le camp occidental.
Malgré ses fragilités internes et un PIB désormais inférieur à celui de l’Italie, la Russie de M. Poutine a retrouvé son rang. A même d’intervenir de nouveau loin de ses frontières quand ses intérêts sont en jeu, Moscou s’affiche aussi suffisamment responsable pour trouver des issues diplomatiques aux crises de la région.
Sa force s’exprime surtout à l’aune de la faiblesse des Occidentaux. En premier lieu, celle des Etats-Unis, dont la stratégie dans la région se révèle erratique. Moscou s’active en Libye et renoue avec l’Arabie saoudite, recevant le roi Salman, tout en préservant son alliance avec l’Iran, l’autre grand soutien de Damas. Face aux Occidentaux, qu’il accuse de manigancer des changements de régime au nom de leurs prétendues valeurs, le maître du Kremlin se pose en défenseur d’un ordre international alternatif où la défense de la souveraineté des Etats sert avant tout d’alibi au maintien des régimes en place. Y compris les plus sanguinaires.
Un succès fragile
A l’été 2013, M. Poutine avait remporté un premier succès en proposant un démantèlement de l’arsenal chimique syrien sous l’égide de l’ONU. Il avait ainsi offert une porte de sortie à Barack Obama, qui, malgré la ligne rouge fixée par lui-même, était réticent à mener des frappes contre un régime ayant utilisé le gaz sarin contre sa population.
En septembre 2015, l’intervention militaire russe, la première depuis la fin de la guerre froide hors de l’ex-espace soviétique, sauva Bachar Al-Assad. La Russie a réussi à changer la donne en écrasant la rébellion sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, alors que jamais les djihadistes de l’organisation Etat islamique n’ont été ses cibles principales.
Ce succès n’en reste pas moins fragile, d’où la crainte d’un enlisement et la nécessité de trouver une solution diplomatique. Malgré le relatif succès des quatre « zones de désescalade » instaurées sur le terrain avec l’aide de l’Iran et de la Turquie, Moscou peine à lancer un véritable processus politique. Le congrès des peuples syriens, censé réunir à Sotchi toutes les composantes politiques et ethniques du pays, a été déjà trois fois reporté.
Le montant de la reconstruction est estimé entre 200 et 400 milliards d’euros. Les capitaux occidentaux, notamment européens, sont indispensables. Ceux-ci ont ainsi les moyens de peser pour que le processus diplomatique aboutisse à une véritable transition et non pas à un simple ravalement du régime comme le voudrait Moscou. Mais en ont-ils la volonté ?