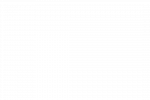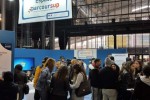Le Conseil constitutionnel valide l’assignation à résidence antiterroriste

Le Conseil constitutionnel valide l’assignation à résidence antiterroriste
Par Franck Johannès
La haute juridiction a émis deux « réserves » sur un article de la loi antiterroriste de novembre 2017, mais valide globalement les conditions d’assignation à résidence.
Le Conseil constitutionnel a légèrement encadré, vendredi 16 février, l’assignation à résidence prévue par la loi sur le terrorisme, entrée en vigueur le 1er novembre 2017, après la période d’état d’urgence. Il valide dans le même temps le principe même de cette surveillance dans le droit commun, ce qui augure mal des autres mesures qu’il sera susceptible d’examiner par la suite.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soulevée par les avocats William Bourdon et Vincent Brengarth, s’interrogeait notamment sur « l’absence d’articulation », entre la période d’état d’urgence, pendant laquelle leur client Farouk Ben Abbes, soupçonné d’appartenir à la mouvance islamiste radicale, avait été assigné à résidence deux ans durant, et la nouvelle loi, qui a de nouveau limité sa liberté d’aller et venir. « Nul n’a cependant pour destinée d’être sous le joug d’une mesure de police perpétuelle parce qu’il n’existerait aucun fondement à d’éventuelles poursuites », avaient soutenu les avocats.
L’assignation ne peut pas excéder un an
Le Conseil n’a pas jugé utile un régime transitoire, mais a validé le cadre de l’assignation, ordonnée par le ministère de l’intérieur. Il a d’abord rappelé, conformément à la loi, que la mesure ne peut être prononcée « qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme », et à une double condition : qu’il existe, d’une part, « des raisons sérieuses de penser » que la personne constitue une menace « d’une particulière gravité », et d’autre part l’administration « doit prouver » que le suspect a des relations avec des organisations terroristes ou qu’il adhère à leurs thèses.
Si ces conditions sont remplies, la personne assignée ne peut pas l’être dans un périmètre « inférieur au territoire de la commune », qui doit lui permettre « de poursuivre une vie familiale et professionnelle ». L’assignation à résidence ne peut ensuite être prononcée ou prolongée que pour une durée maximale de trois mois. Au-delà de six mois, après donc une prolongation, le ministère de l’intérieur doit produire « des éléments nouveaux ou complémentaires » pour justifier sa décision, et l’assignation ne peut de toute façon pas excéder un an.
Une décision « cosmétique »
Cependant, « compte tenu de la rigueur » de la mesure d’assignation, le Conseil a assoupli le délai de recours : il était possible de contester l’assignation devant un juge administratif dans un délai d’un mois, le juge ayant ensuite deux mois pour trancher. Il s’agit là pour le Conseil constitutionnel « d’une conciliation manifestement déséquilibrée » entre la liberté de mouvement et l’ordre public, les mots « dans un délai d’un mois » sont supprimées de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : un assigné à résidence pourra contester la mesure tout le temps où elle s’exercera.
En cas de renouvellement du placement en résidence, l’intéressé pourra saisir dans les quarante-huit heures le juge des référés, « afin qu’il ordonne toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés » – le recours est suspensif, c’est-à-dire que la personne n’est plus assignée le temps (très bref, de l’ordre de quarante-huit heures) que le juge tranche. Par ailleurs, si le contrôle du juge des référés est d’ordinaire limité « aux atteintes graves et manifestement illégales », le Conseil autorise désormais le juge à se pencher sur « la régularité et le bien fondé » du renouvellement – pour ne pas trop bousculer la justice administrative, cette décision ne sera appliquée qu’à partir du 1er octobre.
Le reste de l’article de loi est validé, et ne pourra plus être contesté par une QPC. Les avocats sont évidemment déçus de cette décision « cosmétique ». « Le Conseil constitutionnel n’a pas pris ses responsabilités, indiquent Mes Bourdon et Brengarth, il entérine le principe d’une assignation à résidence déguisée, pour pouvoir la fondre dans le droit commun. Sa motivation très péremptoire sauve les apparences, avec des réserves très accessoires qui ne remettent pas en cause le principe même de la mesure individuelle de surveillance. »