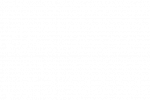Les couples à l’épreuve de l’expatriation

Les couples à l’épreuve de l’expatriation
Par Jessica Gourdon
Les MBA, tout comme les diplômes des grandes écoles de commerce, débouchent souvent sur une carrière à l’étranger, qui peut être source de sacrifices pour les conjoints, le plus souvent des femmes.
Anne-Cécile Dewavrin se rappelle bien de cet e-mail, reçu un jour de mars 2013. Il était adressé à tous les conjoints des élèves du MBA de l’Insead, la grande école de Fontainebleau. Les destinataires – la liste comprenait une écrasante majorité de femmes – étaient invités à partager leur « recette préférée », en vue de la constitution du « livre de cuisine » de la promotion des maris. « Là, je me suis dit, c’est dingue, je suis entrée dans le monde des Mad Men », se souvient la jeune femme, qui travaillait alors comme avocate en droit des sociétés dans un cabinet parisien.
Ce n’était que le début. Quelques mois plus tard, Anne-Cécile Dewavrin a plié bagages, direction le New Jersey, aux Etats-Unis. Son mari y a décroché, à la sortie de l’Insead, un poste chez Suez. Terminé le métier d’avocate – son diplôme français ne lui sert à rien de ce côté de l’Atlantique. A 32 ans, elle se retrouve à la maison avec deux jeunes enfants et, face à elle, « un grand vide ».
« Je n’avais aucun entourage amical, aucun entourage familial, aucun réseau professionnel. Mais ce que je n’avais pas anticipé, c’est la perte de mon statut social. Que j’allais devenir la “femme de”, c’est-à-dire rien du tout », se rappelle-t-elle. Elle tente de chercher un travail, fréquente les réseaux de conjoints d’expatriés, peuplés de femmes dans sa situation. « C’était rassurant, mais c’était aussi un miroir grossissant de ce que je ne voulais pas être, raconte Anne-Cécile Dewavrin. Il y a chez beaucoup de conjoints de la frustration, ou du renoncement. Alors qu’on avait toutes des boulots en France, on se retrouve dans des vies dignes des années 1960. » Quant à son mari, il accuse le coup lui aussi : « Il se sentait coupable, cela lui pesait, bref c’était la cata. On a mis plus d’un an à atterrir. »
Des conjointes plus diplômées qu’avant
Cette situation, de nombreux jeunes expatriés sont amenés à la connaître. Car lorsqu’il s’agit de déménager en couple à l’étranger, certaines choses ne changent pas : ce sont presque toujours des femmes qui « suivent » des hommes – dans 92 % des cas, selon une enquête récente menée auprès de 3 000 expatriés par la Caisse des Français de l’étranger (CFE) et Expat Communication.
Si cette configuration n’est pas nouvelle, elle l’est dans son ampleur, à mesure que la proportion des jeunes actifs effectuant tout ou partie de leur carrière à l’étranger augmente. Selon la dernière étude de la Conférence des grandes écoles, trois ans après leur diplôme, 27 % des jeunes issus d’écoles de commerce sont en poste à l’international (ils étaient moitié moins il y a dix ans). Cette tendance est encore plus présente pour les MBA. Ainsi, la moitié des élèves du MBA de HEC trouvent leur premier emploi post-diplôme ailleurs que dans leur pays d’origine.
Mais la vraie nouveauté tient aux attentes de ces conjoints, bien différentes de celles d’hier, constate Alix Carnot, l’une des dirigeantes d’Expat Communication. « Depuis une dizaine d’années, c’est une évidence que les femmes qui suivent leur compagnon à l’étranger veulent travailler et progresser dans leur carrière, souligne-t-elle. Mais globalement, cela reste très compliqué, car ces femmes se retrouvent sans réseau, avec parfois des visas qui ne permettent pas de travailler sur place, des diplômes non reconnus, des problèmes de langue, des salaires locaux peu incitatifs… Alors souvent la déception est forte, car ce sont des femmes qui ont investi dans leurs études. Dans notre enquête, 76 % des conjoints accompagnateurs avaient un bac + 4 ou plus. »
Toujours selon cette étude de la CFE, seulement 46 % des conjoints expatriés ont trouvé un emploi, pour moitié à temps partiel. Alors qu’avant le départ 73 % travaillaient. En outre, un tiers des sondés estiment que l’expatriation est une « rétrogradation » dans leur carrière. Alix Carnot souligne les risques de cette situation : « Le couple se retrouve en plein décalage, avec cette question de la dépendance financière à gérer, et une répercussion directe sur le bien-être des deux personnes. »
D’autant que naguère, lorsque un ou une cadre était envoyé à l’étranger pour trois ou quatre ans, la prise en charge du conjoint faisait souvent partie du « package » de l’expatrié, avec des aides à la recherche d’emploi sur place, des cours de langue… « Aujourd’hui, la plupart des gens arrivent avec des contrats locaux. Du coup, c’est à chacun de se débrouiller. Et c’est d’autant plus dur qu’il n’y a pas de durée précise, tout peut se terminer au bout d’un an ou au bout de dix ans », constate Magdalena Zilveti, coach spécialisée dans la reconversion des conjoints expatriés.
Des réseaux via les écoles
Pour préparer leurs élèves à ces défis, certaines écoles de commerce ont mis en place des dispositifs, particulièrement pour leurs élèves de MBA. Des étudiants davantage confrontés à la problématique du couple en expatriation en raison de leur âge moyen (autour de 30 ans). A l’Insead ou à l’IMD de Lausanne, des groupes Facebook permettent aux conjoints du MBA d’échanger, notamment sur le sujet des doubles carrières et des défis de l’expatriation. Les écoles leur permettent aussi de participer aux clubs et activités de networking.
« On sent cette problématique monter, et on a d’ailleurs beaucoup plus de couples présents sur le campus. Depuis peu, on invite les conjoints au week-end d’intégration, pour qu’ils développent leur réseau », illustre Benoît Banchereau, directeur des admissions du MBA de HEC. A Fontainebleau et Lausanne ont aussi été mis en place des ateliers pour les « partenaires », afin de les aider à valoriser leurs parcours dans une perspective de carrière internationale plus subie que choisie et d’apprendre à « gérer le changement ».
Une fois le diplôme en poche, chaque couple a sa stratégie. « Les décisions d’emplois sont le fruit de négociations, constate Benoît Banchereau. “D’accord pour tel endroit, mais pas pour tel autre”. Ou alors : “Un coup c’est toi qui choisis, un coup c’est moi”… »
Un sentiment de sacrifice
Reste que, dans les faits, c’est souvent celui qui a la première opportunité sérieuse qui décide du lieu d’emménagement. C’est ce qui s’est passé pour Amaia Guillé et Alexandre Le Cann. Ces deux ingénieurs trentenaires sont tous les deux diplômés du MBA de l’Insead, à une promo d’écart. Quand Alexandre a décroché un poste à Montréal, Amaia a cherché un emploi dans la même ville. Mais celui qu’elle a trouvé est un peu en deçà de ce qu’elle imaginait.
« C’est un poste qui est très bien, mais pas idéal, car il y a beaucoup de déplacements. Et en termes de salaire, si je n’avais pas été contrainte de chercher à Montréal, j’aurais sans doute pu avoir mieux », estime-t-elle. Tout est affaire de compromis. « Le risque, c’est que l’un sente qu’il se sacrifie pour l’autre, reconnaît Alexandre. On a des discussions ouvertes là-dessus, car c’est un problème majeur. D’autant que, aujourd’hui, il est devenu difficile de trouver un bon poste en contrat local à l’étranger. La concurrence est bien plus forte qu’il y a une dizaine d’années. »
« Les écoles devraient davantage aborder ces questions, et mieux poser la problématique du coût des carrières internationales à tous les niveaux », estime Anne-Cécile Dewavrin, qui a finalement trouvé son chemin aux Etats-Unis en s’inscrivant dans un master et en travaillant à temps partiel pour une ONG d’aide juridique aux demandeurs d’asile.
D’autres créent une entreprise, changent de carrière, exercent un métier à distance, explorent une passion artistique…Laure Pallez, qui avait quitté un poste à la Société générale pour suivre en Chine son conjoint diplômé du MBA de HEC, a réussi à transformer ce défi en force. « Au début, c’était difficile, car je me suis retrouvée dans une situation que je ne trouvais pas très juste. Mais j’ai appris le chinois, j’ai repris des études, je me suis ouverte à d’autres choses », explique cette diplômée de HEC.Trois ans plus tard, elle a obtenu un poste à l’Institut Pasteur de Shanghaï.
Après neuf années en Chine et un passage en Floride, Laure Pallez vient d’être embauchée au service économique de l’ambassade de France aux Etats-Unis. Et cette fois, c’est son mari qui l’a suivie.
Participez au MBA Fair du Monde, samedi 17 mars à Paris
Le groupe Le Monde organise, samedi 17 mars, au palais Brongniart, à Paris, la huitième édition du MBA Fair, le Salon des MBA & Executive Masters.
Cet événement est destiné aux cadres qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière, et renforcer leur employabilité. Sont attendus les responsables de plus de 35 programmes de MBA et d’Executive Masters parmi les plus reconnus des classements internationaux, dans des domaines variés : stratégie, marketing, finances, ressources humaines et management… Des conférences thématiques animées par un journaliste du Monde, ainsi que des prises de parole organisées par les écoles présentes sont également prévues.
L’entrée est gratuite, la préinscription est recommandée pour éviter l’attente.
Ce Salon sera précédé de la publication, dans Le Monde daté du jeudi 15 mars, d’un supplément sur les MBA, à retrouver également sur notre page Lemonde.fr/mba.