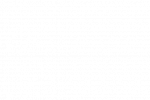Au Maroc, les enfants perdus des rues de Tanger

Au Maroc, les enfants perdus des rues de Tanger
Par Rémi Carlier (Tanger, envoyé spécial)
Dans le royaume, 25 000 mineurs sont sans abri. Des associations tentent de les sortir de la précarité en leur proposant un hébergement ou une formation.
A Tanger, la nuit a englouti toute la misère. Sur la place du Grand-Socco, l’animation du marché et les klaxons des taxis font place à une autre forme de manège, plus lugubre. Chancelantes, avachies sur un trottoir ou lancées dans des éclats de rire juvéniles et sans joie, des silhouettes fantomatiques apparaissent et s’installent sous les porches, aux abords du cinéma Rif. Leurs voix parfois fluettes et leurs traits fins ne trompent pas : beaucoup sont à peine adolescents.
Oussama a 15 ans. Originaire de Nador, à 400 km de Tanger, il est venu dans la ville du détroit pour fuir la misère dans laquelle il s’est retrouvé après le divorce de ses parents. Ses grands yeux sont couverts d’un voile d’absence. Extrêmement maigre sous sa parka trop grande, il sourit nerveusement et demande sans arrêt quelques dirhams. « Il n’y a pas de travail au Maroc. Dans cinq jours, je serai en Espagne ! », lance-t-il avec défiance, avant d’inspirer à pleins poumons dans un tissu exhalant une forte odeur de peinture industrielle.
Lui-même n’y croit pas. Voilà deux ans qu’il erre dans les rues de Tanger, sniffant de la colle, qui lui procure une traîtresse sensation de satiété et de bien-être.
« Le rêve de partir »
Des jeunes sans-abri comme Oussama, les grandes villes du Maroc en regorgent. Tous ont fui ou ont été chassés de leur foyer après un drame. Maltraitance, décès d’un ou des deux parents, divorce, extrême pauvreté… Le dynamisme citadin les a attirés comme des lucioles, puis les a avalés dans un désespoir entretenu par les bandes et la drogue. En 2015, l’Observatoire national des droits de l’enfant estimait qu’ils étaient 25 000 à vivre dans les rues, dont un quart à Casablanca.
A Tanger, impossible de savoir combien ils sont, surtout depuis que le grand port de la ville, où beaucoup avaient leurs habitudes, a été déplacé à 40 km plus à l’est. Pour Mohamed Taieb Bouchiba, correspondant local de l’association Touche pas à mon enfant, ils sont encore « quelques centaines » et sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les villes côtières du nord du royaume. « Leur dénominateur commun, c’est le rêve de partir », confie-t-il.
Tanger, où le roi Mohammed VI a lancé en 2013 un grand projet de modernisation et d’accueil d’entreprises pour en faire l’un des principaux pôles économiques et touristiques du Maroc, vend aussi le rêve d’une vie meilleure. Depuis 2004, sa population a doublé pour atteindre 1,1 million d’habitants et elle continue de grimper en flèche, l’exode rural apportant son lot de misère. Pour y faire face, des initiatives, principalement de la société civile, ont vu le jour.
L’association Qulub Alrahima (« cœur clément ») effectue des maraudes deux fois par semaine pendant l’hiver pour donner de la nourriture et des couvertures aux sans-abri. « Environ 30 % de ceux que nous rencontrons sont des mineurs. On n’arrive pas vraiment à les aider, ils veulent seulement partir en Europe », explique Hakima Komairi, la secrétaire générale de l’association. « Quand ces enfants passent quelques jours dans la rue, ils deviennent des caïds. C’est très difficile de travailler avec eux. Ils mentent sur leur nom, l’adresse de leurs parents. Quand on les installe dans des centres d’accueil, ils s’évadent à chaque fois », déplore Mohamed Taieb Bouchiba.
« Un travail de longue haleine »
Le gouvernement marocain, signataire de la Convention internationale des droits de l’enfant, s’est engagé depuis longtemps à lutter contre le phénomène. « Le gouvernement a lancé le programme Indimaj, visant à éradiquer le phénomène des enfants vivant ou travaillant dans les rues. Les unités de protection de l’enfance ou le SAMU social fournissent une assistance d’urgence. Cependant, ces actions restent insuffisantes », signale l’Unicef dans un rapport de 2015.
A Tanger, presque toute l’aide de l’Etat est fournie par l’Entraide nationale. L’institution a mis en place un programme spécifique aux mineurs vivant dans la rue, gère deux établissements de protection sociale et un complexe social, Assadaka, qui accueille plus de 400 enfants en difficulté. La directrice régionale de l’Entraide, Zineb Oulhajen, avoue que toutes les initiatives « ne suffisent pas » : « Beaucoup d’enfants ne coopèrent pas et on ne peut pas les obliger à venir dans nos centres. C’est un travail de longue haleine. » Elle est néanmoins optimiste : « Si vous aviez vu le Tanger d’il y a dix, vingt ans… Les efforts et les progrès ont été énormes ces dernières années. Le nombre d’initiatives sociales a quadruplé, notamment pour la création de structures sociales dans les quartiers périphériques. »
« Le gouvernement est encore trop timide, il faut une vision sûre et dure », énonce Mohamed Taieb Bouchiba, qui prône la formation et le financement par l’Etat de travailleurs sociaux, pour œuvrer en contact direct et quotidien avec les enfants, et la prévention en amont, dès le plus jeune âge.
« Grande précarité »
C’est ce créneau qu’a choisi de suivre ces dernières années l’association Darna (« notre maison »). Créée en 1995 pour répondre au phénomène des enfants vivant dans la rue, elle a ouvert une maison communautaire proposant des activités périscolaires à ceux qui sont encore au primaire et une formation professionnelle pour ceux qui ont laissé tomber les études (au Maroc, l’école est obligatoire jusqu’à 15 ans, mais près d’un enfant sur trois est déscolarisé avant cet âge). « Tous ceux que nous accueillons sont issus de la grande précarité. Les autorités ne répondent pas aux problèmes que posent les nouvelles populations de la ville, leurs programmes ne sont pas adaptés à l’exode rural, qui va trop vite », lance Mounira Bouzid El Alami, présidente de l’association.
A l’atelier de couture du centre, Myriam, 17 ans, s’entraîne à confectionner un pantalon sous l’œil de la formatrice. Depuis quatre ans, elle qui n’a « rien appris à l’école » se rend dès qu’elle peut à Darna : « Mes parents ont divorcé, mon père s’est remarié et ne s’intéresse pas à moi. Ma mère, seule, n’a pas les moyens de s’occuper de moi. » Sans l’association, elle serait « allée dans la rue ».
Pour les adolescents déjà installés dans la rue, l’espoir est mince. Les dommages occasionnés par la colle sur le long terme sont graves et ceux qui ont quitté l’école dès le primaire pourront difficilement se réinsérer. Omar, qui traîne depuis quatre ans dans le quartier d’Iberia, une profonde cicatrice sur le front, ne rêve que d’Espagne. Mais il a perdu sa force et sa volonté dans la drogue, qu’il prend, dit-il, « pour se perdre ».