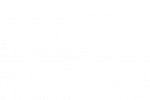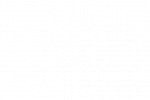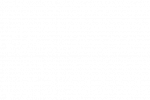En Ethiopie, le développement rural passe par l’emprisonnement

En Ethiopie, le développement rural passe par l’emprisonnement
Par Sabine Planel
Plongée dans des prisons d’Afrique (4/7). Contraints d’acheter l’engrais à crédit, les petits paysans sont asphyxiés par un système répressif.
En Ethiopie, la prison révèle des usages surprenants. L’emprisonnement y est utilisé à des fins « développementales », pour reprendre la terminologie du parti au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire (EPRDF). Pour les autorités publiques, il doit permettre d’améliorer la capacité de remboursement de paysans endettés auprès du ministère de l’agriculture. En effet, les fermiers achètent, souvent à crédit, de l’engrais dans le cadre des programmes d’Etat de modernisation agricole. Pour les paysans, ce système perpétue sous des formes renouvelées les pratiques autoritaires des fonctionnaires.
Mana est un paysan wolayta du Sud de l’Ethiopie. Il exploite une terre d’environ 2 000 m2, sur laquelle il cultive principalement des céréales et des légumineuses destinées à une consommation familiale. Avec une seule tête de bétail et un terrain trop petit, il peine à nourrir une famille de cinq enfants, et ne peut évidemment pas être rentable.
La « dette de l’engrais »
En situation d’insécurité alimentaire chronique, il ne compte pourtant pas parmi les plus vulnérables de ses voisins, lesquels représentent environ un tiers de la population rurale. Mais, Mana souffre comme eux d’un problème grandissant dans l’Ethiopie rurale : la « dette de l’engrais », qui individuellement ne dépasse pas la centaine d’euros, mais concerne des millions de paysans. Cet endettement grève leur budget, contraint leur gestion agricole, et révèle une fois de plus le visage autoritaire et coercitif du pouvoir en place. Pour les plus pauvres et les plus vulnérables de ces petits agriculteurs désargentés, l’achat d’engrais à crédit se pratique donc sous la contrainte.
Et parfois la situation se complique. Mana en a fait l’amère expérience. En 2013, il a acheté à crédit un quintal d’engrais à la coopérative agricole, qu’il a remboursé après les grandes récoltes de septembre – en un seul versement, signe d’une relative prospérité. Il pensait avoir soldé sa dette, mais les agents de développement lui ont alors demandé de rembourser davantage, arguant du fait qu’il avait commandé deux quintaux et non un seul. Ils ont produit, devant témoins, un document qu’il n’avait pas signé, mais que d’autres avaient certifié en son nom.
Se refusant à payer, Mana a été emmené par la milice armée de la commune au poste de police. Il est resté pendant trois semaines dans la prison communale, sans procès ni décision administrative formelle. En dépit de ses tentatives pour plaider son innocence et blâmer ses geôliers, il a dû vendre un veau pour rembourser le reste du crédit et sortir de prison.
Depuis, il ne participe plus à ces programmes de vulgarisation agricole et parvient à résister aux sollicitations des agents de développement, à la différence de nombreux de ses voisins. Afin d’échapper au crédit, il achète comptant de l’engrais en toutes petites quantités sur le marché noir et le ramène chez lui à la nuit tombée afin de ne pas se faire arrêter pour contrebande. Ses récoltes sont certes médiocres, mais il se sent plus libre.
Le sommaire de notre série « Plongée dans des prisons d’Afrique »
Le Monde Afrique explore les prisons africaines en partenariat avec la revue Afrique contemporaine (Agence française de développement, partenaire du Monde Afrique) et le projet de recherche Ecoppaf qui étudie « l’économie de la peine et de la prison » en Afrique.
Groupe de recherche constitué en 2015, financé par l’Agence nationale de la recherche (2015-2019) et codirigé par Frédéric Le Marcis (ENS de Lyon, Triangle) et Marie Morelle (Prodig, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne), Ecoppaf se place dans une double perspective : l’étude du quotidien carcéral et celle des sociétés africaines.
De Cotonou à Yaoundé, d’Abidjan à Douala en passant par les prisons rurales éthiopiennes, Bénin City au Nigeria et Ouagadougou, ces sept articles vous feront découvrir, au travers de témoignages inédits, des lieux d’enfermement, des parcours de vie de prisonniers et de gardiens singuliers. Un panorama de la privation de liberté qui permet d’engager la réflexion sur les droits humains, la réforme des Etats en Afrique et les enjeux de démocratisation qui vont de pair avec la lutte contre les inégalités.
Saisie de biens et humiliations
Il n’existe pas à proprement parler de prison dans les campagnes éthiopiennes, où l’ostracisme et la relégation restent des peines plus utilisées que l’enfermement. Les établissements pénitenciers modernes sont l’apanage des grandes villes, comme Sodo ou Addis-Abeba, la capitale du pays. Des enclos rudimentaires souvent attenants au poste de police, constituaient les lieux de détention pour des durées pouvant s’étendre à plusieurs semaines. Désormais, ils sont réservés au bétail confisqué aux paysans. Ces derniers sont maintenant placés en garde à vue dans les postes de police.
Dans le nord du pays, ce sont les bureaux de l’administration locale qui servent de cellules. Les cultivateurs y sont enfermés pour quelques heures, voire quelques jours. Ils y entrent plutôt de nuit, souvent terrorisés. Ici, on les enferme non pas pour accélérer le remboursement d’une éventuelle dette, mais pour les contraindre à acheter leur part d’engrais.
Depuis peu, les paysans endettés et les acheteurs de fertilisants en contrebande ne sont plus détenus dans la prison de Sodo. Aujourd’hui, les juges recourent avec parcimonie aux emprisonnements. Il s’agit moins de punir des paysans insolvables que de servir d’exemple pour le reste de la communauté.
La très grande majorité de fermiers qui échappe désormais à l’enfermement est soumise à une saisie des biens rigoureuse et organisée par les organismes régionaux de microfinance très politisés. Pressé par les instances administratives supérieures de rembourser l’achat des milliers de tonnes d’engrais opéré par les organisations locales, un responsable financier d’un district wolayta exprime ainsi le niveau de contrainte qui pèse sur les fonctionnaires locaux et, a fortiori, sur les agriculteurs : « Maintenant, les paysans doivent payer. C’est eux ou nous. »
Pris dans un cercle vicieux
Ainsi « sollicitées » les autorités locales (police, milice, agents de vulgarisation agricole, coopératives, représentants du gouvernement local, organismes de microfinance et notables locaux) mettent en œuvre des mesures de plus en plus contraignantes et de plus en plus vexatoires. « Les gens du qébelé (« commune ») et du wereda (« district ») nous forcent à payer. Ils prennent notre bétail et si nous n’avons vraiment rien, ils nous emprisonnent », affirme un voisin de Mana. Et de perpétuer ainsi ces pratiques officiellement révolues.
Quand un paysan cesse ses versements partiels, quand il ne répond pas aux relances et convocations des autorités locales, à leurs menaces de saisie de terre, il cède alors souvent à la pression des notables locaux désignés pour lui servir de garants. Pris à la gorge, asphyxié économiquement, l’agriculteur n’a d’autre choix que de vendre son bétail qui sera de toute façon saisi par la milice s’il s’y refuse. Le voilà pris dans un engrenage. Dans tous les cas, il se doit de payer.
Si, enfin, le fermier n’a pas de bétail, ce qui arrive régulièrement, alors l’ensemble de ses biens sera confisqué, quelle qu’en soit la valeur marchande. C’est particulièrement le cas de l’enset, une plante emblématique des systèmes agricoles méridionaux destinée aux périodes de disette, dotée d’une forte valeur identitaire, mais d’une très faible valeur marchande. Les paysans interprètent sa saisie comme une attaque spécifiquement dirigée contre le peuple wolayta. Une humiliation.
Dépendants des aides de l’Etat, les petits paysans se retrouvent pris dans les filets d’un système répressif dont les sanctions rythment leur quotidien. Difficile alors de se plaindre.
Sabine Planel, chercheuse à l’Institut des mondes africains (Imaf) et à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).