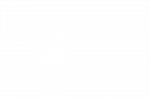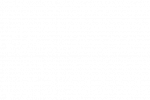Science Tribune en ligne en réponse à Aurélien Barrau : La relativité est une théorie universelle
Science Tribune en ligne en réponse à Aurélien Barrau : La relativité est une théorie universelle
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO
Le physicien José-Philippe Pérez considère que l’analyse de son collègue Aurélien Barrau (« Le Monde » 30 mars 2016) à propos de la détection d’ondes gravitationnelles relève du relativisme sociologique et est difficilement tenable.
Vue d'artiste représentant les ondes gravitationnelles engendrées par l'interaction de deux objets massifs - par exemple des trous noirs. | K. Thorne (Caltech) et T. Carnahan (Nasa GSFC)
Il est habituel aujourd’hui, pour un chercheur scientifique, d’associer à la science les mots « révolution » et « humilité ». Le premier de ces mots relève surtout de l’emphase scientifique ; désormais, il plaît même au marché qui y voit moins une menace politique qu’un argument commercial pour les nouveaux produits à consommer. Le second relève, lui, d’une évidence, car le verdict de la confrontation expérimentale que l’on exige en science implique naturellement l’humilité ; la meilleure preuve est l’effacement de la pensée scientifique devant celle des philosophes, mais surtout devant celle des théologiens de tout bord, pour lesquels la vérité est celle prétendue de leur croyance.
En lisant attentivement la tribune récente d’Aurélien Barrau, du 30 mars 2016, « La science, révolutionnaire par essence, exige l’humilité », on y découvre progressivement la signification originale que donne l’auteur aux deux mots précédents : pour le premier, il s’agit surtout d’une révolution contre la science classique et moderne en place ; pour le second, l’humilité est surtout celle de l’approche de la vérité par la science. On ne peut alors s’empêcher de penser à Victor Hugo affirmant, dans la section « L’Art et la Science » de son livre « William Shakespeare », « La science est l’asymptote de la vérité ».
Une position téméraire mais pas tenable
On découvre aussi, à travers des phrases aussi floues que « la science impose un exercice perpétuel de déconstruction des évidences », « la science n’est pas uniquement une construction sociale », « la science est mouvante et dépendante de l’environnement culturel et intellectuel qui la produit », et aussi éloignées de la pratique scientifique que « chaque nouvelle théorie-cadre est comme infiniment distante de celle qu’elle remplace », que l’auteur propose une « déconstruction de la science » dans le cadre idéologique connu d’un néorelativisme sociologique. Ce point de vue est clairement explicité dans son dernier livre De la vérité dans les sciences (Dunod, 2016), cité dans la même tribune.
Rappelons que le relativisme sociologique est l’attitude qui consiste à affirmer qu’il n’existe aucune valeur qui vaille en tout lieu et à tout instant. C’est à cela que semble tenir l’auteur, dans le domaine strictement scientifique, à la suite du philosophe des années 1970, Paul Feyerabend, aujourd’hui un peu oublié en physique, pour lequel la seule règle qui vaille en science peut-être résumée par « tout est bon » et « rien n’est universel ».
Notons que défendre le relativisme sociologique, dans le milieu scientifique, pour un spécialiste de la relativité d’Einstein (restreinte et générale), est original, voire téméraire, surtout dans le contexte actuel où certains philosophes non scientifiques soulignent aujourd’hui les limites de cette doctrine, même dans son domaine naturel de la sociologie. Il est, en effet, banal de dire que la théorie d’Einstein est mal nommée, tant elle relève davantage de la recherche d’invariants, et donc de l’universalité, que d’un cousinage même lointain avec le relativisme sociologique. C’est ce que rappelle, avec une légère ironie, le titre choisi pour le présent texte, pourtant exact.
Dans la suite, nous donnons quelques exemples, tirés notamment de la théorie d’Einstein qui est notre domaine scientifique commun, pour montrer que la posture de l’auteur, qui relève d’un néorelativisme sociologique, est difficilement tenable.
La science est davantage progressiste que révolutionnaire
Certes la science est révolutionnaire, mais précisons, au risque de décevoir les extrémistes de tout bord, qu’elle l’est de façon douce.
En effet, après analyse, la théorie de la relativité restreinte d’Einstein apparaît plus comme un enrichissement, un raffinement de l’ancienne théorie de Newton, qu’une grammaire radicalement différente. Ainsi, pour des vitesses faibles devant la vitesse de la lumière (constante d’Einstein de valeur exacte 299 792 458 m/s), cette théorie restitue celle de Newton comme une excellente approximation. Peut-être faut-il rappeler que c’est dans le cadre de cette approximation que l’on détermine, avec une précision largement suffisante, le mouvement des satellites artificiels de la Terre, par exemple ceux du GPS ou de Galileo, leur vitesse ne dépassant pas 4 000 m/s. Rappelons la phrase d’Einstein : « c’est le plus beau sort d’une théorie physique (la mécanique de Newton) que d’ouvrir la voie à une théorie plus vaste (la mécanique relativiste), dans laquelle elle continue à vivre comme un cas particulier ».
La seule conclusion de la théorie d’Einstein de 1905, radicalement différente de la mécanique de Newton, est liée au temps, concept subtil que les scientifiques considèrent comme une donnée première qu’ils se contentent de mesurer, avec humilité ; précisément, ils ne mesurent pas le temps, mais la durée entre deux événements, qu’ils comparent à celle d’un étalon de durée. Cet étalon, défini par une transition entre deux niveaux atomiques de l’atome de Césium, permet de réaliser des horloges avec une très grande précision, ce qui est précieux notamment dans les systèmes de localisation spatiale que tout le monde connaît (GPS). L’hypothèse du caractère absolu du temps, formulée par Newton, avait le mérite de l’efficacité dans la prédiction des phénomènes. Certes prédire n’est pas expliquer, mais cela n’a pas empêché les physiciens de prédire des événements, puis de les expliquer avec succès.
La preuve la plus récente et la plus spectaculaire est la détection, le 11 février dernier, des ondes gravitationnelles par les deux interféromètres LIGO. Ainsi, le temps n’est pas absolu, ce qui n’est guère surprenant, lorsqu’on songe à la naïveté de l’hypothèse newtonienne consistant à admettre que la période d’oscillation d’un pendule ne dépend pas du mouvement éventuel de l’observateur qui la mesure. La durée est remplacée par un nouvel invariant, l’intervalle, combinaison de cette durée et de la distance qui sépare les deux événements. La relativité d’Einstein parait finalement moins révolutionnaire que progressiste, même si les horloges en mouvement retardent et si celles en altitude avancent, comme le montre, dans la pratique, les nécessaires corrections relativistes du GPS !
Le mot révolution est souvent utilisé de façon abusive en science, probablement pour des raisons qui relèvent de la communication. Par exemple, dans le livre agréable à lire Il était sept fois la révolution (Flammarion), Étienne Klein raconte, avec humour et talent, moins sept révolutions que sept anecdotes sur des physiciens célèbres, dont les contributions ont été des enrichissements progressifs en physique.
Quant aux annonces à grand bruit sur la mémoire de l’eau, la fusion froide, les neutrinos supraluminiques, ce sont moins des révolutions que des révélations sur l’insuffisance d’une réflexion épistémologique et d’une intégrité sociale.
Oui, la construction de la science exige l’humilité
La construction de la théorie de la relativité est un exemple d’humilité. Pour s’en convaincre, il suffit de lire le texte original d’Einstein de 1905, dans lequel il énonce le principe de relativité, sous la forme d’une simple extension, à toutes les lois de la physique, du principe de relativité de Galilée, lequel privilégiait la seule mécanique. Ce faisant, il rejette le concept de référentiel absolu, fiction introduite inutilement par Newton, pour des référentiels privilégiés dits galiléens. Avec la relativité générale, ces privilèges sont abandonnés pour un système quelconque de coordonnées locales. En langage politique, on dirait que la relativité fournit un exemple de victoire de la démocratie en physique !
Sur le plan de la réflexion philosophique, précisément épistémologique, dont je déplore l’absence dans la plupart des cours de physique, notamment de relativité, il est utile de rappeler la réflexion d’Henri Bergson sur le sujet, dans son livre Durée et simultanéité, publié en 1922, en réponse à la théorie de la relativité restreinte de 1905. Bergson est probablement l’un des rares philosophes du XXe siècle à avoir analysé les travaux de ses contemporains scientifiques sur le temps, précisément sur le retard des horloges en mouvement. Persuadé qu’Einstein était dans l’erreur, il tente d’expliquer au physicien son erreur, lors de sa rencontre avec lui, au siège de la Société Française de Philosophie, et ce faisant, il s’aperçoit que c’est lui qui se trompe ! Il envisage alors l’arrêt de la publication de son livre, ce qui ne sera effectif qu’après la sixième édition en 1931. L’édition accessible aujourd’hui est celle de 1968, avec des compléments précieux sur l’entrevue entre le philosophe et le physicien. Notons que la plupart des philosophes contemporains de Bergson ont persisté dans leur erreur ou l’ont esquivée, en introduisant le concept de temps vécu, ou temps du psychologue, voire du solipsiste, dont l’intérêt reste essentiellement de nature littéraire.
La physique n’est-elle pas apaisante ?
Contrairement à Aurélien Barrau, n’hésitons pas à risquer une définition, sinon de la science, mais de la physique, qui est notre spécialité commune. Rappelons d’abord que le mot physique vient de « Physis », mot grec qui signifie « nature ». La physique se présente ainsi comme une méthode permettant de penser rationnellement la nature, en s’appuyant sur un minimum de principes ou de lois fondamentales, réfutables par l’expérience. Rationalité et réfutation apparaissent alors comme deux caractéristiques essentielles de la physique, les autres domaines, comme la littérature, les arts, voire la religion, étant des activités intellectuelles fondées principalement sur une perception subjective du monde. Cela ne signifie pas que ces domaines ne soient pas concernés par la physique. Ils tiennent même une place significative dans les phases de création et de transmission de la physique. Citons l’exemple du principe de moindre action, initialement formulé par Pierre Moreau de Maupertuis en termes religieux, puis rationalisé par Euler et Lagrange. On sait aussi que l’émotion et la sensibilité jouent des rôles importants dans l’enseignement de la physique et sa vulgarisation.
Comment peut-on affirmer que la science n’est ni rassurante, ni apaisante, et qu’elle impose « un exercice perpétuel de déconstruction des évidences », alors qu’elle produit le plus souvent des lois qui permettent dans de nombreux cas de prévoir les événements à venir, ce qui est au contraire source de sécurité et d’apaisement, évidemment lorsque la sagesse des Hommes ne fait pas défaut ? Contentons-nous de citer les prévisions en astrophysique, en météorologie et sur le réchauffement climatique. Répétons-le : la relativité restreinte d’Einstein ne rejette pas la relativité de Galilée, mais l’intègre comme une approximation.
Un autre exemple remarquable est fourni par l’invention de l’antineutrino par Pauli, avant la découverte de cette particule quelque vingt-cinq ans plus tard. La loi de conservation de l’énergie n’est pas satisfaite dans la réaction de transformation d’un neutron en un proton et un électron, ce qui permet d’expliquer la radioactivité bêta. Dans cette crise, autour de 1930, Niels Bohr ne propose rien moins que d’abandonner le premier principe de la thermodynamique qui, lui, était testé sans réfutation depuis 1852. Pauli résout le problème, non sur le mode législatif, mais par l’ontologie : il introduit une nouvelle particule dont l’énergie est précisément celle qui permet de satisfaire à la conservation de l’énergie.
Nul besoin de déconstruction
Il n’y a pas non plus de grammaire radicalement différente dans le traitement de la gravitation chez Newton et chez Einstein. En effet la nature singulière de la force de gravitation, seule force fondamentale à être proportionnelle à la masse inerte, comme le sont les forces d’inertie opportunes, dont on connaît le caractère artificiel, conduit à renoncer à l’interprétation newtonienne pour une autre, exprimée en termes de courbure de l’espace-temps plat de la relativité restreinte. Sur ce seul exemple, la relativité générale apparaît comme un enrichissement à la fois technique et intellectuel, l’avance du périhélie de la planète Mercure étant prévue avec une bien meilleure précision en relativité générale qu’en mécanique de Newton et avec aussi bien plus de profondeur et d’élégance.
Terminons par un dernier exemple, dans lequel l’auteur, adepte de déconstruction, en déduit, dans son livre de relativité générale, une différence conceptuelle majeure entre la conservation de l’énergie en mécanique newtonienne et sa transposée quantique, la place de la masse inerte, dans les équations, lui paraissant anormalement différente. Il y a ici une simple erreur d’inattention, car on retrouve le lien entre ces deux écritures, sans déconstruction aucune, en introduisant, dans la première équation, au lieu de la vitesse, la quantité de mouvement, comme le suggère banalement la mécanique hamiltonienne !
José-Philippe Pérez est professeur émérite de physique à l’Institut de recherche en astrophysique et en planétologie (Toulouse). Il est l’auteur de Relativité. Fondements et applications (Dunod, 464 p., 39 €, 3e édition, à paraître le 4 mai).