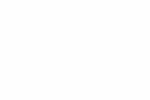« J’ai deux amours », par Albrecht Sonntag

« J’ai deux amours », par Albrecht Sonntag
Par Albrecht Sonntag (Enseignant-chercheur ESSCA Ecole de management)
Notre chroniqueur s’intéresse aujourd’hui aux diasporas du football et au sentiment de « double appartenance ».
Quelques jours en plein Euro dans une région industrielle du sud-ouest de l’Allemagne où les habitants issus de la migration représentent aujourd’hui facilement un quart de la population. Et cela se voit : mélangés aux drapeaux noir, rouge et or accrochés aux voitures, on identifie les couleurs croates, turques, polonaises, et même le drapeau tricolore français par endroits ; les garçons de restaurant qui servent en maillot de leur équipe nationale discutent dans le dialecte local sur les chances de leurs sélections respectives ; les soirées de télé entre voisins sont accompagnées autant par une diversité gastronomique alléchante que par des commentaires d’une mauvaise foi nationaliste d’occasion parfaitement assumée.
Combien sont-ils, les Européens qui vivent dans un pays qui n’est pas celui des origines de leur famille ? Il n’y a pas que des immigrés durablement installés depuis une ou plusieurs générations, il y a aussi les migrants temporaires, dont les objectifs et occupations varient considérablement : main-d’œuvre détachée pendant des mois sur un chantier ou dans l’agriculture ; ingénieurs ou techniciens, cadres ou universitaires expatriés pour quelques années ; amoureux installés dans le pays de leur conjoint et qui y font leur trou ; étudiants et retraités avec une envie d’ailleurs – les catégories sont nombreuses, diverses et variées.
Pont culturel
Dans les diasporas comme ailleurs, le football fait fi des clivages socio-économiques ou générationnels, et il a un grand nombre d’adeptes à travers l’ensemble des catégories de migrants. Plus que cela : la recherche conduite entre 2012 et 2015 par le projet FREE (pour Football Research in an Enlarged Europe) suggère même que, pour « ceux qui sont loin de chez eux », le football a tendance à devenir un pont culturel entre les deux « patries ».
Il est chargé (souvent inconsciemment) de significations multiples, et facilite autant l’intégration dans le pays de destination que la gestion de la nostalgie du pays d’origine. Et pour beaucoup d’individus qui, après un séjour long d’une ou plusieurs années, sont rentrés dans le pays du départ mais ont gardé un rapport affectif avec leur destination temporaire, il reste un trait d’union émotionnel important. Le nombre d’Européens qui ont « deux amours » semble dépasser d’assez loin les chiffres globaux publiés dans les statistiques sur l’immigration.
Evidemment, les immigrés de deuxième ou troisième génération représentent un cas de figure particulièrement intéressant. C’est une catégorie à laquelle les politiques de tous bords s’intéressent beaucoup et sur laquelle beaucoup de clichés et de supputations circulent. Pour eux, qui n’ont pas grandi dans un endroit dans lequel ils sont pourtant censés avoir des racines, le football est souvent vital.
« Loyautés hybrides »
Les enquêtes quantitatives ne peuvent rendre justice au vécu d’un tel groupe social. Il faut au contraire plonger dans son quotidien, y participer dans la durée, avec empathie mais aussi avec l’œil critique du chercheur et avec les outils conceptuels des sciences humaines et sociales. C’est ce qu’a fait une jeune anthropologue, Nina Szogs, de l’université de Vienne, au sein de la communauté turque.
Elle en a tiré la conclusion que le football a des fonctions sociales très diverses pour ces groupes. Tout d’abord, et c’est un effet non négligeable, il crée une proximité avec les membres de leur propre famille, avec ceux qui ont effectivement grandi et vécu dans le pays d’origine. Dans des configurations familiales où la communication entre les générations est souvent assez difficile, le football est un sujet autour duquel on peut se retrouver.
Ensuite, le football aide à vivre et à assumer ce que Nina Szogs appelle « des loyautés hybrides », une double appartenance pas toujours bien vue par la société d’accueil qui a tendance à exiger des immigrés qu’ils fassent un choix. Le supporterisme leur permet d’afficher leur double appartenance de manière très naturelle, dans leur discours, mais aussi dans les noms des leurs fan-clubs ou bars, qui comprennent souvent l’adjectif « viennois ». Une « appellation d’origine » qu’ils revendiquent tout aussi clairement lors de leurs déplacements en avion à bas coût pour voir un match en Turquie.
Identité
La diaspora turque à Vienne est parfaitement consciente des discriminations et des inégalités dont leur vie quotidienne est parsemée, mais le football les aide à traverser les frontières mentales. Comme le résume la jeune chercheuse : « Il comble les clivages culturels, en offrant régulièrement la possibilité d’acquérir de la capacité d’action pour contrer le mépris et gagner le respect. » Avant tout, il peut « contribuer à la sensibilisation de la société à l’existence des appartenances hybrides et à leur acceptation comme une normalité ».
C’est précieux. Justement à un moment où les simplificateurs de tous bords cherchent à persuader les gens que le cadre de l’Etat-nation est le seul et unique fournisseur agréé de sentiments d’appartenance, et que les individus possèdent une identité figée qu’il convient de défendre, le football est un support sur lequel on peut allègrement afficher des loyautés hybrides, voire multiples.
Il y a quelques jours, les Turcs et les Autrichiens sont rentrés à la maison dès la fin du premier tour. Les Turcs autrichiens aussi. Comme les Autrichiens turcs, d’ailleurs.