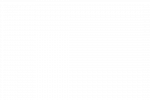Guerre des chefs en Tunisie

Guerre des chefs en Tunisie
Par Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
En conflit ouvert avec le président Béji Caïd Essebsi, le premier ministre Habib Essid va remettre son mandat en jeu devant le Parlement.
Combien de temps va durer la confusion au sommet de l’Etat ? La Tunisie vit depuis quelques semaines un mini-psychodrame dont l’onde de choc pourrait bien gripper une transition démocratique célébrée à travers le monde comme « exemplaire ». La crise entre les deux branches de l’exécutif – le président Béji Caïd Essebsi et le chef du gouvernement Habib Essid – est désormais ouverte, acrimonieuse. Entre les deux hommes, hier alliés, c’est le schisme.
Le conflit va en toute logique se solder par le départ du premier ministre. M. Essid, 67 ans, technocrate aux manières discrètes, a annoncé lundi 18 juillet qu’il ne démissionnerait pas de lui-même – « je ne suis pas le soldat qui fuit le champ de bataille », a-t-il déclaré – mais qu’il remettrait son mandat en jeu devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). L’arithmétique parlementaire ne lui est plus favorable depuis que le chef de l’Etat a croisé le fer contre lui. Le vote est annoncé pour le 30 juillet. Cette insistance à se conformer aux règles de la Constitution, au lieu de s’incliner sans mot dire devant les pressions du clan présidentiel, illustre l’aigreur de sa relation avec le chef de l’Etat.
Le sort d’Habib Essid, grand commis de l’Etat réputé intègre, est scellé depuis que le président Essebsi a lancé le 2 juin l’idée de former un gouvernement d’« union nationale ». Cette initiative de rebattre les cartes sonne clairement comme un désaveu du bilan du premier ministre, nommé dix-huit mois plus tôt par le chef de l’Etat lui-même dans la foulée de la victoire aux élections législatives, fin 2014, de Nidaa Tounès, le parti « moderniste » anti-islamiste qu’il a fondé.
M. Essebsi semble faire siennes les critiques adressées à l’action gouvernementale, jugée trop peu dynamique, alors que la Tunisie est confrontée à des défis socio-économiques – croissance atone, chômage en hausse – d’une extrême sensibilité.
« M. Essid était isolé et son gouvernement manquait de cohésion », souligne Bochra Belhaj Hmida, députée indépendante. « Il ne consultait pas assez les partis politiques, notamment Nidaa Tounès », ajoute Raouf Khamassi, membre du bureau politique de Nidaa Tounès. De fait, le chef du gouvernement n’a jamais été franchement soutenu par le parti vainqueur en 2014, amer de n’avoir pas obtenu un premier ministre issu de ses rangs. Seul point porté au crédit de M. Essid : le rétablissement relatif de la sécurité après une année 2015 ensanglantée par une série sans précédent d’attentats djihadistes.
La bataille pour la succession s’annonce âpre
La défaite annoncée du premier ministre ne dénoue pas la crise pour autant. La bataille pour sa succession s’annonce âpre. En ayant associé neuf partis et trois confédérations syndicales et patronales afin de créer le consensus le plus large – scellé autour d’un document programmatique signé le 13 juillet à Carthage –, le président de la République complique l’équation.
« On va entrer dans une phase où les partis vont concentrer leur énergie sur le partage du gâteau après le départ de M. Essid », redoute Mme Hmida. Et, une fois le nouveau premier ministre nommé, la mise en œuvre du « pacte de Carthage » promet d’être laborieuse, tant ce catalogue d’objectifs vagues laisse intactes nombre de contradictions.
Surtout, les circonstances du lâchage de M. Essid vont laisser des traces. La première est l’appropriation par le président Essebsi de pouvoirs que lui contestent nombre de juristes. « Il a imposé une lecture présidentialiste d’une Constitution [adoptée en 2014] à dominante parlementaire », souligne Hatem M’rad, professeur de sciences politiques. Agé de 89 ans, formé à l’école bourguibienne, Béji Caïd Essebsi « n’a pas compris l’esprit de la révolution de 2011 », se désole un familier des coulisses du pouvoir.
De l’avis de nombreux observateurs, l’attitude de M. Essid, qui s’est autonomisé ces derniers mois de la tutelle présidentielle, serait le véritable responsable de la situation. En verrouillant sa maîtrise d’une administration aussi stratégique que le ministère de l’intérieur, M. Essid aurait indisposé le chef de l’Etat ainsi que son fils Hafedh Caïd Essebsi. Ce dernier, qui a conquis en début d’année le parti Nidaa Tounès à l’issue de querelles fratricides, n’a jamais caché son hostilité à M. Essid. « Le premier ministre a refusé des nominations qu’on voulait lui imposer », confie une source proche du gouvernement.
Emiettement de Nidaa Tounès
L’offensive anti-Essid, émanant d’un clan présidentiel où domine l’influence de la famille Essebsi, a pris de court les dirigeants politiques à Tunis. Elle a notamment suscité l’incompréhension d’Ennahda, parti islamiste associé à la coalition gouvernementale, qui n’a jamais eu à se plaindre du chef du gouvernement. « Nous estimions qu’il avait commencé à améliorer ses performances, explique un cadre d’Ennahda. Mais nous ne sommes pas prêts à provoquer une crise avec Nidaa Tounès à ce sujet. Nous considérons que le pays a besoin de la stabilité du couple Nidaa Tounès-Ennahda. »
M. Essid s’est émancipé à un moment d’autant plus sensible pour le chef de l’Etat que le parti qu’il a fondé, Nidaa Tounès, se désagrégeait à la suite de sa prise de contrôle par son fils Hafedh. L’émiettement du parti a eu pour effet mécanique d’imposer Ennahda comme le premier parti représenté à l’Assemblée (69 élus sur 217). Si Ennahda a dépensé beaucoup d’énergie à normaliser son image, son regain d’influence suscite l’inquiétude au sein de l’électorat moderniste qui a porté Béji Caïd Essebsi à la présidence.
Dans ce contexte, le président aurait cherché, à travers cette initiative d’« union nationale », à reprendre en main un jeu politique qui lui échappait. « Il s’agit d’une ruse visant à surmonter la division de Nidaa Tounès et faire oublier la majorité numérique d’Ennahda à l’Assemblée », décode Hatem M’rad.
Mais la manœuvre est risquée. « La bataille pour la succession va ouvrir la boîte de Pandore des revendications partisanes, poursuit M. M’rad. Cela risque de bloquer davantage la situation. » Et avec un impact collatéral non prévu : l’effacé technocrate Essid prend subitement du poids politique, symbole d’une certaine morale républicaine résistant aux cabales. Insolite effet boomerang.