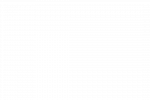Cinq ans après le séisme, Haïti est toujours sous perfusion internationale

Cinq ans après le séisme, Haïti est toujours sous perfusion internationale
Cinq ans après le tremblement de terre qui a frappé Haïti, force est de constater que la reconstruction est un échec. La responsabilité en incombe tout d’abord à la communauté internationale.
Par Frédéric Thomas, politologue, chargé d’études au Centre tricontinental. Auteur notamment de « L’échec humanitaire. Le cas haïtien » (Bruxelles, 2012)
Le 12 janvier 2010, un séisme ravageait Haïti. L’élan médiatique et émotionnel, la mobilisation mondiale convergèrent dans la conférence internationale du 31 mars à New York annonçant 10 milliards de dollars pour « reconstruire en mieux ». Occasion manquée, la faillite de la reconstruction est d’abord le fruit d’un triple échec : humanitaire, international et politique.
L’échec humanitaire
« Reconstruire en mieux » ? Peu a été reconstruit, souvent de manière précaire, les Haïtiens ne vivent pas mieux qu’auparavant et le pays demeure vulnérable aux aléas climatiques. Sans compter l’épidémie de choléra introduite par les casques bleus en octobre 2010. De plus, les 10 milliards de dollars mêlaient en fait des promesses, des réductions ou annulations de dette, de l’argent déjà budgété et des engagements effectifs, qui, de toutes les façons, ont principalement servi à financer les interventions des donateurs eux-mêmes. Enfin, les « dysfonctionnements » habituels de l’aide internationale sont réapparus : manque de coordination, usage de l’anglais, substitution des acteurs haïtiens.
Si des séismes de plus grande ampleur ont fait nettement moins de dégâts ailleurs, c’est que ce sont les conditions sociales préexistantes qui transforment un tremblement de terre en fait divers ou en catastrophe. Or, le 12 janvier 2010 avait été précédé par une catastrophe sociale : manque d’infrastructures et de mécanismes de prévention des risques, pauvreté, etc. La catastrophe naturelle faisait écran, confondant les effets et les causes, l’action compassionnelle et l’urgence du changement pour sortir Haïti du cycle de catastrophes et de dépendance. En réalité, l’humanitaire agit davantage en fonction de sa propre logique que du contexte où il intervient.
L’échec de la « communauté » internationale
Le récit est convenu : l’État haïtien, faible et corrompu, serait venu à bout du zèle et de la bonne volonté occidentale. Mais le président Michel Martelly, au pouvoir depuis avril 2011, jouit toujours du soutien international, même si le pays s’enfonce dans la crise, suite au report répété des élections. Ainsi, le 12 janvier 2015 marque à la fois le cinquième anniversaire du séisme et le terme du mandat des députés et d’un tiers des sénateurs (un tiers a déjà achevé son mandat, sans être renouvelé), faisant planer la menace d’un tournant (plus) autoritaire du régime.
La nature de l’État haïtien est le fruit de l’histoire, de rapports sociaux et de politiques néolibérales. Économiquement – son budget dépend à plus de 60 % de financements extérieurs – et politiquement – via notamment la présence, depuis 2004, de quelques 8 000 soldats et policiers des Nations unies –, l’État est assujetti à la communauté internationale, en général, et aux États-Unis, en particulier. Cela ne l’empêche pas d’exercer un réel pouvoir de domination sur son peuple.
Les Haïtiens ont certes un problème avec leur État. Mais les ONG et instances internationales ne sont pas la solution à ce problème. Au contraire même, elles y participent. D’où un double discours : en appeler au renforcement de l’État haïtien et à la lutte contre la corruption, tout en contribuant à l’affaiblissement des institutions publiques et à la consolidation d’une élite au pouvoir, qui alimente et se nourrit des inégalités, de la corruption et de la servitude de l’État.
La condamnation morale et les solutions avancées par la communauté internationale viennent buter sur cette realpolitik. Le drame de Haïti est que les deux principaux acteurs institutionnels – l’État haïtien et l’ONU –, censés assurer et orienter la reconstruction, sont discrédités : le premier pour son autoritarisme et sa corruption, le second pour son refus de reconnaître sa responsabilité dans l’introduction du choléra, les deux pour leur ultralibéralisme et leur mépris du peuple.
L’échec politique
La reconstruction est devenue dans le même temps une machine à dépolitiser et le cache-sexe d’une politique déterminée. D’un côté, la catastrophe et la Reconstruction ont été vidées de toute interrogation gênante. La politique divise, l’humanitaire rassemble. Mais il rassemble les Haïtiens sous le statut de population victime et passive, qui doit être soignée et administrée par la communauté internationale. D’un autre côté, le choc et l’urgence ont servi de catalyseur à des politiques ultralibérales dont la zone franche de Caracol constitue le modèle, et le « Haïti is open for business » le slogan.
La prétendue neutralité politique de la reconstruction revenait à la mettre au service de l’institution la moins neutre et la plus politique de toutes : le marché. Les Haïtiens eurent droit à tout : à l’humanitaire et au marché. Et même au marché humanitaire. Mais pas à décider par eux-mêmes, à faire valoir leurs expertises et leurs droits, fût-ce à l’encontre de l’humanitaire et du marché.
Haïti ne constitue pas un cas exotique. L’usage des crises et des chocs pour avancer des mesures impopulaires, sous le double masque du marché et de l’efficacité, et la réduction de la liberté à la tenue d’élections devant entériner le « bon » gouvernement, pour mettre en place les politiques « adéquates » (déjà définies par les institutions internationales), rappellent le traitement de la crise grecque. Au final, la reconstruction de Haïti a fait converger l’humanitaire, l’État et la communauté internationale dans une même politique de dépossession des Haïtiens, échangeant le hasard d’une catastrophe naturelle contre la fatalité d’une catastrophe sociale.