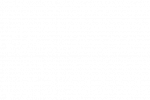Yasmina Reza : « Une des constantes de mes personnages est l’angoisse du temps morne »

Yasmina Reza : « Une des constantes de mes personnages est l’angoisse du temps morne »
LE MONDE DES LIVRES
Avec « Babylone », la romancière choisit le récit policier pour mener une enquête drôle et profonde sur nos existences ordinaires.
C’est le roman qui domine la rentrée littéraire française. Avec Babylone (Flammarion, 220 p., 20 € – en librairie le 31 août), Yasmina Reza choisit le récit policier pour mener une enquête à la fois drôle et profonde sur nos existences ordinaires.
Au cœur de son livre, et c’est la première fois, il y a donc un meurtre commis dans un appartement de banlieue, après une fête printanière. Mais au-delà du crime passionnel, ce que l’enquête révèle, c’est le vrai mobile de Reza, celui qui court à travers toute son œuvre théâtrale et littéraire, dont le rayonnement est international : défendre l’existence humaine livrée aux attaques de l’insignifiance, aux blessures de la solitude, à l’usure du temps.
Sous sa plume, l’arme de ce combat demeure toujours la même. C’est le rire, un rire de barrage, au sens où l’on parle de « tir de barrage », un rire explosif qui chasse la tristesse et réinvente la joie. Entretien.
Lors d’un récent entretien au « Monde », Christine Angot évoquait ce qu’elle nommait le « savoir féminin ». Dans mes livres, disait-elle, « je m’efforce de faire en sorte que ce savoir-là remplisse la page ». Vous-même, avec « Babylone », vous avez fait le choix d’une narratrice, alors que par le passé vous faisiez le plus souvent parler des hommes…
Longtemps, quand on me demandait pourquoi je faisais parler des hommes, je répondais : « Parce que le masculin est générique, il représente l’humanité en soi, le mythe est au masculin », etc. De temps en temps, je répondais : « Parce que c’est plus facile. » C’était vrai. Je n’osais pas écrire à découvert. Je l’ai fait, mais pas de façon aussi centrale que pour Bella Figura (2015) ou Babylone.
Ecrire autour d’un personnage féminin, c’était me mettre à poil. Le personnage masculin est protecteur et vous donne toute liberté. Y compris de langage. En fait, tout ça traduisait une timidité, à la fois personnelle et littéraire. En ce sens, j’ai progressé.
A propos de ce « savoir féminin », Angot parlait encore de la « gaieté intense qu’on a à être une fille ». Une telle définition vous touche-t-elle ?
Oui, elle a raison, j’ai toujours pensé cela. J’approuve le mot « gaieté ». Je ne saurais pas exactement définir pourquoi. Je crois que cela a à voir avec la capacité de frivolité, mais c’est un mot qui prête à confusion. Pour moi, la frivolité est une grâce, une conscience aiguë et assumée de la fragilité de la vie.
Dans Une désolation (Albin Michel, 1999), le personnage de Geneviève, qui n’était pas du tout jeune, disait : « Je suis capable de traverser Paris pour un crayon à lèvres, je ne veux pas de la gravité des derniers instants, je veux de la pure fantaisie, car au bout du chemin il y a le cimetière de Bagneux. »
Bien sûr, dès qu’on dit « les femmes sont comme ci et les hommes comme ça », on dit toujours une énorme bêtise. Mais je crois que les femmes ont souvent un spectre d’intérêts très variés. Il n’y a pas d’échelle de valeur, on prend tout ce qui passe. Le grave, le léger, avec le même sérieux. Cela n’a rien à voir avec le désir de plaire, c’est comme ça, cela fait partie de l’humour, du jeu d’être fille.
Dans les dernières lignes de votre roman, Elisabeth, la narratrice, évoque un « sentiment d’appartenance à un ensemble obscur ». Vous-même, éprouvez-vous un tel sentiment, en tant que femme ou écrivain, par exemple ?
Cet ensemble obscur, à mes yeux, c’est l’humanité tout entière, l’ensemble des êtres humains qui nous ont précédés et ceux qui nous remplaceront. Dans les images de Frank ou de Winogrand dont je parle dans Babylone, je vois non pas, comme disait Borges, « le mince hier des photographies », mais l’immense hier de nos vies
Je ne vois pas ce que pourrait signifier l’appartenance à sous-ensemble. Un héritage culturel ? Oui, sans doute. Ce n’est pas si important. Si je devais m’inscrire dans un sous-groupe, ce ne serait ni comme femme ou comme écrivain, mais comme juive. Car je sais que cet héritage a induit mon écriture. Un goût pour le mélange des genres, une forme de parler elliptique… Mais, encore une fois, l’ensemble obscur de ceux qui ont fait une infime incursion sur terre et se sont dissous on ne sait où, le monde interminable des morts, me parait très au-dessus des particularités.
Dans « Babylone », les femmes sont celles qui font « tenir » les choses, qui veulent que ça tienne, la neige, au début, le récit, à la fin.
J’aime bien ce mot, tenir. Il a plusieurs sens en français. La solidité, la cohérence, mais aussi l’endurance, le courage. Comme on n’a aucune certitude de sens, on n’est pas mécontent de faire tenir quelque chose. Au fond, la plupart de nos actes consistent à rétablir un peu d’équilibre.
Justement, à l’origine de chaque livre, chez vous, il y a l’impulsion donnée par une contrainte formelle.
J’ai commencé par écrire du théâtre. Dans ce domaine, la contrainte formelle est première. Vous créez un dispositif et vous faites rentrer votre monde dedans. Quand je me retourne sur ce que j’ai écrit, je constate que mes obsessions, mentales ou physiologiques, n’ont en réalité jamais varié. Mais le résultat n’est jamais complet, jamais entièrement satisfaisant, il manque toujours une dimension. Il faut recommencer, refaire autrement. Inventer un nouveau dispositif, d’autres personnages, un autre angle. Il faut que ça prenne une autre allure.
Cela fait trente ans que j’exprime les mêmes choses. Le primat des nerfs sur l’intelligence, la solitude… Trouver une variante pour présenter les mêmes motifs devient une sorte de quête en soi. Avec Babylone, c’est la première fois que j’écris une histoire avec des événements, un avant et un après. Auparavant mes textes relevaient davantage de la critique de l’existence que du récit.
Pourquoi avoir choisi le roman policier, ou plutôt un récit structuré par un crime, cette fois ?
Précisément parce que dans ce type de récit, ce qui semblait « tenir », subitement ne tient plus. D’une manière générale, les gens que je mets en scène ont toujours voulu « agiter la vie », souvent sans y parvenir.
Une des constantes de mes personnages est l’angoisse du temps morne, quand les minutes s’égrènent et qu’il ne se passe rien. J’ai beaucoup tourné autour de ce thème. Peut-être qu’il était temps pour moi de créer un événement.
La narratrice veut, absurdement, organiser une fête de printemps. Ce qui suit est la conséquence fatale de ce petit pas de déraison. Je ne voudrais pas être malhonnête et donner après coup une raison dialectique à ce choix. Mais le récit policier oblige à des décisions de tous ordres, y compris d’ordre moral. C’est une armature idéale. Elle permet de confronter les personnages au mouvement. Je crois qu’il y a une joie inhérente au mouvement.