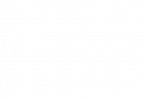Au Congo, avec les adolescentes des maisons closes de Biakato-Mine

Au Congo, avec les adolescentes des maisons closes de Biakato-Mine
Par Habibou Bangré (Biakato, RDC, envoyée spéciale)
Dans le nord-est de la RDC, la ruée vers l’or alimente le développement de la prostitution des mineures.
Monique a perdu ses parents encore jeune. « Pour rester chez la famille, c’était difficile. On vous faisait sentir que vous étiez une charge », raconte-t-elle avec sa voix rocailleuse. Encouragée à « se débrouiller » pour survivre, elle a commencé à se prostituer à un âge dont elle dit ne plus se souvenir. Aujourd’hui, à 33 ans, elle continue de vendre son corps et a ouvert à Biakato-Mine ce qu’on appelle une « maison de tolérance », ou un « QG », autrement dit une maison close, alors que la prostitution est officiellement interdite par la loi.
Il y aurait une quinzaine d’établissements de ce genre dans cette ville minière de 17 000 habitants et bien d’autres encore éparpillées dans les localités de la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC). Ils proposent du sexe, de l’alcool et parfois du chanvre à fumer. Les clients seraient pour beaucoup des chercheurs d’or qui affluent dans la région. « A 18 heures, les mineurs rentrent avec leur butin du jour, le vendent, et après, le seul moyen de le dépenser, c’est sexe et alcool », résume Tanguy Amani, responsable de la promotion de la santé chez Médecins sans frontières (MSF).
Solutions radicales
Dans l’entrée de la maison de Monique, des effluves d’alcool s’échappent d’une dizaine de bidons jaunes alignés avec soin. Ils contiennent du lotoko, un breuvage local à base de manioc ou de maïs. Le verre coûte 500 francs congolais (0,45 euro) et les clients sont servis par la dizaine de prostituées que Monique « encadre ». Certaines semblent mineures. D’emblée, la patronne dément, explique que les filles connaissent mal leur âge. Reste que plusieurs affirment avoir 17, 16 ou même 15 ans.
Des habitués confirment. Comme Augustin, 30 ans : « Je viens boire seulement, je jure au nom de Jésus ! Je trouve vraiment dommage qu’il y ait des filles de moins de 18 ans ici, qu’elles débutent leur vie comme ça. » Passablement éméché en ce milieu d’après-midi, Jacques, 41 ans, souligne qu’il est marié et n’oserait jamais toucher une mineure. Contre nature, selon lui. « Ces enfants ? Pour moi, non ! J’ai mes enfants qui ont cet âge. Alors pourquoi j’irais “cohabiter” avec mon enfant ? »
Dans le salon, la pénombre dévoile un fauteuil bleu confortable et une télévision massive, tout droit sortie d’un autre temps. Dans une autre partie de la maison aux murs de terre, on découvre deux chambres modestes donnant sur un autre salon. L’air est saturé d’odeurs de tabac froid et d’alcool. Sur fond de musique congolaise braillée par des enceintes, une dizaine de jeunes filles et de garçons discutent, rigolent, fument, boivent, se taquinent. Parfois, le rapprochement est plus intime.
Marie*, 17 ans, est arrivée il y a deux mois de la province du Nord-Kivu (est), tout comme d’autres filles, que l’on trouve dans les QG de Biakato-Mine. Le regard brumeux, la voix paresseuse, elle explique qu’elle n’a pas fui les massacres qui ont fait plus de 600 morts depuis octobre 2014 dans le territoire de Beni. « Une camarade m’a dit qu’on pouvait venir ici et faire de la prostitution, et je suis venue. A Beni, mes parents n’auraient jamais accepté que je fasse ça, ils m’auraient grondée ou frappée. »
« Coup pressé » sans capote
La passe classique – baptisée « coup pressé » – est à 5 000 francs congolais (4,50 euros). La nuit entière peut rapporter entre 10 000 et 12 000 francs. Souvent, la moitié du salaire est reversée aux propriétaires de QG pour couvrir la location de la chambre et les repas. C’est le cas pour Marie, ou encore pour Stéphanie*, 15 ans, qui a perdu sa virginité dans une maison close après avoir fui les tueries de Beni. « Je n’économise rien. Avec ce que je gagne, j’achète juste ce dont j’ai besoin, comme les vêtements. »
Le préservatif n’est pas sur la liste de leurs priorités. « Je n’aime pas ça. Si tu t’habitues trop, ça donne des maladies », croit savoir Marie. Parce qu’elle n’est pas la seule à avoir des préjugés, MSF travaille avec des relais communautaires pour sensibiliser, rassurer. Mais l’usage systématique du préservatif restera difficile faute de stocks suffisants dans cette région reculée, et du coût, prohibitif pour beaucoup. Certains clients sont aussi prêts à payer davantage pour avoir un « coup pressé » sans capote.
Figure de la société civile locale, le pasteur Marc Saïno appelle les autorités à se montrer fermes. « Nous, nous n’avons pas le pouvoir d’arrêter quelqu’un qui a un QG. Alors il faut continuer à alerter le gouvernement jusqu’à ce qu’il prenne des mesures », prêche-t-il, debout devant sa maison. Mais, pour Patrice Fayala, relais communautaire, le problème vient plutôt d’un manque de rigueur qui protège le système. « Quand la police vient, elle arrête les propriétaires et les filles, mais après deux jours, elle les libère. »
Certains plaident pour des solutions radicales. Comme arrêter les propriétaires des maisons de tolérance et les prostituées, et fermer dans la foulée les établissements. « Mais si on ferme, est-ce qu’il y a des mesures [de reconversion] ? C’est ça notre inquiétude », confie le pasteur Saïno. Inquiétude justifiée. Plusieurs filles expliquent qu’elles voudraient reprendre l’école ou exercer un autre métier, mais qu’elles n’ont trouvé aucune alternative leur permettant de quitter le commerce du sexe.
*Le prénom a été changé.