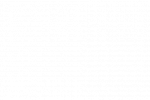Informer en Ethiopie, troisième pire pays d’Afrique pour les journalistes

Informer en Ethiopie, troisième pire pays d’Afrique pour les journalistes
Par Emeline Wuilbercq (contributrice Le Monde Afrique, Addis-Abeba)
Selon Addis-Abeba, plus de 11 600 journalistes et blogueurs ont été arrêtés. La répression s’est intensifiée depuis l’instauration de l’état d’urgence en octobre.
« Etre militant en Ethiopie, c’est comme dormir sur une branche d’arbre : tu ne peux pas fermer l’œil parce que tu sais que tu peux tomber à tout moment. » C’est ce que Befeqadu Hailu confiait au Monde Afrique deux jours avant son arrestation, le 11 novembre.
Sur Twitter, le blogueur éthiopien se décrivait comme écrivain, « enthousiaste de la démocratie » et survivant de la prison de Maekelawi, à Addis-Abeba. Depuis l’instauration de l’état d’urgence en Ethiopie, le 9 octobre, après une année de troubles politiques et de manifestations anti-gouvernementales, il dénonçait sur son profil la multiplication des arrestations, plus de 11 600 selon les autorités. Son compte est désormais désactivé.
L’Ethiopie est l’un des pires pays pour la liberté de la presse : elle est le troisième pays d’Afrique à incarcérer le plus de journalistes après l’Egypte et l’Erythrée. Elle talonne la Chine, la Syrie et l’Iran dans le classement des pires censeurs d’Internet au monde, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), qui a dénoncé jeudi 17 novembre l’intensification de la répression des médias depuis la mise en vigueur de l’état d’urgence. Plusieurs journalistes et blogueurs ont été arrêtés ces dernières semaines.
« Incitation à la violence à travers l’écriture »
Befeqadu Hailu était peut-être trop confiant : le trentenaire contournait le blocage d’accès aux réseaux sociaux, il donnait des interviews depuis Addis-Abeba en anglais et en amharique. Surtout, il poursuivait son activité de blogueur. Celle-là même qui l’avait déjà envoyé en prison pour dix-huit mois en avril 2014 en compagnie d’autres membres fondateurs de Zone9, un collectif de blogueurs éthiopiens qui critiquait les méthodes du gouvernement, les injustices et le manque de démocratie en Ethiopie.
Ils avaient été inculpés de « terrorisme » en vertu de la Proclamation antiterroriste de 2009, un outil juridique controversé qui sert à dissuader et à réprimer toute dissidence politique selon les organisations de défense des droits humains. Depuis octobre 2015, Befeqadu Hailu, libéré sous caution, attendait son jugement en appel pour « incitation à la violence à travers l’écriture ».
« Les individus qui se prétendent journalistes ne le sont pas tous, justifie le ministre éthiopien de l’information Negeri Lencho. Certains servent d’autres intérêts et expriment un discours de haine à l’encontre du gouvernement et du peuple. » D’après lui, une personne qui enfreint la loi relative à l’incitation à la violence mise en application par le « poste de commande » instauré par l’état d’urgence doit rendre des comptes : « Le gouvernement ne devrait pas être sans cesse accusé de violer la liberté de la presse quand il tente de faire respecter la loi. »
En Ethiopie, la plupart des journaux, stations de radio et chaînes de télévision sont contrôlés par l’Etat. « Notre pays est gigantesque mais je peux compter les médias privés sur les doigts de ma main » , déplore Tesfu Altaseb, auteur d’un livre en amharique sur les médias en Ethiopie. D’après lui, la liberté de la presse a décliné depuis les élections de 2005 dont les résultats contestés avaient entraîné des violences. « La plupart des journalistes éthiopiens ont choisi l’exil » , poursuit-il. Et ceux qui sont restés ? « Ils ont peur… »
« Nouvelles saugrenues »
C’est le cas de Bethelehem* qui a récemment quitté « à contrecœur » son poste d’animatrice à la radio gouvernementale. Elle avait reçu l’ordre de lire des « nouvelles saugrenues », notamment sur le bilan des manifestations qui auraient fait plusieurs centaines de morts d’après les organisations de défense des droits humains. « J’étais frustrée de mentir à mon peuple et de me mentir à moi-même, lâche-t-elle. Ici, soit tu travailles pour l’Etat et tu n’es pas journaliste, tu es un simple rapporteur. Soit tu veux être libre mais c’est à tes risques et périls. » Depuis sa démission, elle change régulièrement de numéro de téléphone. « Une certaine paranoïa grandit en toi à force d’entendre les histoires de tes confrères », poursuit-elle en évoquant les manœuvres d’intimidation et de surveillance.
Tewolde* est un habitué des pressions qui pèsent sur les journalistes depuis des années, de « l’autocensure » et de la frustration de ne pas pouvoir dire toute la vérité sur les sujets politiquement sensibles. Depuis l’instauration de l’état d’urgence, « c’est pire », explique ce directeur de la rédaction d’un média privé. « Tu ne sais pas ce que tu peux dire ou non, tu pèses tes mots pour que le gouvernement ne considère pas tes écrits comme une trahison. Cela ne veut pas dire que je cache les faits aux lecteurs », explique-t-il. Mais il doit éviter de tenir un discours trop accusateur. « Tu dois faire très attention si tu ne veux pas que ton journal ferme et que tes journalistes se retrouvent dans une situation délicate », ajoute-t-il, rappelant l’exemple de l’Addis Standard : ce mensuel indépendant a dû suspendre sa parution papier en octobre faute d’imprimeur et de distributeur.
Pour l’auteur Tesfu Altaseb, la détérioration de la liberté de la presse représente un risque. « Si les citoyens ne peuvent pas lancer leurs idées, ils lanceront des pierres », prédit-il.
« Il est de notoriété publique que c’est à travers des médias libres et responsables que l’Ethiopie peut construire sa démocratie, conclut le ministre Negeri Lencho. Mais la démocratisation prend du temps. Vous ne pouvez pas comparer notre pays avec d’autres démocraties bien bâties. »
* Le prénom a été modifié.