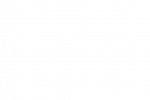« Ces troncs n’ont pas été arrachés par la boue, ils ont été sciés par l’homme »

« Ces troncs n’ont pas été arrachés par la boue, ils ont été sciés par l’homme »
Par Marie Delcas (Mocoa (Colombie), envoyée spéciale)
La coulée de boue qui a dévasté la ville colombienne de Mocoa, le 31 mars, s’est produite sur un sol fragile, mais la déforestation et l’urbanisation ont contribué à l’ampleur de la catastrophe.
Dans les ruines de Mocoa, le 4 avril , trois jours après la coulée de boue et de rochers qui a dévasté la ville. | LUIS ROBAYO / AFP
Les hasards du courant ont laissé debout la demeure de Jesus Antonio Erazo. La charpente a tenu, le toit de tôle aussi. La boue a emporté les fenêtres, les portes, les meubles. Et presque tous les voisins. « La normalité n’est pas revenue dans ma tête », soupire Jesus Antonio. Il est juché sur une des gigantesques pierres charriées par l’avalanche d’eau et de terre qui, le 31 mars, a détruit une partie de la ville de Mocoa, chef-lieu du département du Putumayo, au sud de la Colombie. Certaines roches font plus de deux mètres. « Elles faisaient trembler la terre en dévalant la pente et en explosant tout ce qui était sur leur passage, dans un rugissement de fin du monde », raconte-t-il.
L’immeuble de quatre étages en face de sa maison a été emporté. Des matelas, des télévisions éventrées, des troncs boueux jonchent le paysage de ruines. « Regardez, leurs extrémités, coupée nettes. Ces troncs n’ont pas été arrachés par la boue, ils ont été sciés par l’homme », fait remarquer Jesus Antonio. Si elle n’est pas à elle seule la cause de la tragédie, la déforestation a contribué à son ampleur. Le dernier bilan fait état de 316 morts et d’une centaine de disparus.
Panique
En début d’après-midi, lundi 10 avril, le ciel devient sombre au-dessus de la montagne qui surplombe Mocoa. Un coup de tonnerre éclate au loin. La panique subitement s’empare des quartiers sinistrés. Les gens se mettent à courir en hurlant qu’une nouvelle avalanche arrive et tirent par le bras des enfants terrorisés. Rapidement, une voiture de pompiers sillonne les rues pour appeler au calme par mégaphone. Dix minutes plus tard, deux hélicoptères survolent la zone. A la radio, les autorités confirment qu’il s’agit d’une fausse alerte. Jesus Antonio tremble.
Mardi, le président Juan Manuel Santos a une fois encore fait le voyage pour inaugurer le pont provisoire, construit en urgence sur la route qui conduit à Bogota, à douze heures de voyage de là. Il a fait un bref bilan des dernières actions menées. Les cadavres ont été identifiés. Les survivants dorment sous tente. Plus de la moitié des rues endommagées ont été dégagées. Cent soixante tonnes d’aliments ont été distribuées. Les réserves en eau potable ont été constituées, l’électricité devrait revenir dans la soirée. Depuis douze jours, les 70 000 habitants de la ville sont privés de l’une et de l’autre.
Cinq ministres, la femme du président et une équipe de hauts fonctionnaires sont venus. Les quelques badauds qui, du bord de la route, assistent à la scène, moquent en sourdine « ces politiciens de la capitale qui viennent se faire tirer le portrait ». Les sinistrés sont déjà convaincus que l’aide va être détournée.
Distribution de vivres aux victimes devant les abris installés par les autorités colombiennes, à Mocoa, le 3 avril. | LUIS ROBAYO / AFP
« Il va pleuvoir beaucoup dans les jours qui viennent, à Mocoa et partout dans le pays, sauf sur la côte caraïbe », avertit le président. Près de 400 municipalités ont été placées en état d’alerte. « Les gouverneurs doivent être attentifs », tance M. Santos. A ses côtés, se tient Sorrel Aroca, la jeune gouverneure du département du Putumayo. Pourquoi l’alerte n’a-t-elle pas été donnée, le 31 au soir ? « Tout est allé trop vite », affirme-t-elle.
Efficacité peu courante
Bordée de deux océans, traversées de trois cordillères friables et sismiques, la Colombie n’en est pas à sa première catastrophe naturelle. Depuis Armero, la ville de 30 000 habitants engloutie par une coulée de boue en 1985, le pays a beaucoup progressé en matière d’organisation des secours et de l’aide d’urgence. Mocoa l’a montré. Dans les heures qui ont suivi le désastre, l’Etat s’est déployé avec une efficacité peu courante. Pompiers, défense civile, soldats, policiers, fonctionnaires se sont attelés à la tâche. Le président remercie les militaires qui ont reconstruit le pont. Dans l’assistance, une femme chuchote : « je préfère voir les soldats aider aux secours et à la reconstruction que faire la guerre ».
Jesus est l’une des huit millions de victimes du conflit armé colombien, qui a duré plus d’un demi-siècle. « J’avais investi dans cette maison tout l’argent reçu de l’Etat, en réparation », explique-t-il. Sa femme et trois de ses enfants ont été assassinés en 2010 par des hommes armés qui le rackettaient depuis des mois. Paramilitaires ? Guérilleros ? Jésus Antonio, qui a appris la peur, reste vague. Il a abandonné ses soixante hectares de terre pour venir se réfugier à Mocoa, avec ses trois enfants encore en vie. Dans le cadre de la loi sur les victimes et la restitution des terres, il a reçu en 2015 une indemnisation administrative de 90 millions de pesos (30 000 euros). L’avalanche a tout balayé. « Je suis heureux parce que je suis en vie », dit-il, en regardant ses mains usées par le travail. Le ton n’y est pas. Les déplacés qui sont arrivés à Mocoa fuyant la violence des campagnes ont fourni le gros des victimes de la catastrophe.
La ville, chef-lieu du département du Putumayo, comptait moins de 15 000 habitants dans les années 70. Comme toutes les villes colombiennes, elle a grandi sans planification urbaine. Par ignorance, incompétence ou appât du gain, les mairies ont laissé construire dans des zones considérées à risque. Diego Torres, transporteur, pointe les rives dévastées de la Taruca. « Ce n’est pas la rivière qui est venue nous chercher, c’est nous les hommes, qui sommes allés l’envahir ».
Les quartiers marginaux ne sont pas les seuls à avoir souffert. Des vieux quartiers, ceux d’El Progreso ou de La Independencia (le « quartier du vice », précise Diego) ont été touchés. Celui du Pino et ses pavillons confortables aussi. Prise entre deux bras de la coulée, la prison de Mocoa a échappé au désastre. « Dieu fait les choses bizarrement », remarque Jesus. Diego en est d’accord, qui raconte :
« Les vendeurs de drogue de La Independencia, parce qu’ils étaient réveillés à 11 heures du soir quand la crue a commencé, ont donné l’alerte et aidé à sauver des vies humaines. Incroyable, non ? »
Tous les témoignages concordent : « il a plu comme jamais ». « En trois heures, 140 mm d’eau sont tombés, soit l’équivalent de dix jours de pluies habituelles. | LUIS ROBAYO / AFP
Zones à risque
Ce sont les hommes qui, en 1563, ont établi Mocoa en plein « piedemonte amazónico ». C’est ainsi que les géographes désignent la bande de terre où les Andes et l’Amazonie s’épousent. Il y pleut tout le temps. Et ce soir-là, le 31 mars, « il a plu comme jamais », tous les témoignages concordent. « En trois heures, il a plu 140 mm d’eau, soit l’équivalent de dix jours de pluies habituelles », confirme Luis Alexander Mejia le directeur de Corpoamazonia, l’institution régionale chargée de la protection de l’environnement.
A 600 mètres d’altitude, Mocoa, qui borde la rivière du même nom, est traversée de rus aux noms chantants. Ils se transforment en torrents quand l’averse dure. Et de temps en temps, en marée de terre et de pierres. « Une coulée de boue s’était produite en 1964, une autre en 1972. Avant, nous n’avons pas de registre », rappelle M. Mejia. A l’époque, les rives du Taruca n’étaient pas habitées. Et dans cette ville grandie trop vite, la mémoire collective est courte.
Là-haut, sur la montagne, « les sols sont peu solides, les failles géologiques nombreuses, les pentes très raides », explique M. Mejia. Entre les deux, les arbres ont peu à peu disparu pour céder la place au café, au bétail et à la coca, l’arbuste dont on tire la cocaïne. Dans les années 90, Mocoa avait été rebaptisée « Mococa ».
« Notre connaissance de l’environnement a beaucoup progressé », souligne le directeur de Corpoamazonia. De fait, les autorités environnementales avaient averti du danger que couraient les quartiers aujourd’hui dévastés. Partout dans le pays, elles ont élaboré avec précision les zones à risques. Mais la politique ne suit pas. L’aménagement du territoire non plus. L’environnementaliste Gustavo Wilches-Chaux le dit :
« En Colombie et dans le monde, des progrès ont été faits pour sauver les naufragés, très peu pour éviter les naufrages. »