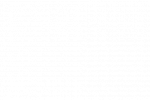Faut-il sortir du « bon » milieu pour réussir en prépa ?

Faut-il sortir du « bon » milieu pour réussir en prépa ?
Pour Julia Benarrous, ex-khâgneuse, le milieu social joue sur le « capital culturel » à l’entrée en classe prépa, mais le rythme de travail y est si soutenu que l’avance peut être de courte durée.
Chronique. Après deux années en classe prépa littéraire dans un prestigieux lycée parisien, Julia Benarrous questionne, dans une série de chroniques, les idées communément répandues sur ce cursus.
Certains lycéens ont déjà entendu parler du sociologue Pierre Bourdieu, qui a théorisé la notion de « capital culturel ». Le grand reproche adressé à la prépa, c’est d’être un système républicain élitiste qui favoriserait les étudiants disposant d’une culture transmise par leur milieu d’origine, au détriment de ceux qui n’ont pas eu cette chance, et qui seraient donc mal partis pour choisir et réussir ce cursus prestigieux. De là, des filles et fils d’ouvriers ou d’employés qui ne représentent que 17 % des élèves en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
Il existe ainsi une ségrégation de classe, qui s’ajoute à une ségrégation raciale – sujet tabou en classe préparatoire. Les personnes issues des minorités visibles y sont en effet sous-représentées, résultat d’un processus qui commence dès le collège, où les élèves sont orientés différemment en fonction de la couleur de leur peau, de la localisation de leur établissement, et de leur environnement socio-économique. Si l’on n’est ni bourgeois ou de classe moyenne, ni blanc, ni parisien, on a des chances bien moindres d’intégrer une grande prépa parisienne, comme je l’expliquais dans ma première chronique :
Fautes d’orthographe ou de grammaire
Alors, faut-il être entièrement pessimiste ? Qui va réussir en prépa ? Cédrick Allmang, lui-même prof de prépa, écrivait dans les colonnes du Monde en 2013 que la prépa était « un endroit où il y a peut-être moins de fils d’ouvriers qu’ailleurs, mais où le fils d’ouvrier ou d’agriculteur réussit comme le fils de ministre ». Je souscris en grande partie à cette affirmation, et voici pourquoi.
En hypokhâgne, on se faisait taper sur les doigts si on s’exprimait mal à l’écrit ou à l’oral. Les professeurs jugent ainsi anormales les fautes d’orthographe ou de grammaire, à un niveau d’exigence intellectuelle et scolaire si élevé. Le problème, c’est que les inégalités sont nées en amont de la prépa. Au collège, les conditions d’enseignement des professeurs sont rarement idéales et la priorité n’est pas aux détails formels. Une certaine ségrégation scolaire enracine des inégalités qui se répètent ensuite tout au long du cursus scolaire et professionnel des élèves.
C’est comme les cours d’anglais : certains arrivent en prépa en ayant lu des livres avec leur professeur, d’autres ont appris une liste de vocabulaire de base toute l’année. L’écart de niveau initial est une réalité, mais le rythme de la prépa est tellement soutenu que l’avance de quelques-uns est de courte durée. Les nouveaux arrivants ont tôt fait de s’adapter et d’apprendre ce que connaissaient les autres depuis un ou deux ans de plus.
Chacun, au début de la prépa, apprend qu’il ne savait pas apprendre au lycée. Qu’il faut non seulement apprendre très en détail une quantité énorme d’informations, mais qu’en plus il faut être capable de se les réapproprier de manière critique, afin de construire une réflexion détaillée et organisée.
Ces inégalités se corrigent donc en grande partie en prépa. Pas par la force, mais par la force de l’habitude, tout simplement, même si la mise à niveau se fait selon un moule qui demeure socialement élitiste et blanc. Avoir une colle (examen oral individuel) par matière et par semestre est un très bon exercice pour apprendre à s’exprimer clairement et sans trop lire ses notes, par exemple. Le travail des professeurs est précisément de combler les lacunes et de résorber au maximum ces différences de niveau par leurs remarques dans les copies et à l’oral.
Parler de ce vieil Hegel à la cantine
C’est justement ce qui peut être blessant : découvrir que le strict minimum qu’on fournissait au lycée ne sera plus suffisant et qu’on est évalué en même temps que des gens qui fournissent bien plus d’efforts. (Lire cette interview de Patrick Clastres, prof de khâgne.)
Il me semble aussi que selon la filière de prépa choisie, le « capital culturel » de départ comptera plus ou moins. En khâgne Ulm, les oraux peuvent tomber sur à peu près tout et n’importe quoi, alors qu’en khâgne Lyon, il n’y a pas la même attente de culture générale : les lectures, périodes, thèmes à étudier sont fixés par le jury du concours. Il faut travailler sur des bibliographies pour élaborer une réflexion qui nous sera propre, ce qui, avec de la détermination, est à la portée de tous.
Nul besoin d’être un génie qui invente des concepts philosophiques, ni d’avoir des parents avec qui l’on s’entretient de Platon pendant le dîner. On peut tout aussi bien parler de ce vieil Hegel, que quelqu’un aura bien réussi à comprendre, pendant le déjeuner à la cantine. C’est moins glamour, mais très efficace et à la portée de tous.
Pour finir, j’espère avoir démonté quelques stéréotypes et montré que différents types d’élèves ont leur place dans les grandes prépas parisiennes. Ce qui n’empêche pas un mythe germanopratin de subsister, dans lequel les élèves et les professeurs aiment à se complaire. J’y reviendrai dans une prochaine chronique.