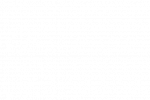Bria, ville disloquée par les groupes armés, symbole la Centrafrique

Bria, ville disloquée par les groupes armés, symbole la Centrafrique
Par Christophe Châtelot (Bria, Centrafrique, envoyé spécial)
Quatorze des seize régions du pays sont contrôlées par des milices, sur lesquelles ni l’Etat ni la mission de l’ONU n’ont de prise.
Des vents mauvais soufflent sur la cour de la mission catholique Saint-Louis de Bria, dans la moitié est de la République centrafricaine (RCA). Ce ne sont pas les prémices orageuses de la saison des pluies qui menacent la grande église de briques rouges solidement plantée au centre de la cour, mais un tourbillon humain.
« La haine est dans le cœur des gens », se lamente l’abbé Gildas. Mi-mai, elle s’est abattue sur Katekondji, un quartier chrétien de cette ville contrôlée par des groupes armés rivaux, musulmans pour la plupart. « Le pire est peut-être à venir », ajoute-t-il.
Assis sur le pas de sa porte, l’abbé désigne un petit pont de bois qui enjambe un marigot au coin de sa mission. « C’est comme une ligne de démarcation », explique-t-il. Là, sur le bord de la rue en latérite, une poignée d’hommes en armes surveille paresseusement les allées et venues des habitants et lorgne les femmes qui lavent le linge en contrebas.
Les derniers soubresauts d’une interminable crise centrafricaine ont malencontreusement placé la mission à la « frontière » de deux quartiers musulmans où de petits chefs de guerre tiennent entre leurs mains le destin de milliers de civils soumis aux revirements violents des alliances rebelles volatiles. « S’ils décident de se battre, cela nous retombera dessus », redoute l’abbé Gildas.
« Effet de contagion »
Dans la cour de la mission, des enfants courent après un ballon crevé, des mamans font bouillir leurs marmites sur des feux de bois. Il y a là près de 300 personnes, peu d’hommes, surtout des vieux et des handicapés. Elles sont venues se réfugier là après les violences du 16 au 18 mai.
Eugène, un sexagénaire, n’a plus que ses champs en bordure de la ville. Sa maison a brûlé avec toutes ses affaires. « Ma radio, mon matelas, mes bagages, même ma serviette… » énumère ce pauvre agriculteur. Eugène vivait dans ce qui n’est plus dorénavant qu’un champ de ruines bordant l’aérodrome de Bria.
Une base marocaine de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), déployée dans le pays depuis la guerre civile de 2014, verrouille pourtant l’unique piste d’atterrissage en terre. « Ils sont là quand tout va bien mais s’enferment dans leur base dès que ça tire. Ils n’ont pas bougé durant les trois jours de mai », s’emporte l’abbé Gildas.
Une critique qui s’étend à l’ensemble du pays alors que, selon les mots du porte-parole du gouvernement, Théodore Jousso, « la situation sécuritaire est à nouveau catastrophique ». « Les groupes armés contrôlent quatorze des seize régions de la Centrafrique. Nous ne pouvons pas lutter contre cet effet de contagion », affirme-t-il, tout en dédouanant le gouvernement de toute responsabilité.
La crise en Centrafrique : décryptage par l’image
Durée : 05:35
Alliances à géométrie variable
Les violences ont repris en septembre 2016, après quelques mois d’accalmie liée à la présence militaire internationale et à la perspective de l’élection présidentielle, remportée début 2016 par Faustin-Archange Touadéra. Depuis, la principale force de dissuasion déployée en RCA, le contingent français « Sangaris », s’est retirée du pays. Et le nouveau pouvoir – quasiment dépourvu de tout appareil de sécurité – brille par sa faiblesse et son indécision.
Les groupes politico-militaires issus de l’ex-mouvement Séléka, essentiellement des musulmans venus de l’est et du nord du pays, soutenus par les voisins tchadien et soudanais, et les groupes d’autodéfense anti-balaka, plutôt chrétiens et animistes, ont repris les armes. Ces groupes se font et se défont, nouent et dénouent des alliances à géométrie variable suivant des lignes communautaires, politiques ou religieuses, avec, en filigrane, le contrôle des ressources du pays (or, diamant, bétail…).
Depuis longtemps, la Centrafrique n’est qu’un Etat fantôme. Aujourd’hui, le régime du président Touadéra n’existe qu’à l’intérieur de la bulle de Bangui, où les partis politiques ourdissent comme si de rien n’était des luttes politiques stériles aiguisées par la perspective gourmande de fondre un jour sur les maigres prébendes d’un Etat décharné. Pendant ce temps, le pays implose.
Six casques bleus assassinés
A Bria, le commandant de gendarmerie en témoigne. Dans cette ville de 46 000 habitants, sa « compagnie » ne comptait avant les violences que quinze éléments. Ils ne sont plus que sept, qui, par sécurité, se sont fondus parmi les civils. Les autres ont quitté la ville. « Nous sommes musulmans, originaires de Birao, dans le Nord. De gendarmes, nous n’avons que le nom. Nous n’avons même jamais eu un vélo pour nous déplacer », se lamente le commandant en ajustant son pantalon de survêtement.
Le maire, nommé par le gouvernement, raconte aussi ce naufrage national, sur un ton infiniment triste. « Les fonctionnaires de la mairie doivent aller à Bangui pour toucher leur salaire. En temps normal, c’est une semaine en bus », explique Maurice Balekouzou. Difficilement imaginable en ces temps d’embuscades.
Lui ne sort de la mission catholique que pour aller à l’hôpital visiter son frère et son jeune neveu, grièvement blessé à coups de machettes lors de ces tristes journées de mai. « Ils sont venus chez nous. Mes trois maisons ont été pillées et incendiées. J’ai pu m’enfuir en brousse. Ils me cherchaient pour me tuer », raconte-t-il. Ils ? « Les Tchadiens », glisse-t-il en désignant le quartier de La Smi, de l’autre côté du vaste terrain vague qui s’étend devant l’entrée de la mission.
C’est de là que le « général » Ahmat Issa faisait régner la terreur. Samedi 17 juin, il est tombé dans une embuscade à l’extérieur de la ville. « Aujourd’hui, ils sont en deuil, les magasins sont fermés, mais tout le monde s’interroge sur la réaction de ses hommes. Il y a de la tension », témoigne un habitant joint au téléphone.
Rencontré quelques jours avant sa mort, Ahmat Issa, ancien sous-officier des Forces armées centrafricaines (FACA) devenu rebelle, justifiait la mise à sac de Katekondji. Selon lui, c’était la conséquence d’une autre tuerie qui avait eu lieu une semaine auparavant à 300 km plus au sud, à Bangassou, sur les rives de la rivière Mbomou, qui marque la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC).
« Une centaine de musulmans, civils pour la plupart, y ont été tués par quelque 300 à 500 combattants anti-balaka », selon une source étrangère. Quelques jours avant l’assaut, six casques bleus – notamment des éléments cambodgiens – ont été sauvagement assassinés non loin de la ville par ces mêmes forces.
« Tués jusque dans la mosquée »
Les tueries ont définitivement enterré une coalition contre-nature réunissant des groupes anti-balaka et des ex-Séléka. Les ennemis acharnés d’hier se trouvaient des intérêts communs : faire pression sur le pouvoir pour obtenir l’immunité de leurs crimes passés, le contraindre à leur faire une place au gouvernement et autoriser le retour au pays des anciens présidents, François Bozizé (2003-2013) et Michel Djotodia (2013-2014).
Mais à Bangassou, le plan initial, qui visait un de leurs ennemis communs, les Peuls de l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC, d’Ali Darassa), a dérapé. « Beaucoup d’Arabes, des commerçants notamment, ont péri, tués jusque dans la mosquée », rapportait le général Ahmat Issa. Par « Arabes », entendons des Tchadiens installés en Centrafrique, certains nés ici, d’autres nouveaux venus. C’était le vivier du « général » Ahmat Issa.
Selon lui, après Bangassou, une partie des anti-balaka s’étaient dirigés vers Bria avec le même objectif : chasser la communauté musulmane de cette ville qu’elle contrôle désormais alors qu’elle ne représente que 30 % des 46 000 habitants. « Ils se sont infiltrés dans le quartier, on les a attaqués », expliquait Ahmat Issa. Les centaines de maisons brûlées ? « Celles de tous ceux qui les hébergeaient », dit-il sans ciller.
En Centrafrique, la paix est-elle possible ?
Durée : 03:15
Plus de 40 000 déplacés
Ces présumés complices des anti-balaka, on les retrouve aujourd’hui au camp de déplacés du PK3, où 30 000 personnes s’agglutinent autour d’une base des casques bleus. En y ajoutant les infortunés regroupés dans les cours de l’hôpital et de la mission catholique, Bria compte aujourd’hui 41 000 personnes déplacées par les violences.
« Certains viennent de villages alentours, mais la majorité sont de Bria », se désole Lucien Simba, le représentant local du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA). Autrement dit, la quasi-totalité des non-musulmans, même s’ils n’étaient pas attaqués, ont fui leur domicile pour se placer sous le parapluie de la Minusca, dont tout le monde critique le manque de réactivité. En plus d’être une catastrophe humanitaire, le PK3 est une poudrière où chacun rumine sa vengeance.
L’imam Gazouli de la mosquée du quartier tchadien doit le pressentir. Mais il n’a pas un mot de compassion pour ces malheureuses familles sous leurs tentes de fortune. Pour justifier ces violences, l’imposant vieillard appelle les hommes de sa communauté à « défendre leur famille et leurs intérêts ». « Je leur dis, aux jeunes, que sinon les anti-balaka viendront brûler nos maisons et nous manger ». Certes, il concède du bout des lèvres que « tous les Chrétiens n’en font pas partie ».
Devant son église, l’abbé Gildas pèse ses mots, mais d’autres religieux n’ont pas ces précautions. « C’est la faute aux musulmans, les Tchadiens doivent partir », glisse l’un d’eux. Un discours qui rappelle ceux de 2013 et 2014, qui débouchèrent sur d’horribles massacres.
« On fonce droit dans le mur »
Ces jours-ci à Bria, les tensions montrent que la ligne de fracture n’est pas seulement religieuse. C’est aussi entre ex-Séléka que le torchon brûle. Pour des raisons politiques, ethniques – Goula contre Rounga ou Tchadiens – et économiques, la région recelant de nombreux gisements de diamants. Le tout attisé par une lutte des chefs.
Ainsi l’autorité d’Abdoulaye Hissène, le « ministre de la défense » de l’ex-Séléka, sous le coup d’un mandat d’arrêt international, vacille. « Il constitue un problème avec ses Tchadiens et Soudanais. Chez nous il n’y a que des locaux. La Séléka n’existe plus, ceux qui s’en réclament sont des voleurs », tranche le « général » Issa Issaka, l’un des « officiers » influents du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC), une coalition née des cendres de l’ancienne rébellion.
Ces dissensions remontent à la création de la Séléka, en 2012. Mais le conflit s’envenime. Les armes n’ont jamais autant circulé, portées aussi par des mercenaires. « J’ai des Tchadiens et des Soudanais avec moi », reconnaît Abdoulaye Hissène. Dans le camp d’en face, les anti-balaka ont troqué leurs arcs et leurs lances contre des kalachnikovs.
Pendant ce temps-là, les 12 000 hommes de la Minusca courent d’un feu de brousse à l’autre, toujours avec un temps de retard, perdant leur crédibilité et leur pouvoir dissuasif. « Leur lance est trop courte », illustre un militaire étranger. « A Bria comme ailleurs, on fonce droit dans le mur sans savoir comment l’éviter », résume un diplomate étranger. Et la mort d’Ahmat Issa pourrait encore raccourcir la distance.