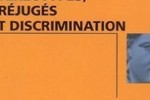« Je veux amener d’autres Afriques sur scène et révéler les idées préconçues »

« Je veux amener d’autres Afriques sur scène et révéler les idées préconçues »
Propos recueillis par Séverine Kodjo-Grandvaux (contributrice Le Monde Afrique, Douala)
A l’occasion du Festival d’Avignon, le chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly invite à décoloniser les imaginaires et les pratiques artistiques.
Programmé dans le « in » d’Avignon avec Kalakuta Republik, un spectacle en hommage au père de l’afrobeat Fela Kuti, Serge Aimé Coulibaly est un artiste complet, qui a été formé au jeu d’acteur, à la danse, à la musique et au chant au sein de la première troupe professionnelle d’Afrique de l’Ouest, Feeren.
A la tête de la compagnie Faso Danse Théâtre qu’il a créée, le Burkinabé revient, pour Le Monde Afrique, sur la polémique soulevée par Dieudonné Niangouna qui, dans un texte au vitriol, condamne le « Focus Afrique » du Festival d’Avignon, qui aura lieu du 6 au 26 juillet. Si Serge Aimé Coulibaly voit lui aussi d’un œil critique cette tendance occidentale à enfermer la création africaine dans des temps forts spécifiques, il n’en est pas moins en désaccord avec la manière dont le dramaturge congolais oppose la parole à l’expression corporelle, le théâtre à la danse ou à la musique. Pour lui, cette bataille des disciplines artistiques est très française et bien peu africaine.
La séparation de la parole et du corps, du théâtre et de la danse, fait-elle sens en Afrique ?
Serge Aimé Coulibaly Absolument pas. Prenons, par exemple, le wara que l’on pratique en terres senoufo lors des récoltes de mars. C’est une représentation rituelle, qui intègre le spectateur. Il n’y a pas de face-à-face entre lui et ce qui se joue, comme on peut le voir dans le théâtre en France. Il n’y a pas non plus un moment consacré à la parole et un autre à la danse. Tout se fait en même temps. Et cela correspond à nos manières d’être, de vivre. Si ma mère veut m’annoncer une bonne nouvelle, elle va parler mais aussi chanter et danser en même temps. Tout cela est, en fait, une seule forme d’expression ; celle d’une personne dans son entièreté. Autre exemple, au Burkina, les musiciens peuvent à n’importe quel moment poser leur instrument et venir danser ou dire quelque chose sur le devant de la scène. Personne ne songerait à s’en étonner. La séparation de la parole et du corps n’est absolument pas burkinabée. Elle est arrivée avec la pratique occidentale du théâtre.
Comprenez-vous que réduire la production scénique africaine au corps puisse poser problème et renvoyer à l’imaginaire colonial de Noirs qui dansent mais ne pensent pas ?
Je ne nie pas qu’il y ait un fantasme sur le corps noir et que l’on voit en lui quelque chose de bestial. Certains de nos aînés en écrivant que « l’émotion est nègre comme la raison est hellène »* ne nous ont pas aidés. Mais ce n’est pas parce que les pensées qui ont justifié la colonisation ont dévalorisé nos manières de nous exprimer dans nos arts que nous devons nous abaisser à leur niveau et reproduire leurs travers ! On a trop tendance à vouloir nous enfermer dans des boîtes, surtout en France, où on aime produire des catégories pour maîtriser les gens et les mettre là où l’on veut. D’où, d’ailleurs, ces « Focus Afrique »…
Ce problème est-il très francophone finalement ?
Je ne m’étais pas posé la question, mais sans doute. Notre problème à nous, Africains francophones, c’est que nous sommes des petits Français. Je dirais même des sous-Français. On critique la France, mais on raisonne avec les éléments de la France. Notre culture n’est pas seulement africaine. Elle est à 70 % française. On s’éduque avec les mêmes livres qu’à Paris. A l’école, on ne m’a pas appris les chansons du village mais « Malbrough s’en va-t-en guerre ». J’ai grandi avec le même imaginaire qu’un enfant en Alsace. La question est : à quel moment décide-t-on de ne plus être français ? Cet ancrage est beaucoup plus profond qu’il n’y paraît.
Kalakuta Republik - Faso Danse Théâtre & Halles de Schaerbeek
Faut-il s’engager dans un processus de décolonisation des imaginaires et des arts ?
C’est le fondement même de mon travail. Les journalistes, les critiques, les programmateurs ont leur propre approche du travail de la scène et ont tendance à vous l’imposer. C’est problématique. Ils ont aussi leur lecture de l’Afrique. On vit à l’ère d’un journalisme rapide, superficiel, qui n’a pas le temps de travailler en profondeur. Concernant l’Afrique, il y a des sujets vendeurs aussi bien pour les médias que pour les théâtres : la guerre, les enfants-soldats, l’excision, etc. Tout cela contribue à une image du continent qui empêche de regarder une autre Afrique, qui bouge, qui est dynamique et qui présente quelque chose que l’Occident peut trouver bizarre, parce que ne correspondant pas à ses réalités.
Il faut donc décoloniser les imaginaires, les démonter, surprendre le public. Mon objectif est d’amener d’autres Afriques qu’on ne présente pas assez sur scène et de révéler un certain nombre d’idées préconçues, sans en faire tout un discours. Il y a une énergie positive qui fait que le continent reste unique et fascinant. Nous sommes à une période où tout est à construire en Afrique et où l’on peut encore décider quel sens donner à cette construction.
Il est souvent reproché à la création contemporaine du continent de s’adresser plus à des programmateurs européens qu’à un public africain. Est-ce justifié ?
Les artistes africains qui maîtrisent leur art créent pour eux-mêmes, pour leur population. C’est évident pour eux. Créent-ils, de manière inconsciente, aussi en fonction de ce qu’attendent les programmateurs étrangers ? Peut-être. La relation avec ces derniers a beaucoup évolué. Ils sont plus dans l’écoute même s’ils ne sont pas encore dans l’intérêt réel. Parfois je me pose des questions.
Comment expliquer, par exemple, que Nuit blanche à Ouagadougou [sa création précédente qui anticipait la révolte populaire qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir en 2014] n’a été présentée que dans trois villes en France alors que ce spectacle a très bien tourné en Belgique, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Croatie… et en Afrique ? Il y a eu un engouement là où l’on ne connaissait pas bien l’histoire de la révolution au Burkina alors qu’en France on trouve ça « trop politique ». Sans compter que, sur scène, il y a Smockey [l’un des leaders du Balai citoyen, mouvement contestataire burkinabé] et que Smockey ne s’excuse pas d’être là. Les Français n’ont pas l’habitude de cela. Ils aiment les Africains polis. Cela nous invite à ne plus être en dialogue uniquement avec la France, mais à regarder là où la relation n’est pas héritière de l’histoire coloniale et où un non-Africain est capable de penser qu’il a quelque chose à apprendre d’un Africain.
La création contemporaine a parfois du mal à rencontrer son public. Comment l’expliquer ? Faut-il jouer dans les langues nationales, plus proches des populations ?
On mélange souvent création contemporaine et mauvaises créations. Quand le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou (CITO) se tient, les salles sont pleines. Le public y trouve son compte. Certaines des pièces qui y sont présentées pourraient très bien tourner à l’international. D’autres pas, il faut le reconnaître. Quant au débat sur les langues, il faut le dépasser. Il n’y a aucune obligation en la matière. Que celui qui veut créer une pièce en français ou en dioula le fasse. Mais ce n’est pas ça qui va rapprocher le théâtre du public. Si vous donnez une pièce en moré à Ouagadougou, ça ne pose pas de problème mais si vous la jouez à Bobo Dioulasso, il faudra un dispositif de traduction. Au Sénégal, où presque tout le monde parle le wolof, la question se pose différemment.
Quand je danse je parle aussi et...FR, Ghana
Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Mes sources d’inspiration sont africaines, burkinabées. Elles viennent de là où j’ai grandi. Mais, dans leur réalisation, elles sont mondiales. Depuis que j’ai 30 ans, je travaille davantage hors d’Afrique que sur le continent. Et je ne vois pas pourquoi je devrais me priver de toutes les connaissances que j’ai acquises. Si je fabrique un ordinateur au Burkina, je dois m’assurer qu’il fonctionne aussi en Chine ou aux Etats-Unis. Je dois prendre en considération ce monde dans lequel je m’insère avec mes propres outils. Les artistes sont dans la même logique. Je crée un spectacle à Ouagadougou, je veux que ma mère le comprenne, le critique, tout comme je veux que le monde entier puisse le voir et le critiquer. Est-ce que pour autant mon spectacle ne serait pas assez africain ? Comme s’il y avait quelque chose en Afrique qui ne serait pas assez africain ! On peut être très africain et très universel en même temps, c’est ce grand écart qui m’intéresse. Etre africain ne nous fait pas exister en dehors du monde. Ce que le monde est aujourd’hui, l’Afrique y a contribué.
*Phrase de Léopold Sédar Senghor.