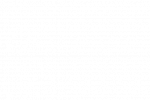Livres et BD à offrir : les coups de cœur de la rédaction du « Monde des livres »

Livres et BD à offrir : les coups de cœur de la rédaction du « Monde des livres »
LE MONDE DES LIVRES
Les cinq livres préférés de chacun(e) des membres de l’équipe du « Monde des livres ».
Pour les fêtes de Noël, les journalistes de l’équipe du « Monde des livres » proposent, chacun(e) une sélection de cinq livres ou bandes dessinées qu’il faut, selon eux ou elles avoir lus. Et offrir.
L’Art de perdre, d’Alice Zeniter.
Europa. Notre histoire, sous la direction d’Etienne François et Thomas Serrier.
Se défendre. Philosophie de la violence, d’Elsa Dorlin.
En terrain miné, d’Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay.
Le Voleur de chocolat, de Geronimo Stilton
L’Ordre étrange des choses, d’Antonio Damasio
Défense de Prosper Brouillon, d’Eric Chevillard
Me voici, de Jonathan Safran Foer
Bibliothèque idéale des philosophes antiques, édité par Jean-Louis Poirier
Le Chemin des humbles, de Rémi Bordes
Les Fantômes du vieux pays, de Nathan Hill
Summer, de Monica Sabolo
Une odyssée. Un père, un fils, une épopée, de Daniel Mendelsohn
L’Avancée de la nuit, de Jakuta Alikavazovic
La Serpe, de Philippe Jaenada
Classé sans suite, de Claudio Magris
Le Sympathisant, de Viet Thanh Nguyen
Retour à Lemberg, de Philippe Sands
Les Huit Montagnes, de Paolo Cognetti
Les Belles de Halimunda, d’Eka Kurniawan
Opération Copperhead, de Jean Harambat
Nos vacances, de Blexbolex
Alors que j’essayais d’être quelqu’un de bien, d’Ulli Lust
Crache trois fois, de Davide Reviati
Bangalore, de Simon Lamouret
Correspondance (1944-1959), d’Albert Camus et Maria Casarès
Sur l’écriture, de Charles Bukowski
Hérésies glorieuses, de Lisa McInerney
Glaise, de Franck Bouysse
Une colonne de feu, de Ken Follett
L’Archipel des Solovki, de Zakhar Prilepine
La Maison éternelle, de Yuri Slezkine
Histoire des Indes, de Michel Angot
Les femmes sont des guitares (dont on ne devrait pas jouer), de Clemens Setz
La Première Pierre, de Carsten Jensen
Le choix de Jean Birnbaum
1. « L’Art de perdre », d’Alice Zeniter
De « retour » en Algérie, ce pays dont elle ne connaît guère plus qu’une fiche Wikipédia, Naïma tente de « combler les silences transmis entre les vignettes » : silences sur la guerre d’indépendance, sur l’exil des harkis, sur les camps où la France les « accueille », sur le déclassement des parents, la honte des enfants… La jeune femme, née d’une mère dijonnaise, Clarisse, et d’un père kabyle, Hamid, cherche à percer les silences que celui-ci lui a légués, et dont il a lui-même hérité d’Ali, harki jadis notable en son pays, qui a tout perdu quand il fut chassé par le FLN, en 1962. Dans ce roman, qui a obtenu le Goncourt des lycéens après avoir été couronné par le prix littéraire Le Monde, Alice Zeniter met des mots sur une interminable aphasie, celle d’une famille, la nôtre aussi. D’une plume maîtrisée, avec une sensibilité rigoureuse et vaillante, la romancière de 31 ans est allée chercher la leçon des aïeux muets : les pères ne répondent pas, c’est entendu. Plutôt que de leur en faire grief, elle se met à l’écoute de leurs failles, elle les déplace superbement pour trouver le chemin d’une émancipation, la possibilité d’un corps indépendant. La voici, la libération.
L’Art de perdre, d’Alice Zeniter, Flammarion, 510 p., 22 €.
2. « Europa. Notre histoire », sous la direction d’Etienne François et Thomas Serrier,
Ce « tour d’Europe des mémoires » évoque tour à tour des personnages historiques (Averroès, Léonard de Vinci, Churchill…), des villes (Venise, Dakar ou Berlin), des « brûlures » sanglantes (croisades, guerres, génocides) et tout un essaim d’expériences vécues (prier, écrire un roman, aller au stade, faire grève, faire l’amour aussi)… Tout en s’inscrivant dans la veine contemporaine d’une histoire croisée, qui privilégie les partages et les échanges, cette somme internationale dessine donc les contours d’une aventure singulière. Dès lors qu’elle est prise en charge collectivement, cette histoire laisse entrevoir la possibilité d’un « nous ». Fragile et contradictoire, certes, toujours en mouvement, bien sûr, mais un « nous » quand même. Or dans un monde où l’Europe apparaît de plus en plus marginalisée, il se pourrait que sa singularité importe. Face à la terreur djihadiste, au despotisme poutinien ou aux délires trumpistes, le Vieux Continent se propose comme lieu d’une différence. Ainsi Europa engage-t-elle bien plus qu’un espace géographique ou un patrimoine historique : l’urgence d’une responsabilité.
Europa. Notre histoire. L’Héritage européen depuis Homère, sous la direction d’Etienne François et Thomas Serrier, Les Arènes, 1 386 p., 39 €.
3. « Se défendre. Philosophie de la violence », d’Elsa Dorlin
La philosophe Elsa Dorlin rend ici justice aux pratiques d’autodéfense déployées par les opprimés face à leurs oppresseurs. Le geste de survie, porteur d’un universel tout en intensité, rayonne par-delà les identités. Elle décrit divers exemples de ce qu’elle nomme les « éthiques martiales de soi », depuis la résistance des esclaves jusqu’aux gestes de protection de Rodney King, lynché par la police de Los Angeles en 1991, en passant par le panache des féministes britanniques s’appropriant d’un seul et même élan, au début du XXe siècle, la politique et les arts martiaux. Revenant à la vérité charnelle de la politique, Dorlin décrit magnifiquement les données immédiates de la conscience traquée : insécurité de tous les instants, état d’alerte permanent, « chimie de la peur »… Tant et si bien qu’elle construit ce qu’on pourrait nommer une « philosophie à mains nues », qui explore la façon dont le pouvoir domestique les corps, mais aussi le brusque sursaut des corps qui se libèrent.
Se défendre. Philosophie de la violence, d’Elsa Dorlin, Zones, 256 p., 18 €.
4. « En terrain miné », d’Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay
Sur ce champ de bataille qu’est le champ intellectuel, la guerre ne se mène pas en gants blancs. Pétrarque évoquait déjà « une arène poussiéreuse et bruissante d’injures ». Dans cette arène féroce, la violence étouffe la possibilité même de ce lien exigeant, à la fois sincère et frontal, qu’on nomme amitié. Voilà pourquoi le XXe siècle apparaît « jonché d’amitiés mortes », comme le rappelle Alain Finkielkraut dès sa première lettre à Elisabeth de Fontenay, philosophe pleine de vergogne, avec laquelle il entretient, depuis près de quarante ans, une relation de tumultueuse complicité. Au cœur de cette mêlée, tous les coups sont permis, peu importe la vérité. Quiconque a mis les pieds dans cette arène-là sait qu’une force et une seule peut vous éviter d’y être définitivement enfermé : celle d’une bienveillante franchise. Il n’y a rien de plus solide que l’inflexible tendresse d’une personne qui vous aime assez pour vous dire les choses : « Je comprends qu’il soit plus déroutant pour toi de faire face à des critiques amicales qu’à l’animosité d’un ennemi », résume Elisabeth de Fontenay dans cette correspondance qui se lit comme un hommage à la puissance salvatrice de l’amitié.
En terrain miné, d’Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay, Stock, 270 p., 19,50 €.
5. « Le Voleur de chocolat », de Geronimo Stilton
Voyez le succès planétaire de Geronimo Stilton, la souris enquêteuse qui dirige L’Echo du rongeur et qui peut être fière de sa riche bibliographie. Depuis sa naissance en Italie, en 2002, elle a conquis l’Europe mais aussi les Etats-Unis et la Chine. Ses aventures se sont vendues à 140 millions d’exemplaires (8 millions rien qu’en France). Or Geronimo Stilton met un point d’honneur à signer ses propres livres, et c’est l’une des clés de son succès : dans les salons comme dans les librairies, les jeunes lecteurs viennent discuter avec Stilton lui-même, incarné par des comédiens, toujours les mêmes, qui connaissent son œuvre sur le bout des pattes. Il faut dire que la souris investigatrice est à la fois serviable, fragile et drôle, comme on le constatera encore une fois dans Le Voleur de chocolat, où elle tente de retrouver l’Œuf de Rabergé, ce bijou sans prix, en compagnie de Farfouin, son ami détective. Comme dans les hors-séries qui ont fait connaître cet antihéros si attachant (Le Voyage dans le temps, Le Royaume de la fantaisie…), on retrouvera ici les ingrédients qui nourrissent le pouvoir de séduction de Stilton auprès des enfants : l’humour vif, l’énergie narrative, le jeu sur les typographies qui exalte les mots en les exhaussant.
Le Voleur de chocolat, de Geronimo Stilton, traduit de l’italien par Marianne Faurobert, Albin Michel Jeunesse, 128 p., 7,20 €. Dès 8 ans.
Le choix de Florent Georgesco
1. « L’Ordre étrange des choses », d’Antonio Damasio
Qu’avons-nous en commun avec la première bactérie apparue il y a plus de 3,5 milliards d’années ? Le nouvel essai du neurologue américain Antonio Damasio, connu pour ses travaux révolutionnaires sur le rôle des émotions dans la formation de la conscience, a pour point de départ l’observation, dans toutes les formes de vie, jusqu’au niveau cellulaire, de comportements en partie similaires aux nôtres. Les frontières de l’humain et du non-humain ne disparaissent pas au passage mais se déplacent, deviennent mouvantes, ce qui fait de cette exploration des surprises de la vie un stimulant et vertigineux exercice de redéfinition du propre de l’homme.
L’Ordre étrange des choses. La vie, les sentiments et la fabrique de la culture, d’Antonio Damasio, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean-Clément Nau, Odile Jacob, 392 p., 26,90 €.
2. « Défense de Prosper Brouillon », d’Eric Chevillard
Pas de feuilleton sans dénouement : Défense de Prosper Brouillon est le coup de théâtre de celui qu’Eric Chevillard a tenu six ans dans « Le Monde des livres », expérience qui lui a parfois valu d’affronter la prose burlesque de gens passant par malentendu pour des écrivains. Si les citations qui parsèment ce petit livre hilarant (souvent à cause d’elles) sont tirées de livres réels, elles sont attribuées à un unique personnage fictif : Prosper Brouillon, monstre aux mille têtes, toutes difformes. Et Chevillard, en s’amusant à les relier entre elles dans une étude pince-sans-rire de l’œuvre brouillonesque, recrée de la littérature à partir de son absence, et réussit le tour de force de faire place nette au moment même où il remplit un vide.
Défense de Prosper Brouillon, d’Eric Chevillard, illustrations de Jean-François Martin, Notabilia, 104 p., 14 €.
3. « Me voici », de Jonathan Safran Foer
Les Bloch vont mal, Israël aussi ; Israël est détruit, les Bloch, peut-être pas. Comment survivre quand il n’y a plus de Terre promise ? L’Américain Jonathan Safran Foer raconte l’effondrement parallèle d’une famille et d’un pays comme les deux faces d’un unique apprentissage du deuil. Me voici, son plus magistral roman à ce jour, est le grand livre de la destruction de ce qui rend le monde habitable, la magistrale leçon des ténèbres d’un écrivain au sommet de ses moyens, capable de trouver à chaque paragraphe une manière neuve de traduire la mélancolie et la précarité dans une langue virevoltante, profondément heureuse y compris quand elle devient déchirante. Et qui, elle, triomphe de tout, même de la fin de tout.
Me voici, de Jonathan Safran Foer, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Stéphane Roques, L’Olivier, 752 p., 24 €.
4. « Bibliothèque idéale des philosophes antiques », édité par Jean-Louis Poirier
Une anthologie peut être un pis-aller pour lecteur pressé. Ou, si elle est l’œuvre d’un grand passeur comme Jean-Louis Poirier, devenir une invitation à cesser illico de gagner du temps pour partir se perdre, ainsi qu’il l’écrit dans son introduction, « sur des terres largement inconnues ». On retrouve là aussi bien Platon, Aristote et Epicure que des penseurs moins familiers, tels Alexandre d’Aphrodise ou Victorinus, mais les premiers eux-mêmes, grâce à la virtuosité des choix de Poirier, se montrent sous un jour inattendu. Tout, par le miracle de l’érudition, redevient neuf dans ces pages qui accomplissent délicieusement le vœu formulé par leur artisan : « Puisse ce livre donner une idée de ce qu’aucun livre, aucune bibliothèque ne peut enfermer ! »
Bibliothèque idéale des philosophes antiques. De Pythagore à Boèce, textes rassemblés et présentés par Jean-Louis Poirier, Les Belles Lettres, 686 p., 29,50 €.
5. « Le Chemin des humbles », de Rémi Bordes
La première fois qu’il a débarqué au Népal, Rémi Bordes ne savait pas ce qu’il venait y chercher. « Cela tombait bien, commente-t-il, car on y trouve à peu près tout. » Le charme singulier qui émane de son livre tient dans ces quelques mots, par lesquels le jeune anthropologue, parti pour de longs séjours en immersion, se donne une feuille de route à peu près infinie. Le savoir est-il une clé pour ouvrir le réel ou une grille qui l’écrase et l’enferme ? En choisissant d’écrire la chronique quotidienne de sa vie népalaise, mélange d’observation savante et de récit souvent drolatique des aventures d’un jeune homme apprenant à vivre la vie des autres, Rémi Bordes fait le pari de l’immensité, d’un savoir aussi large et divers que la vie humaine. Un réjouissant éloge de l’expérience concrète comme modalité de la connaissance.
Le Chemin des humbles. Chroniques d’un ethnologue au Népal, de Rémi Bordes, Plon, « Terre humaine », 466 p., 21,90 €.
Le choix de Raphaëlle Leyris
1. « Les Fantômes du vieux pays », de Nathan Hill
Un premier roman d’une ambition aussi ahurissante que son souffle. L’Américain Nathan Hill croise les histoires de Faye, qui a abandonné son fils Samuel quand il avait 11 ans, et de celui-ci – qui retrouve la première vingt ans plus tard. Le lecteur plonge alternativement dans la jeunesse de Faye, au cœur des protestataires années 1960, dans l’enfance silencieuse de Samuel, et dans les années 2000, marquées par la contestation de la guerre en Irak et le mouvement Occupy Wall Street. Maniant aussi bien la satire que le tragique, le tableau d’époque que le portrait d’individus reclus dans leur solitude, Nathan Hill offre avec ce somptueux pavé l’une de ces bulles de fiction où l’on voudrait pouvoir se lover pour toujours.
Les Fantômes du vieux pays, de Nathan Hill, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Mathilde Bach, Gallimard, « Du monde entier », 720 p., 25 €.
2. « Summer », de Monica Sabolo
Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, la belle Summer a disparu. S’est-elle noyée ? Enfuie ? A-t-elle été enlevée ? C’était il y a vingt-quatre ans. Tout juste adolescent à l’époque, Benjamin, son frère, a presque tout oublié de ce jour. A 38 ans, il s’allonge sur le divan d’un psychanalyste et, pour sauver sa peau, mène l’enquête, dans ses souvenirs enfouis, puis auprès des témoins de l’époque, sur la disparition de Summer. Histoire de fantôme et d’absence, ce Summer à l’hypnotique beauté est gorgé de métaphores et de comparaisons liquides, donnant l’impression que les personnages évoluent dans une lumière aqueuse, avec la lenteur qu’imprime l’eau aux mouvements. Obsédant.
Summer, de Monica Sabolo, JC Lattès, 316 p., 19 €.
3. « Une odyssée. Un père, un fils, une épopée », de Daniel Mendelsohn
Pendant un semestre, Jay Mendelsohn, 81 ans, est venu assister au séminaire donné à l’université par son fils, Daniel, sur l’Odyssée, d’Homère. Ce livre tresse ensemble la description de ces mois de cours, l’analyse du texte homérique, l’évocation des relations complexes du père et du fils depuis l’enfance, et le récit de la croisière que les deux hommes ont faite sur les traces d’Ulysse l’été suivant – le dernier du vieil homme. L’Américain Daniel Mendelsohn signe un livre prodigieux d’intelligence et de sensibilité, merveilleusement limpide, alors qu’il brasse, outre son érudition, tant de sentiments complexes – ces couches d’amour, d’embarras, de ressentiment, d’admiration, d’incompréhension, de pardon, qui constituent les liens familiaux.
Une odyssée. Un père, un fils, une épopée, de Daniel Mendelsohn, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Clotilde Meyer et Isabelle D. Taudière, Flammarion, 432 p., 23 €.
4. « L’Avancée de la nuit », de Jakuta Alikavazovic
Il y a toujours une femme fatale dans les livres de Jakuta Alikavazovic. Celle de L’Avancée de la nuit s’appelle Amélia Dehr, et l’on sait d’emblée que c’est à elle-même qu’elle sera fatale, puisque le livre s’ouvre sur l’annonce de son suicide à son ancien amant, Paul. Comment la nuit s’est-elle refermée sur cet être si flamboyant ? Remontant à la rencontre de Paul et Amélia, ce roman entêtant, dont chaque phrase ou presque recèle une trouvaille – une image frappante, une idée brillante, voire les deux – retrace la « valse d’évitement » que sera l’histoire de ces personnages, en même temps qu’il décrit un monde laissant la nuit, et la peur, l’emporter. Un livre aussi profondément intime que politique, d’une beauté troublante
L’Avancée de la nuit, de Jakuta Alikavazovic, L’Olivier, 284 p., 19 €.
5. « La Serpe », de Philippe Jaenada
En 1941, en Dordogne, trois personnes ont été massacrées dans un château à coups de serpe. Henri Girard, qui est le fils de l’une des victimes et le neveu d’une autre (la troisième travaillait pour la famille), dormait dans une autre aile de cette maison fermée de l’intérieur et n’a rien entendu. Tenu pour l’unique suspect, il sera acquitté en 1943, mais le soupçon lui collera à la peau jusqu’à sa mort, en 1987 – entre-temps, il sera devenu l’écrivain Georges Arnaud, auteur du Salaire de la peur (Julliard, 1950). Si La Serpe commence comme une partie de Cluedo, on ne le referme pas dans cet état d’esprit. Faisant de l’exégèse d’un dossier judiciaire l’efficace ressort de son suspense, Jaenada réinvente en partie le genre du roman de procès et lui applique sa patte unique, faite d’une drôlerie tendre et sombre. Rendant à Henri Girard son statut d’innocent et de victime ayant perdu son père adoré, il transforme mine de rien La Serpe en une superbe évocation de l’amour paternel et de l’amour filial.
La Serpe, de Philippe Jaenada, Julliard, 648 p., 23 €.
Le choix de Florence Noiville
1. « Classé sans suite », de Claudio Magris
Pendant la seconde guerre mondiale, dans les faubourgs de Trieste (Italie), la Risiera di San Sabba – autrefois une usine de décorticage de riz – fut transformée en un camp de concentration tenu par les nazis. L’écrivain slovène Boris Pahor y fut incarcéré et les historiens estiment qu’entre 3 000 à 5 000 personnes y furent assassinées. Mais les Triestins, eux, ont longtemps tout fait pour oublier la Risiera. Murs blanchis à la chaux, graffitis et pièces à conviction effacés, bâtiments incendiés… Leur arme suprême cependant fut le silence. Dans cette passionnante fiction-enquête, le grand écrivain italien Claudio Magris démonte les mécanismes les plus dangereux de l’hypocrisie, du déni et du mensonge historique. A l’ère de la falsification et de la post-vérité, il se fait chercheur de vérité et livre un ouvrage on ne peut plus actuel, d’une étourdissante érudition. Une étude « totale » de l’humanité par l’un des écrivains les plus raffinés d’Europe.
Classé sans suite, de Claudio Magris, traduit de l’italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau, L’Arpenteur », 480 p., 24 €.
2. « Le Sympathisant », de Viet Thanh Nguyen
Dans cet impressionnant roman de l’Américain Viet Thanh Nguyen, nous sommes au Vietnam au moment de la débâcle américaine. Fils d’un prêtre français et d’une Vietnamienne, le narrateur est une taupe des Vietcongs infiltrée dans le régime sud-vietnamien et chargé d’organiser la fuite d’un général américain. En Amérique, il continue à espionner ce militaire qui rêve d’une mission de la dernière chance – un retour au Vietnam via la Thaïlande. La particularité de ce narrateur est qu’il est, comme le titre l’indique, un « sympathisant » aux deux sens du terme. Un communiste convaincu, proche du Parti d’une part. Mais aussi un homme qui sait faire preuve de sympathie au sens grec – il participe pleinement à la souffrance d’autrui – ce qui n’est pas toujours un avantage dans son métier d’espion. Ecrite sous le signe de Graham Greene, cette confession d’un agent secret est plus qu’un roman politique anti-impérialiste. C’est une réflexion subtile sur les ambiguïtés de l’Histoire « comme farce et comme tragédie ». Une méditation douloureuse sur la force et la valeur des idéaux.
Le Sympathisant, de Viet Thanh Nguyen, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Clément Baude, Belfond, 504 p., 23,50 €.
3. « Retour à Lemberg », de Philippe Sands
Voici un ouvrage difficile à classer. Ni manuel de droit, ni enquête historique, ni livre de mémoires, mais un peu tout ça à la fois. L’auteur, avocat franco-britannique, nous invite à suivre la naissance de deux concepts juridiques essentiels du XXe siècle, le génocide et le crime contre l’humanité. Nous découvrons le destin des juristes Hersch Lauterpacht et Raphael Lemkin. Tandis que, parallèlement, comme dans un thriller, nous suivons les traces du grand-père de l’auteur, Leon Buchholz, né à Lemberg (aujourd’hui Lviv, en Ukraine) en 1904 ; un homme qui, sous la menace nazie, dut fuir Lemberg pour Vienne puis Paris. Entrelaçant avec brio ces fils narratifs, Philippe Sands compose une réflexion très originale sur ce qui constitue le noyau dur de nos identités. Les traces indélébiles laissées par les secrets de famille. Et tous les silences qui, à notre insu, nous hantent et nous façonnent.
Retour à Lemberg, de Philippe Sands, traduit de l’anglais par Astrid von Busekist, Albin Michel, 544 p., 23 €.
4. « Les Huit Montagnes », de Paolo Cognetti
Le jeune Pietro, un enfant des villes, séjourne chaque été dans le val d’Aoste avec ses parents. Là, son père l’emmène grimper, il découvre l’ivresse de l’altitude et la beauté époustouflante de la montagne. Il fait aussi la connaissance de Bruno, un jeune berger qu’il suit dans les alpages et dont il devient l’ami. Nature, filiation et amitié composent le trépied sur lequel repose ce roman magnifiquement simple, tout à la fois fluide et poétique, profond et épuré, prix Strega en Italie et en France du prix Médicis étranger. La prose de l’Italien Paolo Cognetti – découvert en 2013 par les éditions Liana Levi avec Sofia s’habille toujours en noir – est comme les lacs transparents des hautes vallées alpines. Il faut se pencher longuement au dessus pour en apercevoir la profondeur.
Les Huit Montagnes, de Paolo Cognetti, traduit de l’italien par Anita Rochedy, Stock, 300 p., 21,50 €.
5. « Les Belles de Halimunda », d’Eka Kurniawan
Pour les amateurs de découvertes – ceux qui n’ont pas peur de s’éloigner des sentiers battus du monde anglophone – voici l’univers surréel d’Eka Kurniawan, auteur indonésien découvert en France avec L’Homme-tigre (Sabine Wespieser, 2015) et déjà traduit dans une trentaine de langues. Nous sommes ici à Java, dans une petite ville imaginaire du sud de l’île. Lorsque le livre s’ouvre, la terre tremble au cimetière d’Halimunda. Une sépulture vole en éclats et Dewi Ayu, morte vingt-et-un ans plus tôt, sort de sa tombe. Pourquoi cette ancienne courtisane revient-elle des ténèbres ? Parce qu’une malédiction pèse sur les femmes de sa famille depuis que sa mère l’a abandonnée bébé. Esprits néfastes, prédictions et maléfices sont la spécialité d’Eka Kurniawan, qui sait comme personne tricoter ensemble le réel et le merveilleux. De la colonisation néerlandaise à la dictature de Suharto, c’est l’histoire de l’Indonésie tout entière qui s’écrit en filigrane derrière cette envoûtante parabole.
Les Belles de Halimunda, d’Eka Kurniawan, traduit de l’indonésien par Etienne Naveau, Sabine Wespieser, 656 p., 27 €.
Le choix de Frédéric Potet
1. « Opération Copperhead », de Jean Harambat
Synthèse parfaite de la BD franco-belge et du roman graphique, cet album relate l’une des opérations d’espionnage les plus rocambolesques de l’histoire. Mai 1944, un sosie du maréchal Montgomery, le chef d’état-major britannique, s’envole pour Gibraltar à bord de l’avion privé de Churchill. Sa mission : faire croire aux Allemands que le débarquement aura lieu dans le sud de la France. Le sosie en question est un comédien australien sans talent, Clifton James. Pour restaurer sa mémoire, Jean Harambat a convoqué deux monstres sacrés du cinéma : David Niven et Peter Ustinov, qui prirent part à la seconde guerre mondiale. Inspirée du cinéma de Lubitsch, cette fantaisie militaire aux dialogues pince-sans-rire a permis à son auteur de recevoir le prix René-Goscinny du scénario.
Opération Copperhead, de Jean Harambat, Dargaud, 176 p., 22,50 €.
2. « Nos vacances », de Blexbolex
L’illustrateur français Blexbolex a imaginé une relation houleuse entre une petite fille et un éléphanteau, l’instant d’un été à la campagne. Dépourvu de texte, son album explore la naissance de ce venin insidieux qu’est l’intolérance, au cours de l’enfance. Déçue de ne pouvoir jouer avec un enfant de son âge, la fillette va maltraiter l’animal, au point de le faire fuir. L’auteur a observé les rapports de concurrence et de domination qui existent entre frères et sœurs ou dans les cours de récréation. Il les fait ici affleurer dans ce moment exonéré des contraintes familiales et scolaires que sont les vacances. Pépite d’or au Salon du livre jeunesse de Montreuil, cet ouvrage au grain épais diffuse un mystère que plusieurs lectures ne suffisent pas à lever.
Nos vacances, de Blexbolex, Albin Michel Jeunesse, 128 p., 18 €.
3. « Alors que j’essayais d’être quelqu’un de bien », d’Ulli Lust
L’auteure de Trop n’est pas assez (Çà et Là, 2011), récit initiatique dans lequel elle relatait une virée en Italie faite à 17 ans sur fond de nihilisme punk, poursuit la chronique de son existence dans le Vienne des années 1980. Elle a désormais 23 ans et tente – difficilement – de vivre du métier d’illustratrice. Mère d’un garçon de 5 ans né d’une rencontre sans lendemain, Ulli partage sa vie entre Georg, un comédien plus âgé qu’elle, et Kimata, un jeune Nigérian dont elle a fini par tomber amoureuse à force de coucher avec lui. L’ouvrage plonge dans la complexité de cette relation à trois qui vient heurter la bien-pensance de la société autrichienne de l’époque. L’amour peut-il se partager ?, interroge Ulli Lust dans cette confession au dessin faussement brouillon mais toujours juste.
Alors que j’essayais d’être quelqu’un de bien, d’Ulli Lust, Çà et Là, 368 p., 26 €.
4. « Crache trois fois », de Davide Reviati
Dessinateur des confins, l’Italien Davide Reviati aime situer ses histoires dans des banlieues désolées ou des campagnes sans charme où s’exaltent les sentiments. Il suit ici, sur plusieurs années, un petit groupe d’adolescents fréquentant le même lycée technique, qui tuent leur ennui entre parties de billard et soirées fumette dans un ancien bunker. Une famille tzigane s’est installée non loin, dans une ferme abandonnée. La sauvage Loretta exerce sur eux une fascination doublée de peur, renvoyant aux histoires de sorcières et de loup-garou. Le poids des préjugés fera-t-il basculer du mauvais côté ces garçons au coup de poing facile et plus vulnérables qu’ils ne le disent ? Dans cette chronique au long cours de la ruralité, Davide Reviati fait cohabiter violence et fragilité par la magie d’un dessin aux milliers de traits chahutés.
Crache trois fois, de Davide Reviati, traduit de l’italien par Silvina Pratt, Ici Même, 568 p., 34 €.
5. « Bangalore », de Simon Lamouret
Babylone de béton aux 9 millions d’habitants, Bangalore fait partie de ces villes indiennes ayant connu une croissance folle, ces dernières décennies, grâce au développement de l’informatique et des télécommunications. Un certain désordre urbain et social a accompagné cette mutation, comme a pu le constater Simon Lamouret, qui a vécu trois ans sur place. De son séjour, le dessinateur a ramené de grouillantes illustrations panoramiques à la mine de plomb, ainsi qu’une quinzaine d’historiettes relatant le quotidien d’une population morcelée par de grands écarts de richesse. Policiers chevauchant des motos aux motifs léopard, dentistes de rue soignant une carie pour quelques roupies, serviteurs promenant des labradors obèses… Immergé au cœur de cet épuisant bouillonnement humain, l’auteur fait assaut d’empathie pour brosser le portrait d’une ville en mouvement qui ne s’arrête jamais.
Bangalore, de Simon Lamouret, Warum, 112 p., 22 €.
Le choix de Macha Séry
1. « Correspondance (1944-1959) », d’Albert Camus et Maria Casarès
La correspondance amoureuse d’Albert Camus (1913-1960) et de Maria Casarès (1922-1996), flamboie. Elle embrase et transporte d’un bout à l’autre. De 1944, l’année de leur rencontre, au 30 décembre 1959, cinq jours avant la mort de l’écrivain, elle vibre d’une intensité qui ne faiblit jamais. Ils sont deux exilés, lui d’Algérie, elle d’Espagne. Ils se découvrent une « patrie », l’aimé(e), et soi-même à travers l’autre. De fait, ils se ressemblent et se rassemblent pour mieux s’aimer. Ils ont le feu et le verbe. Elle est « l’Unique », sa « savoureuse », son « finistère », sa « lumière noire ». « Ton air de frégate, les cordages de tes cheveux. » Il est son destin, dit-elle. L’amour ? La gravité qu’il inspire, « cette joie énorme qui anéantit », la réalité soudain augmentée. Magnifique.
Correspondance (1944-1959), d’Albert Camus et de Maria Casarès, Gallimard, 1 312 p., 32,50 €.
2. « Sur l’écriture », de Charles Bukowski
En 1956, Buk a 35 ans. Après une décennie de beuverie ininterrompue et un estomac perforé, il reprend frénétiquement la plume. Çà et là, il expédie poèmes ou nouvelles et se met à correspondre avec des gens de l’édition. Sur l’écriture, inestimable anthologie, dessine un portrait intime de l’auteur des Contes de la folie ordinaire. L’épistolier s’épanche avec le même naturel auprès d’amis ou d’inconnus. Sur l’écriture est bien plus qu’un formidable choix de lettres écrites par Charles Bukowski (1920-1994). C’est un éblouissant poème en prose, un hurlement d’amour à la littérature.
Sur l’écriture, de Charles Bukowski, édité par Abel Debritto, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Romain Monnery, Au diable vauvert, 320 p., 20 €.
3. « Hérésies glorieuses », de Lisa McInerney
Début d’une trilogie « sexe, drogue et rock’n’roll » situé dans la ville ouvrière de Cork, frappée par la crise économique, ce superbe roman choral relève de la chronique urbaine. Hérésies glorieuses se présente comme une ronde où alternent chutes et rédemptions, brutalité et amour. Par ce roman noir de l’addiction (alcool, drogue) et de la violence sociale, L’Irlandaise Lisa McInerney, 35 ans, s’inscrit dans le sillage du Britannique Melvin Burgess, de l’Américain Hubert Selby Jr et de l’Ecossais Irvine Welsh. Même sens du grotesque, même ambition de radiographier les bas-fonds et même énergie charriée par une écriture évitant surplomb ou moralisme. C’est cruel et empathique, abrasif et lyrique.
Hérésies glorieuses, de Lisa McInerney, traduit de l’anglais (Irlande) par Catherine Richard-Mas, Joëlle Losfeld, 464 p., 23,50 €.
4. « Glaise », de Franck Bouysse
Empruntant à plusieurs genres (récit de filiation, chronique paysanne, roman noir), Glaise débute en août 1914. Au hameau Chantegril, au pied du puy Violent dans le Massif central, deux hommes rejoignent leur régiment. Restent quatre femmes, un vieillard, deux adolescents ainsi qu’un infirme, le père Valette. Un pervers à la main atrophiée, un type répugnant et inquiétant. Avec ce drame rural de la Grande Guerre mais loin de son tumulte, Franck Bouysse livre une œuvre maîtresse. Glaise l’inscrit, en effet, dans le sillage de Pierre Bergounioux et de Pierre Michon, limousins comme lui, peintres des « vies minuscules », amoureux des sentes et des mots.
Glaise, de Franck Bouysse, La Manufacture de livres, 424 p., 20,90 €.
5. « Une colonne de feu », de Ken Follett
Une colonne de feu est la suite grandiose des Piliers de la terre, le monumental roman-feuilleton historique du Britannique Ken Follett. Cette fresque couvrant un demi-siècle et plusieurs pays peut se lire comme un roman d’espionnage, car c’est bien une guerre de renseignement à laquelle se livrent trois des protagonistes, sur les 130, historiques et fictifs, que compte le roman, deux Anglais de Kingsbridge opposés depuis l’enfance, ainsi qu’un Français arriviste qui dénoncera les protestants invités à son mariage par sa belle-famille et collectera de nombreux noms en vue du massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572.
Une colonne de feu, de Ken Follett, traduit de l’anglais par Cécile Arnaud, Jean-Daniel Brèque, Odile Demange, Nathalie Gouyé-Guilbert et Dominique Haas, Robert Laffont, 926 p., 24,50 €.
Le choix de Nicolas Weill
1. « L’Archipel des Solovki », de Zakhar Prilepine
Un magnifique roman dostoïevskien sur le premier des camps soviétiques, installé sur un archipel de la mer Blanche, dans le Grand Nord, dès les années 1920. Ce récit ne se limite pas à la constatation du malheur mais s’émerveille du contraste entre la beauté de la nature polaire et l’oppression. Le livre met aussi en évidence la force de résistance du héros, le jeune parricide Artiom, que la détention l’amène à une étrange relation amoureuse avec une geôlière et à la fréquentation du redoutable Fiodor Eikhmanis, chef du camp des Solovki. Dans cet ancien monastère transformé par les bolcheviks en « maison des morts », Artiom vit aussi l’expérience d’une rédemption.
L’Archipel des Solovki, de Zakhar Prilepine, traduit du russe par Joëlle Dublanchet, Actes Sud, 832 p., 26 €.
2. « La Maison éternelle », de Yuri Slezkine
Sans doute la contribution la plus originale au centenaire d’Octobre 1917, qui se veut l’histoire « à la Perec » d’un immeuble construit dans la Moscou rouge et destinée abriter les privilégiés du régime. Les murs témoignent de tous les soubresauts de l’histoire soviétique, qui sont abordés à travers les récits, presque tous inédits (archives, journaux, correspondances, etc.), des familles qui y ont résidé. L’ère révolutionnaire, la terreur et le stalinisme, passés au crible de l’intimité.
La Maison éternelle. Une saga de la Révolution russe, de Yuri Slezkine, traduit de l’anglais (États-Unis) par Pascale Haas, Bruno Gendre, Charlotte Nordmann, Christophe Jaquet, La Découverte, 1 296 p., 27 €.
3. « Histoire des Indes », de Michel Angot
L’un des meilleurs spécialistes des Véda et des textes traditionnels, Michel Angot propose une histoire de ce qui s’appelle aujourd’hui « l’Inde », nom qui recouvre, en réalité, une civilisation allant de la Perse à l’Asie du Sud-Est. Ce travail est d’autant plus précieux qu’il s’efforce de déconstruire les mythes obturant notre perception de cette « cosmopolis sanskrite » – que ces mythes émanent de l’Europe ou de la récupération nationaliste du passé à laquelle se livre le gouvernement indien actuel. On en conseillera la lecture, avant tout voyage vers le sous-continent, si l’on ne veut pas en rester aux chromos criards représentant les dieux ni aux guides touristiques.
Histoire des Indes, de Michel Angot, Les Belles Lettres, 896 p., 39 €.
4. « Les femmes sont des guitares (dont on ne devrait pas jouer) », de Clemens Setz
Dans ce roman aussi dérangeant que haletant, dû à un jeune écrivain autrichien, une infirmière de 21 ans est confrontée, dans la résidence médicalisée où elle travaille, à un étrange manège entre un ex-harceleur et son ancienne victime, qui finissent par échanger leur rôle. Sur fond du décor à la fois calme et angoissant d’une ville de province autrichienne, le monde se dérègle peu à peu jusqu’à ce que se brouillent les pistes entre folie et normalité. Cette subtile critique du monde actuel est menée sur le mode du thriller.
Les femmes sont des guitares (dont on ne devrait pas jouer), de Clemens Setz, traduit de l’allemand par Stéphanie Lux, Jacqueline Chambon, 992 p., 27,80 €.
5. « La Première Pierre », de Carsten Jensen
Comment raconter une guerre lancinante mais oubliée comme celle de l’Afghanistan, même si celle-ci, d’attentats en attentats, se rappelle régulièrement à l’actualité ? Ce défi, l’écrivain et reporter danois Carsten Jensen a su le relever par une fresque qui ébranle bien des certitudes. On s’attache irrésistiblement aux pas des volontaires danois qu’il décrit, pétris de certitudes humanitaires et de bons sentiments, mais que le contact avec l’Orient et l’islam va métamorphoser de façon irrésistible en leurs adversaires. Le récit parvient à plonger ses lecteurs dans le quotidien cruel des combattants d’aujourd’hui aux prises avec un conflit interminable.
La Première Pierre, de Carsten Jensen, traduit du danois par Nils C. Ahl, Phébus, 764 p., 26 €.