Somaliland, les leçons d’un pays fantôme
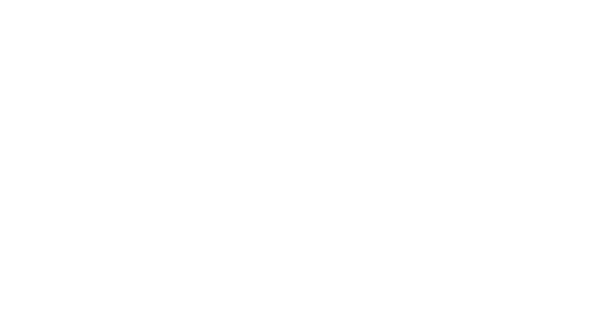
Somaliland, les leçons d’un pays fantôme
Par Laurence Caramel
L’ex-protectorat britannique, autoproclamé indépendant de la Somalie en 1991, n’a été reconnu par aucun Etat, mais tente de consolider l’exercice de la démocratie.
Qui connaît le Somaliland ? Ce territoire logé dans les confins septentrionaux de la Somalie s’obstine depuis vingt-six ans à prouver qu’il peut se frayer un destin pacifique et démocratique au milieu du chaos. L’ancien protectorat britannique, autoproclamé indépendant de la Somalie en 1991, n’a jusqu’à présent été reconnu par aucun autre Etat. Il reste officiellement une province autonome du pays formé avec la Somalie italienne le 1er juillet 1960, cinq jours après avoir dénoué les liens avec la puissance coloniale.
Sa trajectoire fait pourtant exception dans la Corne de l’Afrique, où régimes autoritaires et Etats faillis sont la norme. L’élection présidentielle du 13 novembre vient de le confirmer. Le candidat du parti au pouvoir, Musa Bihi Abdi, investi le 14 décembre, a été élu au terme d’un processus électoral que les observateurs de la mission internationale financée par le Royaume-Uni ont qualifié de « globalement pacifique et bien organisé ». En dépit d’irrégularités dans plusieurs circonscriptions et au terme d’une semaine de négociations émaillée de quelques affrontements, son principal rival, Abdirahman Irro, s’est rangé au verdict de la commission électorale pour ne pas ruiner le capital le plus précieux dont dispose le Somaliland pour plaider sa cause sur la scène internationale.
Porte close
Jusqu’à présent, les émissaires du Somaliland ont toutefois toujours trouvé porte close. Les Occidentaux, pourtant attentifs à la consolidation de cette expérience démocratique – outre le Royaume-Uni, les Etats-Unis ont financé la mise à jour des listes électorales à partir d’un système d’identification biométrique par scan de l’iris –, se défaussent sur l’Union africaine (UA). L’organisation continentale ne se montre pas davantage disposée à s’engager sur ce dossier. La candidature du pays, déposée en 2005, pour devenir un Etat membre de l’UA est restée lettre morte. La ligne de l’UA est claire : éviter de rouvrir un débat sur les frontières héritées de la colonisation, qui pourrait alimenter les volontés sécessionnistes toujours vivaces dans plusieurs pays. Le différend entre le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique, dont elle subit directement les effets depuis que le royaume chérifien a réintégré l’institution, fin 2016, la conforte dans cette voie. Par ailleurs, l’influence de l’Egypte, proche de la Somalie, membre comme elle de la Ligue arabe, contribue aussi à ce statu quo.
Avec son administration, son armée et son drapeau, le Somaliland fait ainsi partie de ces Etats de facto (de fait) par opposition aux Etats de jure (de droit) qui jouissent de l’onction des autres Etats et des Nations unies. Ce statut de passager clandestin ne l’empêche pas d’entretenir des relations avec certains bailleurs de fonds bilatéraux et des agences d’aide onusiennes, dont les enseignes bordent les rues de la capitale, Hargeisa, pour faire la publicité des quelques projets financés par des subsides étrangers. Le Royaume-Uni a ouvert des bureaux de représentation. L’absence de statistiques distinctes dans les registres de l’aide internationale rend difficile une évaluation précise de ce soutien. Au mieux, il atteindrait une centaine de millions de dollars sur le gros milliard annuel accordé à Mogadiscio depuis 2010.
A ce compte-là, les Somalilandais ont de bonnes raisons de penser que la guerre paie davantage que la paix. Le ministre des affaires étrangères, Saad Ali Shire, le dit sans ambages : « La communauté internationale ne reconnaît pas nos efforts et notre contribution à la stabilité de la région. Elle récompense davantage la mauvaise gouvernance. » Faute d’un accès plus large aux guichets internationaux, dont ceux du Fonds monétaire international (FMI), et d’un cadre juridique rassurant pour les investisseurs étrangers, le Somaliland vit avant tout des capitaux rapatriés par sa diaspora et de la réussite de quelques entrepreneurs privés. Le contrat signé en 2016 avec Dubaï pour développer le port en eau profonde de Berbera, sur le golfe d’Aden, puis celui signé cette année avec les Emirats arabes unis pour l’installation d’une base navale ont toutefois fait naître l’espoir de jours meilleurs.
Retour en arrière inconcevable
En attendant, le sous-emploi généralisé pousse les jeunes sur les routes de l’exil. Avec leurs voisins éthiopiens ou érythréens, ils sont parmi les plus nombreux à tenter de rejoindre l’Europe. La sécheresse qui sévit sur la corne de l’Afrique depuis quatre saisons a décimé les troupeaux de dromadaires qui s’exportaient vers la péninsule Arabique. Des dizaines de milliers de personnes ayant tout perdu ou presque sont venues gonfler les camps de réfugiés installés aux abords des principales villes.
De plus, 70 % des 3,5 millions d’habitants vivant sur ce territoire un peu plus grand que la Grèce ont moins de 30 ans. La paix et la liberté dont ils se montrent si fiers ne sont pas un remède à la faim. Ni à l’absence d’horizon dans lequel les enferme la situation d’un pays fantôme. Tout retour en arrière semble cependant inconcevable.
Chez les jeunes générations nées dans un Somaliland « indépendant », la seule évocation qu’il pourrait un jour en être autrement soulève un refus absolu. Musa Bihi Abdi s’est engagé à reprendre les discussions avec le gouvernement fédéral de Mogadiscio pour négocier les termes d’un divorce qui ouvrirait la voie à une reconnaissance internationale. Jusqu’à présent, toutes les tentatives ont échoué. La dernière médiation, sous l’égide de la Turquie, a avorté en 2015. Le chemin s’annonce long et sans garantie. Les nombreuses chancelleries européennes qui ont félicité le Somaliland pour ce pas supplémentaire vers la démocratie et promis leur coopération financière se sont bien gardées de s’aventurer sur ce terrain.







