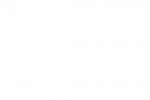« Le conflit en Centrafrique s’est approfondi, sur le terrain comme dans les esprits »

« Le conflit en Centrafrique s’est approfondi, sur le terrain comme dans les esprits »
Par Thierry Vircoulon
Pour le chercheur Thierry Vircoulon, l’année 2017 a vu la crise s’installer dans la durée, au point d’apparaître aux yeux de certains comme une fatalité.
L’année qui s’achève est celle de la désillusion pour les Centrafricains. Après la phase post-coup d’Etat marquée par des violences intercommunautaires sans précédent (2013-2014), le déploiement d’une mission de maintien de la paix des Nations unies (Minusca, 2014), la préparation des élections (2014-2015) et l’illusion d’un retour à la stabilité (2016), le conflit a changé, pour s’approfondir en 2017. Les efforts de médiation, désordonnés et contradictoires, de Sant’ Egidio, de l’Union africaine (UA) et de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) n’ont pas abouti à un véritable accord avec les groupes armés, mais ont rendu plus confus le ballet diplomatique autour d’eux.
Le président Touadéra, élu en 2016 avec une confortable majorité (62 % des voix), n’a pas rompu avec les habitudes de mauvaise gouvernance publique. L’administration centrafricaine n’est toujours pas effective, reste complètement dépendante de l’aide budgétaire des bailleurs de fonds et concentrée à Bangui. La corruption perdure à tous les niveaux du secteur public, le gouvernement signant des contrats dans le dos des bailleurs de fonds et du Parlement. Bunkerisés à Bangui, les membres du gouvernement ne se rendent en province que sous la protection de la Minusca mais affirment, lorsqu’ils rencontrent des investisseurs, que la crise humanitaire est finie.
Les groupes armés prolifèrent
Les Nations unies, qui ont déployé plus de 10 000 casques bleus et doivent en recevoir 900 de plus, ont connu leur premier revers militaire sérieux. En mai, la Minusca a perdu pour la première fois des casques bleus lors d’une embuscade des miliciens anti-balaka. Au plan militaire, face à l’ouverture annoncée d’un nouveau front dans le sud-est du pays, la Minusca n’a pas été capable de reprendre l’initiative contre les groupes armés en raison de la très faible mobilité – voire la passivité – de ses troupes. Au plan politique, la visite du secrétaire général de l’ONU et la priorité donnée à un « dialogue politique renforcé » dans la nouvelle résolution du Conseil de sécurité adoptée en novembre démontrent que les Nations unies n’ont pas de solution à proposer pour résoudre la crise centrafricaine.
Quant à l’Union européenne (UE), dont la principale contribution à la résolution de la crise centrafricaine est la reformation de l’armée, elle n’y croit pas elle-même. Forte d’une expérience similaire au Mali, l’UE s’inquiète en coulisses des violences indiscriminées que les militaires centrafricains pourraient commettre ou de leur déroute s’ils venaient à être déployés dans des zones de combat.
De 2016 à 2017, les groupes armés ont gagné du terrain. Ils sont actifs dans quatorze préfectures sur seize et ont chassé dans certaines provinces les représentants de l’Etat (préfets et sous-préfets) qui, après un premier déploiement en 2015, se sont de nouveau déployés fin 2017. Mais plus que la progression des groupes armés, c’est leur évolution qui est particulièrement inquiétante. Ils se fragmentent selon des clivages ethnico-économiques, profilèrent (de dix à quinze entre 2015 et 2017) et sont de plus en plus déstructurés, c’est-à-dire sans chaîne de commandement.
En 2017, les luttes territoriales entre factions de l’ex-Seleka ont suscité l’expansion du mouvement anti-balaka dans l’est du pays, où il n’existait pas encore ; il s’y développe depuis mai sous le nom de « groupes d’autodéfense ». La généralisation d’un sentiment anti-peul et l’embrasement du Sud-Est, depuis mai, avec son cortège de violences similaires à ce qui se passait en 2014 dans l’Ouest, sont révélateurs de la communautarisation du conflit et des interactions perverses entre groupes armés et communautés. Faute d’un minimum de sécurité fournie par les casques bleus, les communautés font des groupes armés leur bouclier et ces derniers en profitent pour mettre en avant leur « légitimité ».
De ce fait, la situation humanitaire se dégrade très rapidement. Alors que le chiffre record de 1,1 million de personnes déplacées et réfugiées a été atteint cette année et que les besoins humanitaires explosent, les financements diminuent et les humanitaires sont de plus en plus victimes, eux aussi, du conflit. En 2017, treize d’entre eux ont perdu la vie. Et les ONG, qui ont dû évacuer plusieurs villes en raison de l’insécurité, craignent une réduction drastique de l’accès humanitaire. Dans ce marasme, paradoxalement, les bailleurs de fonds continuent d’accorder des financements de court terme, comme si ce conflit pouvait prendre fin dans quelques mois.
« On a avancé en reculant »
Après l’espoir de changement suscité par les élections de 2016, les Centrafricains ont pris conscience d’être entrés dans une crise existentielle longue et douloureuse. Ils affrontent cette réalité à leur manière et avec leurs moyens : le président, avec son gouvernement au grand complet, organise une journée entière de prière pour la paix, tandis que les habitants de Bria continuent de s’entasser dans le camp de PK3 à côté de la base de la Minusca et que les propriétaires de bétail tentent de négocier avec les seigneurs de guerre le passage de leurs vaches vers les pâturages du Sud en ce début de saison sèche.
En l’absence de perspective de solutions, le conflit centrafricain se déplace et s’approfondit. Le temps de la guerre fait son œuvre. Comme au Darfour ou dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), un système de conflits (entre groupes armés, entre communautés, entre groupes d’intérêts) s’installe et des rapports de forces militaro-économiques s’établissent de manière plus ou moins durable. De tout cela, les Centrafricains prennent confusément conscience, car, comme le dit avec un triste sourire un représentant religieux, « en 2017, on a avancé en reculant ».
Toutefois, la plus grave évolution de l’année n’est pas à rechercher sur le terrain mais dans les esprits, centrafricains comme internationaux, qui sont aujourd’hui dominés par la résignation et le renoncement. La crise centrafricaine n’est pas une fatalité, mais elle le devient si on refuse de tirer les leçons des quatre dernières années et d’inventer de nouvelles solutions.
Thierry Vircoulon est chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (IFRI) et enseignant en sécurité et conflit en Afrique à Science Po-USPC.