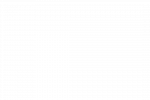En égypte, une présidentielle atrophiée
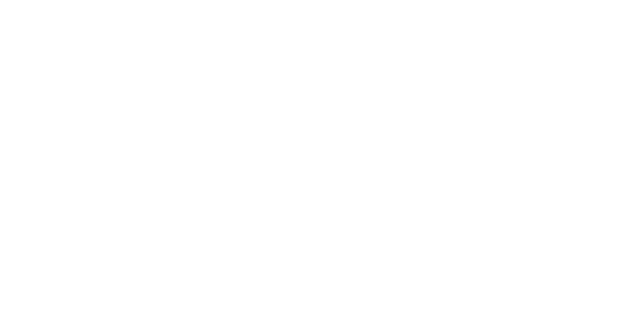
En égypte, une présidentielle atrophiée
Editorial. Après les islamistes, après les révolutionnaires, c’est dans son propre camp que le président-maréchal Al-Sissi fait taire toute voix dissidente, alors que plusieurs candidats potentiels à l’élection présidentielle ont été contraints de jeter l’éponge.
Potrait du président-maréchal égyptien Al-Sissi, le 25 janvier 2018, au Caire. / MOHAMED ABD EL GHANY / REUTERS
Editorial du « Monde ». Elle va être longue cette campagne présidentielle en Egypte ! Deux mois nous séparent de son premier tour, qui se tiendra du 26 au 28 mars : une éternité en l’absence de véritable compétition.
Alors que les prétendants à la magistrature suprême ont jusqu’au 29 janvier pour déposer leur dossier de candidature, un cinquième candidat potentiel a été contraint de jeter l’éponge. Jeudi 25 janvier, jour anniversaire de la révolution de 2011, l’avocat Khaled Ali, célèbre pour son implication dans le domaine des droits de l’homme et déjà candidat en 2012, a annoncé son retrait. Depuis l’annonce de sa candidature, il y a trois mois, trop de menaces et d’obstacles s’étaient accumulés contre lui et ses partisans, a-t-il expliqué.
Avant Khaled Ali, quatre autres impétrants ont été empêchés ou dissuadés. L’ex-premier ministre et général à la retraite Ahmed Chafik avait été expulsé, en décembre 2017, des Emirats arabes unis, où il vivait, et avait annoncé son intention de se présenter. Après une mystérieuse disparition de vingt-quatre heures à son arrivée au Caire, il avait renoncé au terme de ce qui ressemble fort à une opération d’intimidation.
Puis le colonel Ahmed Konsowa, autre candidat déclaré, a été condamné, en décembre 2017, à six ans de prison pour « comportement nuisant aux exigences du système militaire ».
Le 15 janvier, c’était au tour de Mohamed Anouar Al-Sadate, le neveu de l’ancien président égyptien Sadate, d’annoncer son forfait. Enfin et surtout, l’ex-chef d’état-major de l’armée, Sami Anan, a été arrêté le 23 janvier, trois jours après l’annonce de sa candidature. Accusé d’incitation à la division entre les forces armées et le peuple, et de falsification de documents officiels, il sera jugé par un tribunal militaire.
En dehors de Khaled Ali, tous ces hommes étaient des piliers de l’ancien régime d’Hosni Moubarak. Ahmed Chafik a été le dernier premier ministre du raïs déchu en février 2011, et Sami Anan, son chef d’état-major de 2005 à 2012. L’un comme l’autre, ainsi que le colonel Ahmed Konsowa, appartiennent à l’establishment militaire, qui dirige l’Egypte depuis 1952, à l’exception de la courte présidence de l’islamiste Mohamed Morsi, seul dirigeant librement élu de l’Egypte moderne. Aucun d’entre eux, donc, ne menaçait les orientations idéologiques du régime du président Abdel Fattah Al-Sissi.
Un signe de la fébrilité du régime
C’est d’autant plus inquiétant. Après les islamistes, après les révolutionnaires, c’est dans son propre camp que le président-maréchal Al-Sissi fait taire toute voix dissidente. C’est un signe de la fébrilité du régime plus que de sa force. Et cette répression tous azimuts, si elle ne lui attire aucune critique de ses partenaires étrangers, ne va pas renforcer sa stature internationale. A l’heure du bilan de son premier mandat, le président, auteur du coup d’Etat de 2013 qui avait renversé M. Morsi, sait que ses réalisations sont insuffisantes, essentiellement dans le domaine de l’économie alors que la réduction des subventions de l’Etat aux produits de base et la chute de la livre égyptienne touchent durement les classes populaires.
Le seul enjeu du scrutin présidentiel plébiscitaire qui s’annonce en Egypte est désormais la participation. Il y a quatre ans, il avait fallu ajouter un troisième jour de scrutin pour atteindre péniblement le taux officiel de 47,5 %, probablement truqué. Plus que jamais, la révolution de 2011 s’efface, comme un lointain mirage.