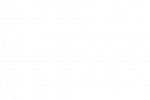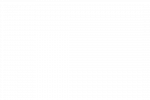Pollution de l’air : les animaux, des sentinelles pour l’homme

Pollution de l’air : les animaux, des sentinelles pour l’homme
Par Faustine Vincent
[Semaine de la presse 2018] Les rares études évaluant l’impact de cette pollution sur les bêtes permettent de révéler plus vite des risques invisibles pour la santé.
Les chats sont eux aussi vulnérables au dioxyde d’azote, aux particules fines et aux hydrocarbures ; en particulier les asthmatiques. / FRANK AUGSTEIN / AP
Ce sujet a été élaboré et proposé par onze élèves de 4e du collège Henri-IV de Meaux, le 19 mars, à l’occasion de la Semaine de la presse 2018, lors d’une visite à la rédaction du Monde.
Le canari était jadis un célèbre lanceur d’alerte. Quand les hommes descendaient dans les mines de charbon, ils l’emportaient avec eux pour être avertis quand la concentration en monoxyde de carbone devenait potentiellement mortelle. L’oiseau, vingt fois plus sensible que l’homme à ce gaz très toxique mais inodore et incolore, prévenait du danger en tombant de son perchoir, asphyxié. Il ne restait alors qu’une dizaine de minutes aux mineurs pour sortir et échapper à la mort.
Dans les mines hier comme dans les zones urbaines aujourd’hui, les animaux sont aussi exposés que les hommes à la pollution de l’air. On peut évaluer ses ravages chez les êtres humains : plus de 500 000 morts prématurées par an en Europe, dont 45 840 en France, selon l’Agence européenne de l’environnement. En revanche, on ignore ce qu’il en est pour les animaux. L’équivalent de l’agence Santé publique France et de l’Assurance-maladie (qui observent en permanence l’état de santé des Français) n’existant pas pour eux, il est impossible de mesurer l’impact de cette pollution de façon globale et systématique. Et les études sur le sujet sont rarissimes.
« Personne ne s’intéresse à ça, regrette Martine Kammerer, professeure de toxicologie animale et responsable du Centre antipoison animal et environnemental de l’Ouest. Je le déplore, parce que la pollution atmosphérique participe des problèmes respiratoires et du développement de cancers chez les animaux de compagnie. » A défaut de statistiques, elle fait valoir le « bon sens » : « Ils respirent le même air que nous, donc ils en subissent les mêmes effets, surtout les plus âgés et les plus fragiles. »
Les risques sont plus marqués pour les chiens en ville, dont le museau est au niveau des pots d’échappement, provoquant des troubles respiratoires. Les chats sont eux aussi vulnérables au dioxyde d’azote, aux particules fines et aux hydrocarbures ; en particulier les asthmatiques. « C’est certain, mais difficile à chiffrer », précise la professeure. D’autant que les pics de pollution ne se traduisent pas forcément par une hausse des consultations vétérinaires.
A l’image du canari dans les mines, les animaux de compagnie peuvent pourtant jouer un rôle de « sentinelle » pour les hommes : étudier l’impact de la pollution atmosphérique sur eux permet de collecter des données sur la composition de l’environnement, et de révéler plus rapidement des risques invisibles pour la santé.
La docteure vétérinaire Brigitte Enriquez, professeure émérite de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, a ainsi mené une étude sur des chats à Paris en 2016. « On a découvert qu’ils avaient des phtalates dans le sang. C’était une grande surprise, car l’environnement [où ils évoluaient pour l’expérience] était “pauvre”, sans objets plastique alentour. » Elle en a conclu que des phtalates étaient présents dans l’air extérieur. Les chats ont ici servi d’« indicateurs d’exposition » à la pollution. Mais les effets de cette exposition, eux, peuvent varier entre les animaux et les humains, dont la sensibilité n’est pas la même. La prudence est donc de mise avant de transposer telles quelles les observations faites sur les bêtes.
Pour autant, Brigitte Enriquez juge « essentiel » d’étudier cette question. « Pendant des décennies, le discours consistait à dire que les hommes étaient une espèce à part, sur son piédestal, et qu’on ne pouvait pas les comparer avec les animaux, se souvient cette pionnière sur le sujet en France. La prise de conscience de l’intérêt d’étudier les animaux est venue tardivement. »
Des répercussions sur la chaîne alimentaire
La mystérieuse maladie observée dans les années 1950 au Japon dans la baie de Minamata, contaminée par le mercure que déversait l’usine chimique voisine, a servi de déclic. Les chats qui ont mangé des poissons malades ont eu rapidement un comportement anormal : ils devenaient fous et se jetaient dans la mer. Des années plus tard, pêcheurs et habitants ont, à leur tour, développé des symptômes physiques et neurologiques. Premier cas d’intoxication environnementale à grande échelle, le scandale a mis au jour le fait que « les chats pouvaient être des animaux sentinelles en servant d’indicateurs d’exposition et d’effet neurologique », souligne Brigitte Enriquez. Il a aussi mis en évidence « l’importance et le fonctionnement de la chaîne alimentaire ».
Et plus on est haut dans la chaîne alimentaire, comme l’homme, plus la concentration des polluants - ingérés en bas de la chaîne par les plus petits animaux - s’accentue. Les scientifiques appellent cela « phénomène de biomagnification » ou « bioaccumulation ». « Les polluants s’accumulent au fur et à mesure dans les graisses des animaux, explique Renaud Scheifler, écotoxicologue et maître de conférences au laboratoire de chrono-environnement du CNRS. Une algue contenant 0,1 microgramme par kilo [de polluant] va ainsi passer à 10 000 chez l’ours polaire en bout de chaîne. Mais on peut parfois passer d’un coefficient de 1 à un million ! » D’où l’intérêt de ne pas négliger l’observation de l’impact de la pollution même sur les plus petits animaux.
C’est ce qui a incité Renaud Scheifler à se pencher en même temps sur la contamination au plomb des vers de terre et sur celle des merles, qui les mangent. L’idée était de voir si les oiseaux pouvaient être encore contaminés par ce métal lourd potentiellement toxique – dégagé pendant des décennies par les pots d’échappements puis retombé sur le sol – malgré l’interdiction du plomb dans les carburants depuis le 1er janvier 2000. « On s’attendait à ce que [le plomb] passe par voie alimentaire », précise l’écotoxicologue. L’hypothèse s’est confirmée : les vers de terre et les merles des villes étaient trois fois plus contaminés que ceux des champs. Le plomb, qui peut rester des millénaires dans la terre, a continué d’être ingurgité par les vers de terre, eux-mêmes consommés par les merles.
A plus grande échelle, l’impact de la pollution de l’air sur les animaux en zone urbaine reste à défricher. « C’est LE gros sujet de demain, assure Renaud Tissier, professeur de pharmacie-toxicologie. D’abord parce qu’on parle de plus en plus du bien-être animal, mais aussi parce que les animaux peuvent jouer ce rôle de sentinelle pour l’homme. » Et pas seulement les canaris.