Cinéma : Farouk Beloufa, l’image manquante de l’Algérie
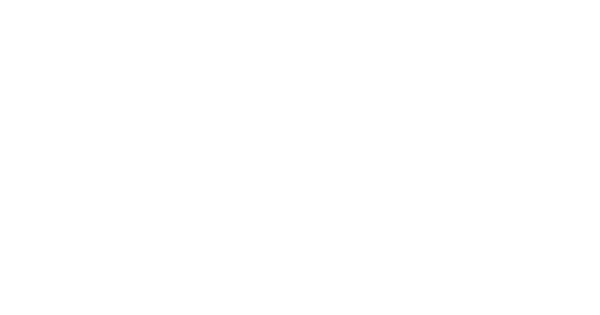
Cinéma : Farouk Beloufa, l’image manquante de l’Algérie
Par Fahim Djebara (contributeur Le Monde Afrique)
Le réalisateur de « Nahla » est mort le 9 avril en France, sans avoir obtenu dans son pays la reconnaissance méritée.
Son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose et c’est presque normal. Né en 1947 et décédé le 9 avril à Paris, Farouk Beloufa était le réalisateur d’un seul long-métrage de fiction, Nahla. Une pièce unique, sortie en 1979, considérée par Des nouvelles du front, un site d’informations dédié au septième art, comme « l’un des plus beaux jardins secrets du cinéma algérien ».
Tourné à Beyrouth à la fin des années 1970, en pleine guerre civile, le film a été remanié au gré des contraintes du quotidien dont il rend l’intensité. Il fixe le début du conflit libanais à travers le regard d’un journaliste-photographe algérien, interprété par Youcef Sayah, dépêché pour couvrir la tournée de la chanteuse libanaise Nahla, campée par la magnifique Yasmine Khlat. Au milieu des tirs, des exécutions sommaires et des débats de la gauche libanaise que le journaliste fréquente, la diva perd sa voix.
Pourquoi ce film signe-t-il le crépuscule de la carrière de Farouk Beloufa plutôt que ses débuts prometteurs ?
« Nous n’étions pas prévus »
Au milieu des années 1960, l’Algérie socialiste à parti unique se construit et appuie sa propagande sur le cinéma, produisant même de très bons films (Nahla a été soutenu par la télévision publique). Alger ouvre en 1964 un institut pour compléter les contingents de réalisateurs formés à l’étranger. Farouk Beloufa et son ami Merzak Allouache figurent parmi les premiers pensionnaires. Par manque de moyens et de volonté politique, le projet s’éteint, mais pas les rêves de cinéma de ses élèves.
Passé en France par l’Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC, aujourd’hui Femis), Farouk Beloufa réalise en Algérie deux courts-métrages, Situation en transition et Travestis et Cassures, aujourd’hui considérés comme perdus, et un long-métrage documentaire, Insurrectionnelle (1973), qui lui fait découvrir la censure. Commande publique sur la guerre d’Algérie, « le film n’allait pas dans le sens de l’histoire officielle », se souvient Merzak Allouache. Il est remonté puis diffusé sans signature.
Dans une interview à la revue Africultures, Farouk Beloufa, qui avait découvert Le Caire au sein d’une équipe de tournage de Youssef Chahine, en 1976, puis le Liban, raconte l’urgence pour lui de tourner à Beyrouth. Paradoxalement, il disait mieux « respirer » dans cette ville en guerre qu’à Alger, où il se sentait « muselé, dévitalisé, cherchant [son] oxygène ».
« Nous n’étions pas prévus, comme absents de la planification », poursuit Merzak Allouache, qui évoque la censure politique mais aussi les barrières dressées par les réalisateurs d’Etat « installés ». Les deux amis doivent ruser avec la censure, mais alors qu’après avoir tourné en 1976 le superbe Omar Gatlato, Merzak Allouache réalise une vingtaine de films entre la France et l’Algérie, Farouk Beloufa quitte son pays à la fin des années 1980 pour la France et ne trouve plus les ressources pour mener ses projets à bien.
« J’ai perdu la voix, comme Nahla »
Ce n’est qu’en 2010 que son film est enfin projeté à Beyrouth, où il retourne pour la première fois, grâce à l’association Beirut DC et à son festival. Les acteurs libanais du long-métrage découvrent Nahla sur grand écran, grâce à une cassette BETA fournie par l’association marseillaise Aflam, qui avait elle-même fait redécouvrir l’œuvre une année plus tôt à ses spectateurs. A une personne qui lui demande pourquoi il n’a plus tourné, le cinéaste répond par une pirouette : « J’ai perdu la voix, comme Nahla. »
En privé, il avait la dent plus dure contre les « apparatchiks » qui l’avaient poussé à quitter l’Algérie. « Fais attention, ils vont te briser », dit-il à Sofia Djama en 2011, après avoir vu à Paris son premier court-métrage, dont il avait salué la liberté de ton. La jeune réalisatrice tournera son premier long-métrage, Les Bienheureux, en Algérie en 2016, sans aide publique mais sans difficultés administratives, et en intégrant plusieurs séquences de Nahla à son film.
« J’avais trouvé la réalisation de Nahla très moderne, de même que ses propos, quelques mois avant les révolutions arabes », se souvient Rabih El Khoury, le programmateur de Beirut DC. Cette modernité artistique ou politique, que le quotidien Libération relevait en 2005 à l’occasion d’une diffusion du film à la télévision française, est la qualité la plus partagée parmi les hommages rendus à Farouk Beloufa depuis que sa mort est devenue discrètement publique.
« Il m’a rassuré sur la force créatrice dont nous sommes capables, nous, Algériens, et sur notre capacité à porter un regard sur autre chose que nous-mêmes, témoigne Sofia Djama. Pour le monde arabe, son film est comme une image manquante, il nous rappelle que la révolution n’est pas un mot qui n’appartient qu’au politique et qu’elle est une urgence en chacun de nous. »
« Des talents ostracisés et brisés »
En 2013, le réalisateur Tariq Teguia avait lui aussi rendu hommage à Nahla en le programmant au Forum des images, à Paris, dans la foulée de la sortie de son troisième long-métrage, Révolution Zendj, dans lequel un journaliste algérien cherche des réponses à ses questions à Beyrouth. Et l’année suivante, Farouk Beloufa avait réussi, avec l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel, à tourner un nouveau court-métrage, Le Silence du Sphinx.
Ludmila, une Algérienne installée à Beyrouth, se souvient que ses parents lui ont montré des films de Pasolini ou de Bergman mais ne lui ont jamais parlé de Beloufa. Il lui a fallu attendre de quitter son pays, en 1994, pour qu’un étudiant français l’invite à découvrir Nahla. Elle hésite d’abord, croyant avoir affaire à un « énième film sur le conflit palestinien », mais son ami la rassure : « C’est une poésie. » « Le découvrir a été un choc, se souvient-elle aujourd’hui depuis Beyrouth. Mais ça m’a immédiatement rendue triste, car ça m’a rappelé le nombre incalculable de personnes de talent qui ont été ostracisées et brisées par ce régime. »
Si le passage de relais a été difficile entre les générations, peut-être a-t-il existé au sein de la famille Beloufa ? Neïl, son fils, expose actuellement au Palais de Tokyo, à Paris, un dispositif scénographique sur l’histoire, alors qu’Occidental, son premier long-métrage, est sorti en France le 23 mars.







