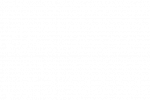Attention, donner des livres à l’Afrique nuit gravement à sa santé éditoriale

Attention, donner des livres à l’Afrique nuit gravement à sa santé éditoriale
Par Kidi Bebey
Considéré comme un acte philanthropique, l’envoi aux pays du Sud d’ouvrages édités au Nord pose de nombreuses questions économiques et éthiques.
Lors du Salon du livre de Genève, une table ronde réunissant acteurs africains du livre et responsables institutionnels devait, jeudi 26 avril, examiner la question du don, activité vertueuse aux yeux du grand public. Une problématique cependant moins anodine qu’il n’y paraît.
Voilà dix ans qu’à l’entrée du salon suisse, un espace dévolu à l’opération de solidarité, PartagerLire recueille les ouvrages dont les visiteurs souhaitent se délester. Les livres ainsi récoltés sont ensuite répartis pour une part en Suisse, auprès d’œuvres sociales et d’établissements hospitaliers, et pour une autre part au Sénégal, afin de doter des bibliothèques dans le cadre d’un partenariat avec le ministère sénégalais de la culture.
Il s’agit de faire « bon débarras », pourrait-on dire au sens propre, puisque donner n’a jamais aussi bien rimé avec aider. Quel plaisir de favoriser ainsi l’accès à la lecture de ceux qui ont moins de livres que soi ! Et, au passage, quelle gratification pour l’ego de se voir faire le bien.
« Famine du livre »
De fait, donner des livres édités dans les pays du Nord afin qu’ils atteignent des lecteurs potentiels dans les pays du Sud est considéré comme de la pure philanthropie. Comment pourrait-on se poser des questions à ce sujet alors que l’idée d’une pénurie du livre en Afrique est si bien ancrée dans les schémas mentaux ? Il semble donc naturel d’utiliser les surplus de l’industrie du livre occidental pour combler les manques constatés en Afrique.
Cette approche de la question a un point de départ historique. L’universitaire et chercheur français Raphaël Thierry rappelle que, en 1961, « la conférence des Etats d’Afrique pour le développement de l’éducation a identifié les besoins en livres des différents pays : le constat général était qu’il n’y avait pas assez de producteurs de livres en Afrique et qu’il était donc nécessaire de faire venir des livres étrangers pour satisfaire les besoins en éducation du continent ».
Mais ce qui devait constituer une simple phase d’appui au démarrage d’Etats nouvellement indépendants s’est trouvé renforcé par l’idée ultérieure d’un véritable « sauvetage » lorsque, une vingtaine d’années plus tard, l’Occident a voulu apporter au continent une aide plus massive. On est à l’époque des concerts humanitaires de Band Aid (1984) en faveur de l’Ethiopie, bientôt suivis par la tournée musicale d’Amnesty International. En 1985, lors d’une rencontre organisée par l’International African Institute à Londres, commence à émerger l’expression évocatrice de « famine du livre ».
Raphaël Thierry commente :
« En réalité, le secteur culturel était en crise dans de nombreux pays à cette époque. Un plan d’ajustement structurel avait été mis en place à la fin des années 1970 et les Etats africains, à travers les mesures imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont dû couper pas mal de leurs crédits aux industries en place. Le secteur du livre s’est effondré dans plusieurs pays, alors qu’il connaissait un essor.
On se souvient par exemple de la création des Nouvelles Editions africaines, qui réunissaient le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Togo. En Afrique équatoriale, le Cameroun avait créé le Centre régional d’édition et de publication du livre africain, à la fin des années 1970, avec l’appui de l’Unesco, qui était une plaque tournante de production et de rencontres d’éditeurs pour développer des programmes de coédition, de promotion et de formation.
Il faut se rappeler que près de 200 éditeurs africains étaient représentés à la Foire du livre de Francfort en 1980 ! L’édition africaine n’était peut-être pas un centre économique mondial, mais elle était en plein essor. »
Parallèlement, l’Europe – la France en particulier – connaît une capitalisation de l’édition et un boum de la production de livres. Les éditeurs ne savent plus quoi faire de leurs retours d’invendus, et les bibliothèques débordent d’ouvrages qu’il leur est interdit de détruire. Le don va s’avérer une alternative au stockage et au pilonnage, qui ont un coût.
Un don « raisonné »
A cette époque apparaissent des associations et organisations caritatives (Adiflor, Biblionef…) basées sur le don de livres. Toutes défendent l’idée d’un don « raisonné », comme le précise Dominique Pace, la directrice de Biblionef :
« La moitié des projets que nous soutenons concerne l’Afrique, mais nous sommes intervenus depuis vingt-cinq ans dans une centaine de pays sur les cinq continents. Nos dotations sont toujours très ciblées, pensées sur mesure, avec l’aide de partenaires très identifiés, afin de répondre aux besoins spécifiques d’une école, d’un réseau d’écoles ou de bibliothèques associatives. Il ne s’agit jamais d’envoyer le plus de livres possibles, mais de doter chaque projet des livres qu’il faut, là où il y a une demande qui est remontée du terrain et où l’on sait que les livres seront utilisés dans les meilleures conditions possibles pour qu’il y ait des résultats tangibles. »
Ce type d’ONG revendique en outre le principe du don comme contribution au développement des pays concernés, comme l’explique Dominique Pace :
« Confrontée au dénuement extrême des enfants, je me suis dit qu’il fallait parier sur le livre comme moyen de les sortir de leur isolement et d’améliorer leurs conditions d’éducation. D’ailleurs, à Biblionef, nous sommes les seuls à avoir à nos côtés les grands noms de l’édition de jeunesse française. Je tiens à faire profiter les enfants du monde entier de ces très beaux livres, magnifiquement réalisés, afin qu’ils développent leur ouverture sur le monde, qu’ils jouent, qu’ils se consolent aussi…. C’est quelque chose d’universel ! »
Un tel positionnement place ce type d’organisation aux côtés des opérateurs institutionnels de la coopération bilatérale ou multilatérale (Institut français, Union européenne, Organisation internationale de la francophonie). Cependant, cette recherche d’éthique opératoire ne doit pas faire oublier que, ce faisant, ONG et institutions participent malgré tout à gérer le désengorgement d’un trop-plein éditorial en organisant l’envoi des livres occidentaux invendus vers des pays extra-européens. Dominique Pace repousse de telles critiques en rappelant qu’« il ne s’agit pas de se débarrasser de tout ce dont on n’a plus besoin ici pour l’envoyer ailleurs, mais de doter au mieux des bibliothèques d’écoles ou de communautés ».
De fait, les ONG françaises les plus installées et reconnues se défendent de faire du « dumping » à la manière de certaines organisations anglophones dont la politique consiste à fournir d’importants volumes de livres grâce à des moyens colossaux. Le don de livres passe également par un certain nombre d’institutions et organisations religieuses, chrétiennes ou musulmanes. « Très peu de chiffres circulent, mais la démarche est restée constante depuis les indépendances, voire l’époque coloniale », observe Raphaël Thierry.
Bibliodiversité menacée
Un autre type de pratique s’avère particulièrement néfaste : celle du don sauvage de livres, par des structures associatives quand ce ne sont pas de simples individus qui, à l’occasion de voyages, apportent des valises d’ouvrages. Ancienne libraire devenue auteure et fondatrice en 2004 des Editions Jeunes Malgaches (EJM), à Antananarivo, Marie-Michèle Raza s’insurge contre ces méthodes : « Les dons de livres handicapent le développement de l’édition et de la lecture à Madagascar. » L’éditrice a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en alertant aussi bien les pouvoirs publics que les donateurs naïfs, qu’elle sensibilise à la question via les hôtels de tourisme solidaire :
« Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un seul hôtel peut recevoir jusqu’à 4 000 livres gratuits par an, quand un livre édité à Madagascar est tiré à 500 exemplaires en moyenne. C’est d’autant plus grave qu’il n’y a que 5 % de francophones à Madagascar, 83 % de la population ne parlant que malagasy. Il faut donc bien plus que du livre en langue française. Mais, à force de dons, les gens pensent que le livre ne s’achète pas. »
Parallèlement au développement de son catalogue, l’éditrice mène de nombreuses actions de promotion du livre et de la lecture, tout en orientant les associations françaises désireuses d’aider vers la vente de livres collectés, dont l’argent servira à acheter des livres produits localement plutôt qu’à l’expédition de livres venus de France, lesquels transportent avec eux une culture et une vision du monde différentes de ce que proposent les livres africains. De fait, comme le souligne Laurence Hugues, directrice de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, « le don de livres réduit la bibliodiversité » :
« Il faut arrêter de dire que le don de livres perdure parce qu’il n’y a pas d’offre de livres en Afrique. Il existe au contraire une production remarquable dans le domaine littéraire, aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. En revanche, sans renoncer totalement au don pour ne pas priver les lecteurs là où s’expriment des besoins, il est temps d’affiner la réflexion par des apports précis lorsqu’ils sont absents de la production locale. Je pense par exemple aux dictionnaires, à la production universitaire spécifique. Dans l’idéal, il faudrait pouvoir compter sur une volonté des pouvoirs publics de soutenir le développement du secteur éditorial et de l’offre locale. »
Visions passéistes
Une trentaine d’années après les débuts du don professionnalisé et systématisé, le paysage éditorial africain a beaucoup évolué et ne peut être laissé à la marge d’un mode d’action qui peut contrecarrer son développement. « La majorité des ONG du don revendiquent aujourd’hui le fait de travailler avec des éditeurs africains, mais quand on demande aux éditeurs africains avec quelles ONG ils travaillent, on ne reçoit pas de réponse, remarque Raphaël Thierry. De même, les ONG ne citent ni éditeurs ni titres. »
Le chercheur français, auteur d’une étude sur la question du don avec l’éditeur Hans Zell, l’a diffusée auprès des ONG. « Aucune ne nous a fait de retour. On leur a offert un droit de réponse, mais seul Book Aid International a répondu alors qu’on a interrogé une quinzaine de structures. Ce qui me questionne, c’est l’incapacité des ONG à se remettre en cause et à écouter les critiques qui sont formulées à leur égard. »
Au nom d’une tradition du don remontant à plusieurs décennies, l’approche du grand public et de certaines ONG a du mal à évoluer. L’idée toute faite d’une Afrique progressant à petits pas dans le domaine de l’édition est pourtant contredite par des lieux de production dynamiques comme la Côte d’Ivoire ou, pour l’Afrique de l’Est, l’African Books Collective, cette plateforme imaginée dès 1985 par sept éditeurs africains et qui rassemble aujourd’hui 150 éditeurs anglophones et francophones, les diffuse (2 000 titres dont 800 en accès numérique) et contredit toutes les visions passéistes de « famine du livre ».
Le temps est peut-être venu de se passer progressivement du don, comme le propose Jérémy Lachal, directeur général de Bibliothèques sans frontières :
« Le don de livres, pour nous, n’est pas une finalité. Ce qui nous intéresse, c’est de l’utiliser comme moyen pour créer des bibliothèques afin qu’elles ne deviennent pas seulement des vecteurs de diffusion de la culture mais des acteurs économiques de la chaîne du livre. Nous collectons en France les livres de particuliers que nous pouvons revendre sur le marché de l’occasion. Les recettes de ces ventes nous permettent ensuite de mettre en place des projets structurants. L’idée est qu’à chaque fois qu’on fait un don de livre, on achète pour des sommes équivalentes des livres auprès d’éditeurs locaux. »
Alors pourquoi ne pas changer de focale et profiter, si l’on est en Suisse, de la section africaine du Salon du livre de Genève pour découvrir et acheter les ouvrages proposés par les éditeurs africains présents ? Car il est temps que les nouveaux discours sur le don sortent de la sphère professionnelle pour atteindre le grand public. Le don, on le sait, ne saurait se passer de contre-don. Ni bonté, ni bonne volonté, ni vanité, le don est peut-être avant tout une question d’égalité.