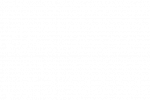Cannes 2018 : « The House That Jack Built », le cauchemar meurtrier de Lars von Trier

Cannes 2018 : « The House That Jack Built », le cauchemar meurtrier de Lars von Trier
Par Thomas Sotinel
Pour son retour au Festival de Cannes, le réalisateur danois fait d’un tueur en série le porte-parole de l’artiste maudit, entre acte de contrition et provocation.
L’ovation qui a accueilli Lars von Trier à son arrivée dans le Grand Théâtre Lumière, lundi 14 mai, fut nettement plus intense que celle qui a conclu la projection de The House That Jack Built, 155 minutes plus tard. Entre-temps la salle avait plongé dans les abîmes d’une noire dépression, qui se manifestait par des cauchemars assassins, féminicides dans leur immense majorité.
Ecrivant une demi-heure après que le générique a fini de défiler sur l’écran, je suis incapable de déterminer si ce long film, torturé et torturant, est un acte de contrition ou la revendication de toutes les fautes dont on a chargé son auteur, de Breaking The Waves à Nymphomaniac. La seule certitude, mais elle est ancienne chez Lars von Trier, c’est l’omniprésence et la permanence de la souffrance, physique et psychique.
Au début du film, alors que l’écran est encore noir, on entend deux voix dialoguer en anglais. La première, plus juvénile, demande l’autorisation de parler, la seconde est celle, reconnaissable entre toutes, est celle de Bruno Ganz, qui autorise son interlocuteur à raconter son histoire, même s’il a déjà tout entendu de ses compagnons au long de ce voyage indéfini, qu’il a manifestement accompli très souvent.
Plus tard, on saura que le vieillard s’appelle Verge, et si l’on n'a pas encore résolu l’énigme, il finira par revendiquer la paternité de l’Enéide. On ne découvrira ses traits qu’à la toute fin du film. Auparavant Verge aura commenté sur un ton navré la pratique et la théorie de Jack (Matt Dillon) au long de leur descente.
« The House That Jack Built » de Lars von Trier, présenté hors compétition au 71e Festival de Cannes. / ZENTROPA-CHRISTIAN GEISNAES
Lars von Trier se met en scène
Jack est tueur en série. Il revendiquera une soixantaine de meurtres dont Lars von Trier, dans son infinie miséricorde, ne met en scène qu’une poignée, répartis en cinq « exemples ». La plupart des victimes sont des femmes, aucune des actrices mobilisées pour tomber sous les coups du sociopathe (Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Grabel et Riley Keough), n’a eu droit à un personnage. Les femmes ne sont ici que matériau.
Le terme est utilisé par Jack qui revendique aussi sa qualité d’artiste, que lui conteste vigoureusement Verge. Il n’est pas besoin de détailler la litanie des crimes. Ils sont justifiés par leur auteur comme la manifestation d’une part irréductible de la nature, mais aussi comme une discipline voisine de l’architecture. Cette assimilation de la transgression la plus violente à l’art repose sur un leitmotiv : des séquences empruntées à la télévision canadienne montrant Glenn Gould jouant du piano chez lui. La bizarrerie légendaire du musicien, sa position torturée, ses incantations marmonnées pendant qu’il joue tout comme sa mauvaise santé psychique sont ainsi assimilées (et Glenn Gould n’est plus en mesure d’objecter) aux pathologies les plus terrifiantes.
En somme, il n’est pas besoin de chercher midi à quatorze heures pour conclure que Lars von Trier se met en scène sous les traits d’un génie dont l’art évoque et provoque la souffrance, et que l’incompréhension qu’il suscite n’est que la manifestation de l’étroitesse d’esprit de la plupart des humains.
Enfermé dans la répétition de ses crimes
Mais alors, pourquoi avoir fait de Jack le tueur en série le personnage le plus ennuyeux, le plus déprimant qu’on puisse imaginer. Avec une belle constance, Matt Dillon lui prête une autosatisfaction, une mesquinerie, une étroitesse de vue qui en font un être si laid que ses discours sur la beauté du mal (monologues qui permettent à Lars von Trier de renouveler ses provocations en exhumant Hitler et Speer des archives filmées) apparaissent dérisoires, banals et ennuyeux. D’autant que souvent la belle voix de Bruno Ganz lui cloue le bec (et c’est plus la qualité de l’élocution de Ganz que celle des dialogues que le scénario de Lars von Trier lui offre qui suscite cette impression).
Uma Thurman et Matt Dillon dans « The House That Jack Built » de Lars von Trier, présenté hors compétition au 71e Festival de Cannes. / ZENTROPA-CHRISTIAN GEISNAES
Jack est enfermé dans la répétition de ses crimes, et le metteur en scène remet en service les procédés qui lui ont servi pour Nymphomaniac, entrelardant les violences faites aux corps de digressions philosophiques ou esthétiques. Le cadre instable, le montage saccadé ramènent à la période Dogma de Lars Von Trier. L’infernale et prévisible conclusion de The House That Jack Built retrouve un peu de la beauté de Breaking The Waves ou Melancholia.
De toute façon, à ce stade du film, voilà déjà bien longtemps que Lars von Trier s’est cité lui-même, juxtaposant des extraits de sa filmographie à l’évocation des plus grands crimes du XXe siècle. Quant à savoir s’il regrette où s’amuse de cette collision, il faudra le lui demander. Avant comme après la projection de son film à Cannes, Lars von Trier a gardé le même demi-sourire, le même regard absent.
Film danois de Lars von Trier, avec Matt Dillon, Bruno Ganz (2 h 35). Date de sortie indéterminée.