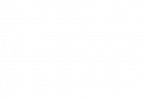Cannes 2018 : avec « Le Poirier sauvage », Nuri Bilge Ceylan creuse son sillon en Anatolie

Cannes 2018 : avec « Le Poirier sauvage », Nuri Bilge Ceylan creuse son sillon en Anatolie
Par Jacques Mandelbaum
Pour son huitième long-métrage, en compétition, le cinéaste turc ausculte toujours la mauvaise conscience et la lâcheté humaines.
Le cinéaste Nuri Bilge Ceylan devant l’hôtel Le Gray d’Albion avant le départ pour la montée des marches à Cannes, le 18 mai 2018. / STEPHAN VANFLETEREN POUR « LE MONDE »
Photographe de formation, auteur de films à la beauté plastique vertigineuse, transformant l’intimisme amer de ses sujets en épopées climatiques lancinantes, Nuri Bilge Ceylan (59 ans) est un vieil amant du Festival de Cannes.
Présent sur la croisette dès 1995 avec son court-métrage Koza, Nuri Bilge Ceylan y a livré depuis la quasi-intégralité d’une œuvre régulièrement primée (notamment la Palme d’or en 2014 avec Winter Sleep) où la balance vitale des débuts (Kasaba, 1998, Nuages de mai, 1999) a progressivement laissé place à l’anatomie enluminée de la mauvaise conscience, de la petitesse et de la lâcheté des hommes.
Le Poirier sauvage (Ahlat Agaci), son huitième long-métrage, creuse toujours ce sillon, s’efforçant toutefois d’y insuffler, et on l’en remercie, la flamme terminale d’un possible réenchantement du monde. Le film dépeint le retour dans sa ville natale anatolienne de Sinan, jeune aspirant écrivain au seuil de sa vie professionnelle, qui tente difficilement de faire publier un essai à compte d’auteur, qui a pour titre celui-là même que porte le film, Le Poirier sauvage.
Parallèlement à ces tentatives, Nuri Bilge Ceylan brosse une chronique familiale et un état des lieux du pays. Ancienne amie rudoyée par la vie, croisée par hasard et embrassée sans lendemain, turpitudes d’un foyer endetté par la folie du jeu de son instituteur de père et attristé par l’exaspération de la mère, constat accablé du peu d’enthousiasme, de l’arrogance et du manque de culture rencontrés auprès des fonctionnaires et des notables qu’on lui recommande pour la publication de son livre.
Les acteurs Dogu Demirkol et Murat Cemcir devant l’hôtel Le Gray d’Albion avant le départ pour la montée des marches à Cannes, le 18 mai 2018. / STEPHAN VANFLETEREN POUR « LE MONDE »
Entre l’intransigeance de la jeunesse et les machinations sordides pour se faire connaître, Sinan en vient alors à douter de lui-même et à envisager de s’engager dans la police anti-émeutes. Entre-temps, au fil des saisons qui contribuent à sa lente dramaturgie, le film a insensiblement placé en son centre la relation du père et du fils, motif ancien et sans doute très personnel du cinéaste turc.
De fureur et de remords
Petit homme rieur qui semble une réminiscence du lieutenant Colombo, le père oppose au fils l’insouciance de sa passion, la gaîté de son caractère, la velléité, d’autant plus attendrissante qu’elle est inefficace, de retaper la maison de campagne familiale, mais aussi son absence de vergogne qui lui fait mendier le moindre sou, ainsi que l’irresponsabilité familiale qui va avec.
Un très lent et très improbable rapprochement entre ces deux hommes que tout oppose en apparence se met en place. L’arc narratif, tendu durant près de trois heures sur l’idée d’une hostilité et d’un mépris grandissants du fils pour le père, traversé de splendides autant que morbides visions oniriques, va in fine se détendre dans une scène qui, pour tenir du deus ex machina de l’affaire, n’en est pas moins très émouvante.
Toujours trop tardive, toujours remplie de fureur et de remords, la douce réconciliation des fils et des pères est un horizon trop rarement atteint pour ne pas toucher au cœur tous les fils et tous les pères du monde.
Film turc de Nuri Bilge Ceylan. Avec Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Serkan Keskin (3 h 08). Sortie en salle le 15 août. Sur le Web : distribution.memento-films.com/film/infos/91