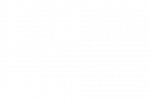Michaëlle Jean : « La langue française est un trait d’union pour agir »

Michaëlle Jean : « La langue française est un trait d’union pour agir »
Propos recueillis par Marc Semo
Candidate à un second mandat à la tête de l’OIF, la Canadienne défend une Francophonie politique et pas seulement linguistique.
La Canadienne Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, à Paris, en décembre 2016. / ERIC FEFERBERG / AFP
Diplomate, ancienne gouverneure générale du Canada (2005-2010), Michaëlle Jean, 61 ans, est secrétaire générale de la Francophonie depuis janvier 2015, après avoir été élue lors du sommet de Dakar, en novembre 2014. Originaire d’Haïti et arrivée au Canada à l’âge de 11 ans, elle est la première femme à occuper ce poste et brigue un second mandat à la tête de l’organisation lors du sommet d’Erevan, les 11 et 12 octobre.
L’ex-journaliste de radio et de télévision a été critiquée par ses adversaires pour n’avoir pas donné suffisamment de visibilité à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui réunit 84 pays ayant d’une manière ou d’une autre le français en partage. Après le lâchage de la France et de nombre de pays de l’Union africaine (UA) au moment du sommet de Nouackchott début juillet, le Canada et le Québec ont déclaré, mercredi 10 octobre, se rallierr au consensus autour de la candidate rwandaise, Louise Mushikiwabo. Malgré ces déconvenues, Mickaëlle Jean devrait maintenir sa candidature jusqu’au bout.
Pourquoi vous présentez-vous ?
Michaëlle Jean Je suis venue servir cette organisation pour ce qu’elle est, pour ses principes et parce qu’elle est forte des valeurs universelles qui la fondent, non seulement la langue mais aussi les droits humains, la liberté, la démocratie, tout cet héritage des Lumières et de la Révolution française.
Lors de mon élection en 2014, j’ai eu la confiance des gouvernements des Etats membres face à six autres candidats et j’ai hérité d’une feuille de route très ambitieuse. Je savais ce qui m’attendait dans un monde en plein chambardement, confronté à d’immenses défis – la sécurité, le développement, le dérèglement climatique –, où montent les tentations du repli identitaire et du nationalisme. Dans un tel contexte, il faut une organisation positionnée au mieux sur l’échiquier multilatéral.
Quatre ans, c’est vite passé. Les articles 6 et 7 de la Charte de la francophonie précisent que le mandat du secrétaire général est renouvelable pour quatre ans de plus. Le premier mandat est une sorte d’état des lieux, où l’on pose les bases, lance des partenariats, où l’on renforce la coopération. Le second doit servir à consolider l’accompli et pousser encore plus loin. Mais aussi, à deux ans du 50e anniversaire de l’OIF, il faut porter un agenda pour la Francophonie pour les vingt prochaines années.
Vous pensez avoir encore des chances même si un grand nombre d’Etats membres se sont prononcés en faveur de la Rwandaise Louise Mushikiwabo et que votre bilan est contesté ?
Mon bilan est à la fois apprécié et appréciable, et je vais le montrer dans le rapport aux chefs des Etats membres. Il comprend une centaine de missions politiques d’accompagnement de processus électoraux dans une trentaine de pays, sous l’aspect technique mais aussi afin de s’assurer qu’ils se déroulent dans les meilleures conditions, avec un dialogue inclusif avec les partis d’opposition.
Nous avons aussi mené une cinquantaine de missions de facilitation et de médiation dans les pays africains, en prévention, pour désamorcer des crises. Dans notre stratégie économique, nous avons mis avant tout l’accent sur l’Afrique. Sur treize pays africains et de l’océan Indien, nous avons créé des incubateurs mais aussi aidé les petites et moyennes entreprises. Je pense que ces dirigeants m’en savent gré et qu’ils apprécient le travail accompli.
Comment jugez-vous l’attitude de la France, qui se pose comme l’un des principaux soutiens de Mme Mushikiwabo ?
Quand j’entends des propos venant de Paris sur le nécessaire recadrage de la Francophonie, qui devrait avant tout avoir vocation à servir le rayonnement et la promotion de la langue française, je m’inquiète de l’avenir d’une organisation qui a sa place légitime sur l’échiquier multilatéral. La Francophonie ce n’est pas seulement cela. La langue française est un trait d’union pour agir. Dès sa genèse, la Francophonie était là pour aider les Etats dans le renforcement de l’Etat de droit, des libertés, de la démocratie.
Je défends la Charte de la Francophonie. Si l’on se met à faire fi d’un document fondateur, c’est le début de la fin. Je ne m’explique pas et je ne comprends pas cette position des autorités françaises et notamment du président Emmanuel Macron. Comment peut-on, comme le président français, se poser en héraut du multilatéralisme à l’ONU et rechigner à ce que l’OIF y ait pleinement sa place en tant qu’organisation ?
Vous pensez que le jeu reste ouvert pour le secrétariat général ?
Bien sûr. Il faut que celui ou celle qui porte la Francophonie le fasse avec une vraie conviction sur la Francophonie politique et ses fondamentaux : les droits et les libertés. Notre organisation rassemble 84 Etats et gouvernements et j’ai le soutien de tous ceux qui sont soucieux de s’inscrire dans l’esprit de cette organisation et de sa charte. Parmi les chefs d’Etat membres de l’UA, il n’y a pas de consensus sur Louise Mushikiwabo. Il y a même un réel embarras. Rien n’est joué et je suis une battante.
Je suis née à Haïti, un pays qui a su renverser l’impossible et créer la première République noire. Aimé Césaire disait : c’est le lieu où la négritude s’est pour la première fois tenue debout. Mais je suis aussi citoyenne du Canada, pays où je suis arrivée à 11 ans avec mes parents qui fuyaient la dictature et où l’on nous a offert l’asile puis une citoyenneté pleine et entière. Je sais ce que c’est de devoir renaître ailleurs et partir de rien. L’africanité est aussi globale. Les afro-descendants qui, par leur sang, ont construit l’Amérique en font partie.
La décision finale sera prise dans la capitale arménienne lors du sommet de l’OIF.
Quel est le point de votre bilan dont vous êtes le plus fière ?
L’apport de la Francophonie au multilatéralisme, que nous appelons de tous nos vœux. J’étais à New York pour l’assemblée générale des Nations unies, comme chaque année depuis mon entrée en fonction, afin de faire entendre notre voix face aux urgences de notre temps, comme je le fais aussi au Parlement européen ou à l’UA. Nous sommes attendus et sollicités. Par cinq fois entre 2015 et 2018, nous avons été au Conseil de sécurité, notamment pour réfléchir aux mandats des opérations de maintien de la paix, dont la moitié se déroulent dans un environnement francophone. De cela, je suis très fière. Nous ne voulons pas être une petite ONU bis, mais la Francophonie est devenue un partenaire incontournable aussi bien de l’Union européenne (UE), de l’UA, de la coopération ibéro-américaine ou du Commonwealth, parce que certains de nos pays en sont membres.
Et votre principal regret ?
De ne pas encore être allée, faute de temps, dans le Pacifique. Et aussi de n’avoir pas pu me rendre en tant que secrétaire général dans mon pays natal, Haïti.
Le français est passé de la sixième à la cinquième place des langues les plus parlées dans le monde. Le président français voudrait qu’elle fasse mieux. Est-ce possible ?
Il y a en effet, selon de nombreuses études, la réalité de la croissance démographique en Afrique, et notamment en Afrique francophone, où vivront le plus grand nombre de locuteurs de la langue française. Mais cela implique aussi que nous retroussions nos manches, car cette fidélité au français ne va pas de soi. Il va falloir former de plus en plus d’enseignants et élaborer des programmes scolaires de qualité. Il faut des politiques d’éducation et d’adéquation pour que le français soit perçu comme une langue utile.
Je suis à cet égard particulièrement fière d’avoir créé l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation, basé à Dakar, qui fédère ce qu’il y a de mieux en la matière. Dans la seule Côte d’Ivoire, nous formons 20 000 maîtres, et 6 000 aux Comores. La demande est très forte, y compris dans des pays qui n’ont pas le français comme langue officielle, comme le Laos ou le Cambodge, qui, revenant dans le giron de la Francophonie pour des raisons économiques, nous demandent de former leur administration et leurs diplomates en français. Il y a un vrai désir du français dans le monde.