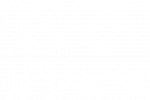Pilote de drone, un miroir aux alouettes

Pilote de drone, un miroir aux alouettes
Par Jean-Michel Normand
Le nombre de télépilotes a doublé depuis début 2017, mais la demande ne suit pas.
Le nombre de télépilotes a doublé depuis début 2017. Ici, à Brétigny-sur-Orge. / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
S’il est un secteur qui ne craint pas une pénurie de main-d’œuvre, c’est celui des drones civils. Selon les dernières données de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), le nombre d’opérateurs professionnels – pilotes de drone ayant satisfait aux épreuves du brevet, obligatoire pour exercer une activité rémunérée – est passé de 3 500 début 2017 à 7 510 au 1er octobre 2018. Ces télépilotes, selon le terme consacré, disposent de 13 300 drones et font vivre une filière forte de 10 000 à 11 000 emplois, pour un chiffre d’affaires qui a doublé en 2017 (250 millions d’euros).
Paradoxalement, ce tableau, qui devrait inciter à l’optimisme, inquiète la profession, qui redoute de voir émerger une « bulle », à savoir un trop-plein de télépilotes attirés par les mirages d’un métier qui ne se résume plus à faire voler un appareil à distance, mais exige une plus forte valeur ajoutée. De fait, la plupart des quelque 7 500 télépilotes dûment enregistrés volent peu ou pas du tout. Selon la Fédération professionnelle du drone civil (FPDC), 60 % d’entre eux ne justifieraient que d’une « activité occasionnelle ».
« Les drones commencent à être utilisés dans de multiples domaines et beaucoup de gens sont persuadés que savoir piloter ouvre aisément accès à une vaste panoplie d’activités. C’est faux. Aujourd’hui, un télépilote doit aussi être capable d’interpréter les données qu’il a recueillies et, donc, disposer d’une compétence supplémentaire », insiste Francis Duruflé, chargé de mission à la FPDC. En clair, on recherche beaucoup d’ingénieurs, de professionnels du bâtiment ou de géomètres sachant manier un quadricoptère, mais peu de candidats n’ayant pas d’autre qualification particulière que celle de pouvoir manier un appareil à distance.
« Un métier qui n’existe pas »
Cette réalité semble d’autant plus prégnante que le télépilotage n’apparaît pas comme une activité très pérenne. Les drones, qui sont de plus en souvent utilisés en vol automatisé, réclament un savoir-faire de programmateur plutôt que les talents d’un aéromodéliste. En outre, le brevet exigé pour exercer une activité commerciale est difficile à obtenir, long et onéreux (compter un budget d’au moins 2 000 euros).
Echo au succès des drones de loisir, la multiplication des vocations de télépilote s’est d’abord portée vers les services (vidéos de fête familiale ou d’événement privé), une activité vite saturée, et l’audiovisuel, brèche dans laquelle se sont engagés certains vidéastes intermittents du spectacle. Cette voie, là encore, s’est singulièrement rétrécie.
Le recours croissant aux drones dans les domaines du BTP, de la surveillance de grands ouvrages ou de la sécurité attire des salariés ayant perdu ou abandonné leur emploi en quête de reconversion. « Nous sommes très sollicités et il est difficile d’expliquer que le métier de télépilote n’existe pas, qu’il ne peut pas s’agir d’une compétence isolée », assure Philippe Boyadjis, qui dirige Drones by Lukas, un centre de formation installé à Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne).
Pilote de drone, un miroir aux alouettes ? « Il faut être clair : il n’y a pas, aujourd’hui, assez de travail en France pour 7 500 télépilotes », renchérit Tom Berteau, commercial chez Abot, organisme créé par le distributeur rouennais Studiosport et qui forme surtout des géomètres, des pompiers ou des policiers. « Je suis un peu gêné de voir tous ces gens risquer de se bercer d’illusions. L’autre jour, une mère de famille m’a demandé quelle orientation il faudrait choisir pour son fils, passionné de drones, en fin de 3e », soupire Francis Duruflé, à la Fédération professionnelle du drone civil.