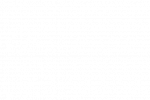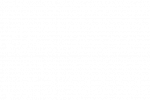Au Sahel, maintenir l’élevage pastoral pour s’adapter au changement climatique

Au Sahel, maintenir l’élevage pastoral pour s’adapter au changement climatique
Par Pierre Hiernaux, Mamadou Oumar Diawara et Mohamed Habibou Assouma
La transhumance, qui joue au Sahel un rôle essentiel dans l’adaptation des troupeaux aux variations climatiques, est aujourd’hui menacée.
Un troupeau de zébus et d’ânes en transhumance au Niger, en novembre 2006. / Pierre Hiernaux, CC BY-NC-ND
Au Sahel, immense région africaine comprenant, entre autres, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et les huit Etats du nord du Nigeria, l’élevage représente 40 % du PIB agricole et 15 % du PIB total. Les produits de l’élevage constituent, en fonction des pays, le second ou le troisième poste d’exportation.
Activité économique principale pour au moins 50 millions de personnes (sur un total de 137 millions de Sahéliens), l’élevage est pratiqué par près de 80 % des familles rurales. Parmi ces élevages familiaux, les systèmes pastoraux ayant recours à la transhumance impliquent une très grande part du bétail. Au Niger, par exemple, cette pratique concerne 80 % des troupeaux (mais seulement 15 % des éleveurs). Les élevages pratiquant la transhumance fourniraient aux populations sahéliennes 70 % du lait, 60 % de la viande bovine et 45 % de celle des petits ruminants.
Mobilité et aléas climatiques
On désigne par transhumance cette migration saisonnière et régionale, parfois transfrontalière, de troupeaux guidés par leurs bergers, seuls ou en famille. Celle-ci se combine avec la mobilité quotidienne des troupeaux pastoraux : le long d’un circuit de pâture, les animaux vont paître et brouter, s’abreuver, marcher et se reposer pour ruminer. Qu’elle soit quotidienne ou saisonnière, cette mobilité vise à optimiser le choix de plantes fourragères broutées, pour nourrir le plus efficacement les animaux.
Adaptées à l’alternance des saisons de mousson, ces mobilités constituent une pratique d’adaptation aux changements climatiques. Elles sont aujourd’hui entravées par l’expansion des cultures et des infrastructures, la privatisation des terres et l’insécurité civile croissante, qui risquent à terme de condamner l’élevage pastoral.
Au cours de l’année, ce qu’on appelle l’« offre fourragère » – soit les plantes disponibles pour l’alimentation des animaux – varie en qualité et en quantité. La mobilité permet aux troupeaux de s’adapter à ces variations. Au Sahel, ces variations sont dépendantes du climat de moussons, marqué par l’alternance entre une brève saison des pluies (de juin à septembre) et une longue saison sèche (d’octobre à mai). Au cours de l’année, les pluies sont marquées par des quantités variables et une hétérogénéité spatiale.
Dans un contexte de réchauffement climatique, les prédictions des modèles ne concordent pas sur les tendances de pluviosité annuelle. Elles s’accordent cependant sur une multiplication des événements extrêmes, tels que les gros orages et les épisodes secs. En ajustant la quantité d’animaux aux plantes disponibles pour les nourrir, la mobilité du bétail réduit les risques de dégradation de la végétation et des sols associés à la pâture. Cet ajustement contribue à l’adaptation des troupeaux aux effets des dérèglements climatiques.
Une image négative
La pâture du bétail, en particulier celle des transhumants, souffre d’une image négative dans les discours et les écrits. Souvent qualifiée de surpâturage, elle est accusée de dégrader l’écosystème en réduisant le couvert végétal, en exportant les éléments minéraux et en modifiant la flore en faveur de plantes envahissantes. Mais ces critiques doivent être examinées de près.
Prenons par exemple les plantes herbacées : si elles sont en effet sensibles au broutage, cette vulnérabilité ne concerne que deux à trois semaines au cœur de la saison des pluies. Leur production peut alors être diminuée par deux, mais sur des espaces très restreints, du fait de la brièveté de cette phase et de la mobilité du bétail.
En saison sèche, le piétinement qui accompagne le broutage transforme de la paille en litière puis fragmente la litière et l’enfouit dans le sol, assurant ainsi le recyclage sur place d’au moins deux tiers des plantes herbacées. En outre, les ruminants recyclent par leurs excrétions de 40 à 60 % de la matière organique des fourrages ingérés, et de 60 à 90 % des minéraux qu’ils contiennent.
Le broutage des feuilles ou des fruits des buissons, arbustes et arbres par le bétail, en particulier par les chèvres et les dromadaires, ne porte que sur certaines espèces. Rappelons d’ailleurs que même pour les plantes dont le feuillage est le plus apprécié, la part prélevée reste inférieure à 5 % de la production foliaire annuelle de ces espèces végétales. Le rôle éventuel de l’élevage dans la diminution des ligneux vient davantage des coupes et tailles pratiquées par certains éleveurs pour mettre les plantes à portée du bétail.
Recyclage organique
Non seulement la part de la végétation prélevée par la pâture du bétail pour s’alimenter demeure modeste, mais le bétail contribue aussi à entretenir la fertilité des sols. Les excréments des animaux recyclent près de la moitié de la masse des fourrages ingérés sous une forme très rapidement décomposable ou assimilable pour les plantes. En accélérant ainsi le recyclage organique, l’élevage active toute une chaîne biologique dans les sols : insectes bousiers, termites, bactéries et champignons. Il joue un rôle déterminant dans la fertilité des sols tropicaux, pauvres en matière organique, carencés en azote et en phosphore, et souvent acides.
Au Sahel, la mobilité du bétail est aujourd’hui entravée par le rétrécissement et la fragmentation historique des espaces pastoraux, induits par l’expansion des terres cultivées (+2 % par an en moyenne). Ce phénomène répond à l’essor démographique continu des populations rurales, d’au moins 3 % par an et dont les modes de culture demeurent extensifs.
S’ajoutent à cela un étalement urbain non maîtrisé, l’expansion des voies de communication, la multiplication des barrages, mais aussi la privatisation croissante de l’usage des terres : des communautés sédentaires et des individus usent de leurs moyens et relations pour acquérir un titre de propriété, au détriment du droit coutumier qui gère l’accès en usufruit aux terres rurales, propriété de l’Etat.
L’accès aux points d’eau et aux parcours de pâturage est de plus en plus semé d’embûches : perte de bétail, agressions et taxations se multiplient pour les éleveurs (au moins ceux qui transhument) et dont les droits d’usages, qui relèvent de la coutume et de négociations, sont de moins en moins respectés.
L’insécurité civile qui s’est d’autre part installée dans les espaces pastoraux nord sahéliens – Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad – mais aussi dans les savanes au nord des pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, les conduit également à réduire leurs déplacements au détriment de la production ou à abandonner l’élevage pastoral devenu trop risqué.
Sédentarisation, une fausse bonne idée
Depuis le début du XXe siècle (et la période de la colonisation), l’alternative proposée à la mobilité pastorale consiste en une sédentarisation de l’élevage, présentée comme une sécurisation et une modernisation.
Mais aujourd’hui, avec la fréquence croissante de gros orages et de longs épisodes secs en saison des pluies, les variations et l’hétérogénéité spatiale des ressources en plantes devraient empirer. Dans de telles conditions, la sédentarisation de l’élevage n’est viable qu’avec un recours accru aux aliments agroalimentaires – graines de coton, tourteaux d’arachide, de soja, son de céréales. Sans cela, le bétail ne pourra satisfaire ses besoins nutritionnels par la seule pâture.
Mais le recours à l’alimentation industrielle remet en question la rentabilité de l’élevage : les coûts d’acheminement et de conservation de ces aliments dans les zones pastorales sont élevés du fait de leur éloignement des sites de production et des ports.
L’impact environnemental de la sédentarisation est donc à considérer avec attention : la charge animale est alors découplée des ressources fourragères locales, avec des risques de surcharge, les années où la distribution des pluies ne favorise pas la bonne croissance des plantes herbacées. La production fourragère peut être réduite de moitié et la production de semences pour l’année suivante compromise.
Le bénéfice de l’activation biologique et des transferts de fertilité sont réduits, à moins de recourir à de coûteux transports de fumiers vers les zones de culture auxquels sont associées d’importantes pertes et émissions de gaz à effet de serre (méthane et protoxyde d’azote).
Maintenir l’élevage pastoral
L’élevage pastoral au Sahel apparaît aujourd’hui comme la meilleure option économique, sociale, sécuritaire et environnementale. Son maintien requiert cependant un investissement d’autant plus grand que les régions pastorales sont longtemps restées les parents pauvres du développement. L’investissement dans les infrastructures de l’élevage est en effet ridicule au regard de la part de la population pastorale et de sa contribution au PIB. Un retard qu’il est indispensable de rattraper.
Les soucis d’insécurité ont récemment enclenché une reconnaissance politique des systèmes pastoraux et le lancement de quelques projets de développement dédiés. On peut notamment citer l’initiative Praps, qui vise à appuyer l’élevage pastoral de six pays du Sahel (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal et Tchad) de façon concertée à l’échelle de la région.
L’accès par les éleveurs aux points d’eau et aux parcours doit être préservé en sauvegardant leur statut de biens communs. La concertation entre les éleveurs pastoraux et leurs partenaires – agro-éleveurs et agriculteurs sédentaires, municipalités et services techniques de l’Etat, administration civile – doit enfin être renforcée pour que les bénéfices de la mobilité pastorale soient mutuels.
Pierre Hiernaux est ingénieur agronome à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et membre du Comité scientifique de la désertification (CSFD) ; Mamadou Oumar Diawara est écologue, enseignant chercheur à l’université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako ; Mohamed Habibou Assouma est ingénieur agronome au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).
Cet article a d’abord été publié sur le site de The Conversation.