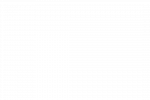« Perdre son temps pour en gagner » : les vertus des chemins de traverse

« Perdre son temps pour en gagner » : les vertus des chemins de traverse
Par Léa Iribarnegaray
En France, redoubler, se réorienter, faire une pause ou prendre une année sabbatique est souvent perçu négativement. Pourtant, un parcours atypique peut devenir une force, comme le montre les nombreux témoignages que « Le Monde » a reçu sur ce sujet.
MARION LAURENT
[Lycéens, étudiants, professeurs, parents, jeunes diplômés… Le Monde vous donne rendez-vous en 2019 à Saint-Etienne, Marseille, Nancy, Paris et Nantes pour de nouvelles éditions des événements O21/S’orienter au XXIe siècle. Des conférences et des rencontres inspirantes pour penser son avenir et trouver sa voie. Plus d’informations ici.]
Si le temps est élastique, rétrécit et se dilate à l’envi, pourquoi lui courir après ? Dans le tourbillon des études à la française, où rapidité reste synonyme de réussite, certains jeunes prennent le temps d’en perdre. Et qu’elle soit choisie ou subie, la pause fait du bien.
Adèle Véniel a attendu ses 18 ans pour partir, seule, faire le tour du monde sac au dos. « Après le bac, j’ai travaillé quelques mois chez McDo pour me payer mon voyage. Ce sont les seuls qui m’ont acceptée alors que j’étais mineure », indique la jeune femme, qui, comme de nombreux lecteurs, a répondu à un appel à témoignages du Monde.
Malgré un budget étique, elle multiplie les destinations : jeune fille au pair au Guatemala, en République dominicaine, au Pérou ; elle fait aussi du volontariat en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. « C’est dommage qu’en France cela soit encore si peu commun. Moi, j’encourage vraiment les lycéens à partir ! J’ai beaucoup découvert sur moi-même : ce qu’on apprend en voyage me semble aussi important que ce qu’on apprend à l’école », analyse celle qui se concentre à présent sur sa seconde 1re année de psychologie à l’université de Strasbourg.
« En rentrant, j’avais envie de faire plein de choses. Je n’ai pas mis la priorité sur mes études, et je ne regrette pas. Redoubler n’est pas une fatalité ! » Peu lui importent les critiques, la jeune femme se dit désormais plus libre, plus débrouillarde et ouverte d’esprit.
Les atouts de l’année de césure
Pour le sociologue Vincenzo Cicchelli, chercheur au Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de la Sorbonne (Gemass Paris-Sorbonne/CNRS), l’année de césure – de plus en plus connue sous le terme anglais de gap year – est à prendre au sérieux. « Il ne s’agit en aucun cas d’un caprice ou d’une mode passagère, souligne-t-il. Derrière cette envie, les jeunes pointent les limites d’une société française qui construit des trajectoires souvent très linéaires et formatées par le capital scolaire. »
Le sociologue distingue ceux qui réussissent et se disent : « A quoi bon ? J’ai passé ma vie à bachoter », de ceux qui ne réussissent pas et se disent : « A quoi bon ? Ce système n’est pas pour moi. » Dans les deux cas, bien au-delà d’une simple parenthèse, la coupure permet d’envisager différemment « sa propre biographie », selon l’expression du chercheur.
« Les jeunes osent une critique implicite du modèle actuel qui ouvre ou enferme totalement l’avenir. Ils revendiquent un droit à la réflexion, à la bifurcation, à la seconde chance. Ils veulent être autonomes et maîtres de leur destin. »
Clara Dumard, 25 ans, cumule tous ces droits. Dès 16 ans, elle quitte sa 1re S dans le Morbihan pour une expérience de six mois dans un lycée aux Etats-Unis. « C’était mal vu à l’époque : on m’avait annoncé des résultats catastrophiques au bac !, se remémore-t-elle. Et pourtant, à cette étape charnière de la vie, alors que j’étais très introvertie, ça m’a donné confiance en moi. » Après avoir repris sa 1re en France et obtenu le bac avec une année de retard, elle entre en Paces (première année commune aux études de santé).
« Après deux années la tête dans le guidon, j’ai eu mon concours de pharmacie à Caen. Ça me permettait d’avoir encore du temps pour réfléchir et de garder plusieurs portes ouvertes : l’officine, la recherche ou l’industrie. »
Fait rare en études de santé, elle part en Erasmus à Madrid pour sa troisième année, qu’elle obtient, même si des lacunes l’obligent à redoubler sa quatrième année. « Comme j’avais validé les trois quarts des matières, je me suis dit : “Trop bien, pour la première fois, j’ai du temps à côté !” Le matin, j’allais en cours, le soir, j’avais un petit boulot, et l’après-midi, j’ai lancé mon projet : tenter une traversée record du passage du Nord-Ouest en Arctique. J’ai appris mille choses cette année-là. »
Devenue étudiante-entrepreneuse, Clara Dumard crée sa société, établit un business plan, réunit des fonds, déniche le bateau et part naviguer trois mois avec son père. A son retour, elle décide d’arrêter ses études de pharmacie. Si une quatrième année en santé ne vaut pas grade de master 1, elle obtient une équivalence et se prépare aujourd’hui à des oraux pour entrer en master 2 dans une école de commerce.
« Pour la première fois de ma vie, mon parcours atypique devrait être valorisé pendant ces entretiens, s’amuse-t-elle. Je n’étais pas heureuse en pharma, j’ai juste eu le courage de dire stop. En France, une année de retard est toujours perçue comme un échec. Mais prendre le temps, c’est aussi profiter de l’énergie et de la folie de la jeunesse, c’est mieux se connaître pour finalement choisir ce qu’on aime. »
Parcours de vie
La route fait grandir. « L’ailleurs est une épreuve, du point de vue de la construction de soi, affirme Vincenzo Cicchelli. Toutes les évidences du quotidien sont ébranlées lorsqu’un jeune se retrouve à l’étranger. Cela fait partie des soft skills [qualités humaines] à acquérir : il est vital de ne plus être franchouillard, aujourd’hui ! »
Et le sociologue de pointer un décalage entre une société qui valorise les parcours sans faute et cette aspiration à l’autonomie toujours plus forte chez les jeunes Français. « L’Allemagne, les pays scandinaves et anglo-saxons fascinent cette génération, car ils sont davantage ouverts sur la question du temps », assure le chercheur.
Dans un contexte de plus grande incertitude sociale, institutionnelle et environnementale, les parcours de vie ne peuvent pas ressembler à des fleuves tranquilles. « Les jeunes font face à une double injonction : choisir sa vie et le faire rapidement, alors que le monde du travail est instable, précaire, flexible », pointe Maria Eugenia Longo, professeure et chercheuse à l’Institut national de la recherche scientifique et cotitulaire de la toute nouvelle chaire de recherche sur la jeunesse du Québec.
Prendre son temps devient alors une manière de contrer l’urgence avec laquelle on invite les jeunes à prendre des décisions. Une manière de s’ancrer avec profondeur et aplomb dans une vie qui conviendra à l’individu.
Après un master d’anglais à Dijon et deux années d’enseignement dans un lycée, Laura (le prénom a été modifié), 30 ans, fait une pause : « Le métier de professeur n’était finalement pas pour moi. Je voulais des relations humaines, pas des relations de force. »
Un sens à son avenir
Pendant deux ans, elle réfléchit à ce qu’elle souhaite faire, exerce divers petits boulots, puis décide de s’inscrire au concours d’infirmière. « Le social m’a toujours plu. A 18 ans, je n’ai pas osé passer ce concours. Je n’avais pas la maturité pour me retrouver devant des personnes malades. » Diplômée dans quelques mois, elle se sent désormais « au clair et à [sa] place », et son expérience en tant qu’enseignante lui est encore utile, notamment dans la prise de parole. « A 30 ans, je suis retournée vivre chez mes parents, j’ai eu l’impression d’avoir loupé le coche de l’entrée dans la vie professionnelle, raconte-elle. J’ai fait des choix douloureux mais je ne regrette rien. Sur le temps d’une vie, c’est rien du tout ! Ça vaut le coup si cela permet d’être mieux dans sa peau et de faire ce qu’on aime. »
La précarité du monde du travail, bien ancrée dans les esprits de la jeune génération, signifie aussi une précarité de l’existence. « Face à ce cadre incertain, les jeunes développent des stratégies de résistance, décrit Maria Eugenia Longo. Sans se désengager du travail, ils le conçoivent comme un objectif moins urgent et vont peut-être moins sacrifier d’autres sphères de vie. » Moins linéaires et plus réversibles, les parcours évoluent avec le sens qu’on donne à son avenir.
Après un bac ES obtenu « vraiment ric-rac », Dorian Soler, 25 ans, se retrouve dans une usine de production pendant dix-huit mois : « Je faisais les trois-huit, mais le plus dur, c’était l’ennui intellectuel. Ça m’a appris les valeurs du travail et une chose essentielle : gagner de l’argent, c’est bien ; faire un métier passionnant, c’est mieux. Finalement, c’est cette première expérience difficile qui m’a redonné le goût des études. Sortir du système scolaire m’a permis d’y retourner pour les bonnes raisons. » Il opte alors pour un BTS, avant d’entrer à la Montpellier Business School. Aujourd’hui étudiant en M1 en alternance, il reconnaît avoir « plus de motivation et de gratitude d’être à l’école ».
Si les multiples témoignages récoltés pour cet article forment un patchwork d’histoires individuelles et optimistes, il s’agit aussi d’une affaire collective et sociétale.
« J’insiste, lance Maria Eugenia Longo : si nos mères nous disent “Prends ton temps !”, ce n’est pas toujours le cas des institutions. Les conditions sociales et institutionnelles sont primordiales pour offrir une réelle panoplie d’opportunités. Une personne isolée, dépassée par la situation, peut très mal vivre le rapport à l’incertitude. Il faut alors prévoir des modes d’accompagnement, des soutiens à cette quête de soi. »
Stabilité ou flexibilité de l’emploi – enfer pour certains, bonheur pour d’autres, et vice-versa : reste à avoir les moyens de réaliser son choix.